 Jérôme Valluy, Humanité et numérique(s) – De l’histoire de l’informatique en expansion sociétale… au capitalisme de surveillance et d’influence (1890-2023), TERRA-HN-éditions, Collection HNP, 2023, 255 p. : http://www.reseau-terra.eu/article1347.html
Jérôme Valluy, Humanité et numérique(s) – De l’histoire de l’informatique en expansion sociétale… au capitalisme de surveillance et d’influence (1890-2023), TERRA-HN-éditions, Collection HNP, 2023, 255 p. : http://www.reseau-terra.eu/article1347.html
Éditorial n°1 de Terra-HN éditions – 3 août 2023, "2003-2023 : vingt ans de TERRA à TERRA-HN éditions" - Lire : http://www.reseau-terra.eu/article1453.html
Éditorial n°2 de Terra-HN éditions – 21 septembre 2023, "Appel à participation au comité scientifique de Terra-HN" - Lire : http://www.reseau-terra.eu/article1473.html
Recueil Alexandries
Reflets
Devenir des Écoles Doctorales face aux IAg ?
"J’en suis arrivé à la conviction qu’il est aujourd’hui possible de produire une thèse de doctorat en science politique, avec ChatGPT4 (Microsoft) ou Gemini (Google), en cinq mois au lieu de cinq ans, sans que les deux types de thèses ne soient différenciables intellectuellement, technologiquement ou juridiquement (ChatGPT4 produit une estimation de 1 à 2 ans au lieu de 3 à 5 ans qui me paraît prudente par effet de dressage centralisé d’entreprise tendant à se (...)
mai 2024
Esquisses
Numérique humanitaire et protection des données : colonialité, souveraineté et dignité.
L’objectif de ce working paper est de donner un premier aperçu des réponses au paradoxe qu’on a pointé : les humanitaires - acteurs engagés dans la protection de victimes de crises - sont en train d’adopter des outils numériques qui mettent potentiellement en danger ces dernières. Eux-mêmes en sont – dans une certaine mesure - conscients. Il semble que ce paradoxe soit en partie dû à des tensions propres à l’humanitaire, entre régime d’exception et approches par (...)
octobre 2023
Le journalisme professionnel traverse un paradoxe à l’ère numérique, marqué par la « collution » – un concept combinant collusion socio-économique et dilution éditoriale. Cette situation découle du bouleversement numérique, où les acteurs non professionnels contestent l’autorité historique des journalistes. La prolifération de contenus numériques de qualité variable dilue les productions journalistiques, provoquant une crise d’information qui renforce les modèles de (...)
mai 2024
Champ, contre-champ et hors-champ de la capture.
Cet article examine l’intersection entre la surveillance numérique et l’archivage photographique. Il argue que la surveillance moderne, intégrée dans les domaines médiatiques et politiques, trouve ses racines dans la reproductibilité photographique. L’étude montre comment la surveillance actuelle est vécue à travers des actes de capture et de contre-capture, tels que les captures d’écran. Bien que la relation entre surveillance et photographie soit évidente, cette (...)
mai 2024
Masters
NTIC et travail social dans le secteur associatifcrise de sens ou outils de professionnalisation ?
Le développement récent d’applications mobiles dans le milieu associatif pose la question du lien entre NTIC et action sociale. Or, la diffusion de ces applications a lieu dans un contexte de reconfiguration et de privatisation du secteur. Comment alors s’articulent NTIC et idéologie néolibérale ? Cette dernière est antérieure à l’émergence d’outils numériques dans les années 2000, mais ne peut-on pas dire que les NTIC seraient des sortes de catalyseurs ? Répondre à (...)
juin 2017
La nécessité de plus en plus présente des systèmes éducatifs de nombre de pays d’Afrique, de faire face à la massification scolaire, ainsi que les processus d’internationalisation de l’enseignement supérieur et de pénétration des technologies de l’information et de la communication en Afrique ont conduit à l’apparition de nouvelles formes d’enseignement à distance ces dernières décennies. Parmi ces innovations, les MOOCs comme l’Université Virtuelle Africaine ont déjà (...)
octobre 2018
Extrait de conclusion : "le pouvoir dans le numérique est un réseau de relations tout aussi complexe et diversifié que celui de la société disciplinaire. Les acteurs publics et privés y sont impliqués de la même manière, même si leurs intérêts sont parfois très différents. On peut plutôt reconnaître dans cette volonté le même type d’intentionnalité que décrit Foucault. Dans la mesure où les instruments d’exercice du pouvoir - en l’occurrence les technologies - et leurs (...)
août 2023
Machines en politique : Le rôle des technologies électorales dans les élections de 2017 au Kenya Extrait de conclusion : « Le jugement de la Cour Suprême a été un évènement unique dans l’histoire du pays et une gagne majeure pour la coalition à l’opposition. Toutefois, les allégations de hacking du système de transmission de résultats électoraux n’as pas été ni confirmé ni démenti. La Cour Suprême déclare que la désobéissance de la Commission Électorale à dispenser (...)
août 2023
Créé en 1987, Huawei a développé ses activités en Europe et Afrique à partir des années 2000s. Cependant, les soupçons de vols de propriétés intellectuelles et d’espionnages ainsi que le caractère « privé-étatique » de cette entreprise étroitement liée à l’État chinois suscitent des inquiétudes quant à son influence sur la sécurité des réseaux des télécommunications dans le monde, en particulier dans les pays occidentaux. L’introduction des réseaux 5G a intensifié ces (...)
août 2023
Ce mémoire a pour ambition de mesurer le poids des enjeux sécuritaires, juridiques et politiques que porte la vidéosurveillance algorithmique pendant les Jeux Olympiques et Pa-ralympiques de Paris 2024 en se demandant si ces derniers jouaient un rôle de catalyseur dans l’établissement et la normalisation de pratiques de surveillance renforcée par caméras en France. Nous avons constaté que la police et le gouvernement légitimisent l’installation ainsi que (...)
juin 2024
Le microciblage politique favorise la mise en place d’un cercle vicieux renforçant le capitalisme de surveillance : le capitalisme de surveillance fonctionne grâce à la collecte massive de données personnelles ; ces données, analysées par les logiciels de délégation, alimentent des modèles prédictifs ; ces modèles permettent un microciblage ultraprécis, utilisé à des fins politiques pour influencer les électeurs et remporter des élections. C’est un outil (...)
juin 2024
Analyse des implications des technologies de surveillance sur les migrants aux frontières européennes
Cette étude examine l’expansion de l’usage des technologies de surveillance dans le domaine des migrations en Europe et ses effets sur les migrants. En mobilisant le cadre théorique de la sécuritisation, elle démontre premièrement les raisons profondes et complexes derrière la perception des migrants comme des personnes à risque, y compris le rôle des technologies de surveillance dans la construction de cette perception. Cette recherche permet deuxièmement non (...)
juillet 2024
Synthèses
BRICS+ : Reconfigurations géopolitiques à l’aune du numériqueAnalyse transversale d’une tentative de contre-hégémonie numérique
Les relations internationales classiques adoptent un nouvel axe dans lequel s’inscrivent les démarches du BRICS cable. La situation actuelle mise en lumière par Edward Snowden démontre une certaine hégémonie des États-Unis et des firmes américaines sur ce capitalisme de surveillance. Cette hégémonie et les conséquences qu’elle implique pose donc la question des politiques publiques à mener pour les États afin de garantir leur contrôle du territoire de la (...)
avril 2024
Références
Sur « L’âge du capitalisme de surveillance » (2019) de Shoshana Zuboff et sa difficile réception
Cet article était, à l’origine, l’extrait d’un cours sur les dimensions numériques de la science politique donné en 2022 au Département de science politique (UFR 11) de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, destiné au format « Support de formation » dans la typologie documentaire des Cahiers Costech. Mais les commentaires de relecture m’ont amené à modifier largement les premières versions proposées à la revue et à introduire une hypothèse d’interprétation des (...)
août 2023
Lorsque Norbert Wiener, mathématicien, popularise en 1948, le terme de « cybernétique », c’est pour désigner une analogie : celle qui existe entre les modes de fonctionnement des êtres vivants et ceux des machines. Cette analogie interroge la recherche sur le vivant depuis ses origines, comme elle interroge, depuis ses origines aussi, la recherche technique. (...) Ce qu’on voudrait interroger ici, c’est la façon dont cette étroite relation entre recherche (...)
août 2023
Livres choisis
FRONTEX, LE SPECTRE DES DISPARU.E.SNihilisme politique aux frontières
Cet essai politico-philosophique ouvre la réflexion sur un nouveau nihilisme politique aux frontières : la torture, les morts, les disparus structurent des pratiques sécuritaires dangereuses. Il apporte des bases pour une nouvelle politique migratoire, du droit d’asile, du travail, des droits sociaux, des rapports de justice avec les pays d’origine et de transit des exilés d’une nouvelle Europe basée sur l’hospitalité politique, les droits fondamentaux, (...)
juillet 2024
Etudes
Protection des données personnelles et droit à la vie privée : enquête sur la notion controversée de donnée à caractère personnel
La menace qu’Internet et les technologies numériques de l’information et de la communication en général font ou feraient peser sur la vie privée soulève de nombreux débats, tant dans la presse qu’au niveau politique. L’affaire Snowden en 2013, puis l’adoption en 2016 du Règlement général de protection des données (RGPD), ont renforcé la visibilité de ces controverses dans l’espace public. Cette thèse part d’une triple interrogation : pouvons-nous définir ce qu’est la (...)
août 2023
Pourquoi financer le déploiement d’une technologie là où, faute d’infrastructures, celle-ci ne peut matériellement pas fonctionner correctement ? Si les objectifs avancés par la Banque mondiale, à l’origine du lancement de l’Université Virtuelle Africaine (UVA) en 1997, sont l’augmentation de l’accès à l’enseignement supérieur en Afrique couplée à des économies d’échelles, la question se pose de savoir quelle démocratisation est espérée lorsque le moyen qui doit la (...)
août 2023
Quand on se réfère au lourd passé du numérique universitaire en Afrique, on peut constater que les dynamiques d’appropriation aussi essentielles soient-elles, ne sont pas souvent associées au discours politiques et institutionnels. Pourtant bon nombre d’organisations internationales à l’image de la BM et de l’UNESCO continuent à promouvoir le numérique associé tantôt à des fins économiques tantôt à des aspirations démocratiques, sans s’interroger sur les véritables (...)
août 2023
Recensions
Vers une pédagogie numérique à l’université ? Compte-rendu et discussion de l’ouvrage « TIC et métiers de l’enseignement supérieur – Emergences, transformations » (nov. 2011)
Cette recherche aborde une dimension centrale de la vie universitaire où les injonctions à l’utilisation intensive des outils informatiques foisonnent, au rythme des innovations techniques, de la croissance de nouveaux services spécialisés, des effets de mode et des courants politiques internationaux… sans toujours être accompagnées de réflexions approfondies sur le métier et l’apport réel de ces outils à celui-ci. Ce travail devrait donc intéresser l’ensemble (...)
avril 2012
Sous la direction d’Éric Guichard, publié aux Presses de l’enssib, Lyon, coll. « Papiers », 2011, 138 p., ISBN : 9782910227708.
Présentation de l’éditeur : L’arrivée de l’internet fait figure de révolution : technologique, intellectuelle, idéologique, sociologique. Cet ouvrage a pour ambition de poser quelques jalons théoriques et historiques : l’internet est une technologie du « temps long », un des avatars des modes de calcul et de pensée connus en Mésopotamie, en Iran, et plus près de nous, de la machine à calculer de Turing ; comme l’imprimerie lors de son invention, l’arrivée de (...)
juillet 2012
« Industrialiser l’éducation » est une anthologie commentée dirigée par Pierre Moeglin et co-rédigée par 22 chercheurs ayant participé au Séminaire Industrialisation de la Formation (Sif). Cet ouvrage permet de découvrir une sélection de 21 auteurs ayant structuré le paradigme de l’industrialisation de l’éducation depuis le début du XXème siècle. Chaque auteur présenté est resitué dans son contexte permettant ainsi la mise en évidence des liens entre la recherche et la (...)
avril 2017
Cet ouvrage interroge la politisation/dépolitisation des organisations de femmes et féministes en contexte de mondialisation. Il explore des pistes africaines et en particulier l’Afrique du Sud et le Sénégal. Dépassant les notions de néolibéralisme et de « fracture numérique de genre », l’auteure s’intéresse, à travers les usages des TIC par lesdites organisations, aux facteurs de l’inhibition ou de la genèse de l’action politique et plus particulièrement aux (...)
août 2018
Collection SHS

Mobilités et mobilisations chinoises en France
Ya-han Chuang
Anne-Christine Trémon

TEXTE INTÉGRAL EN ACCÈS LIBRE
Terra-HN Éditions, Collection SHS, (V1) novembre 2020
Matthieu Renault
Pauline Vermeren
Hélène Le Dantec-Lowry
Marie-Jeanne Rossignol
Claire Parfait
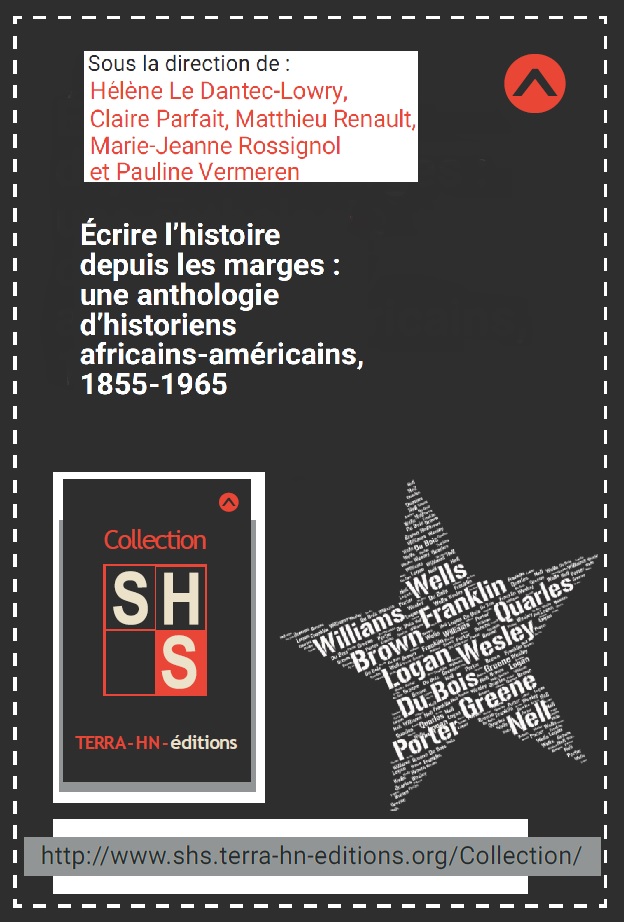
TEXTE INTÉGRAL EN ACCÈS LIBRE
Terra-HN Éditions, Collection SHS, (V1) juin 2018
Gaella Loiseau
Laurent Viala
Dominique Crozat
Marion Lièvre
Grégoire Cousin
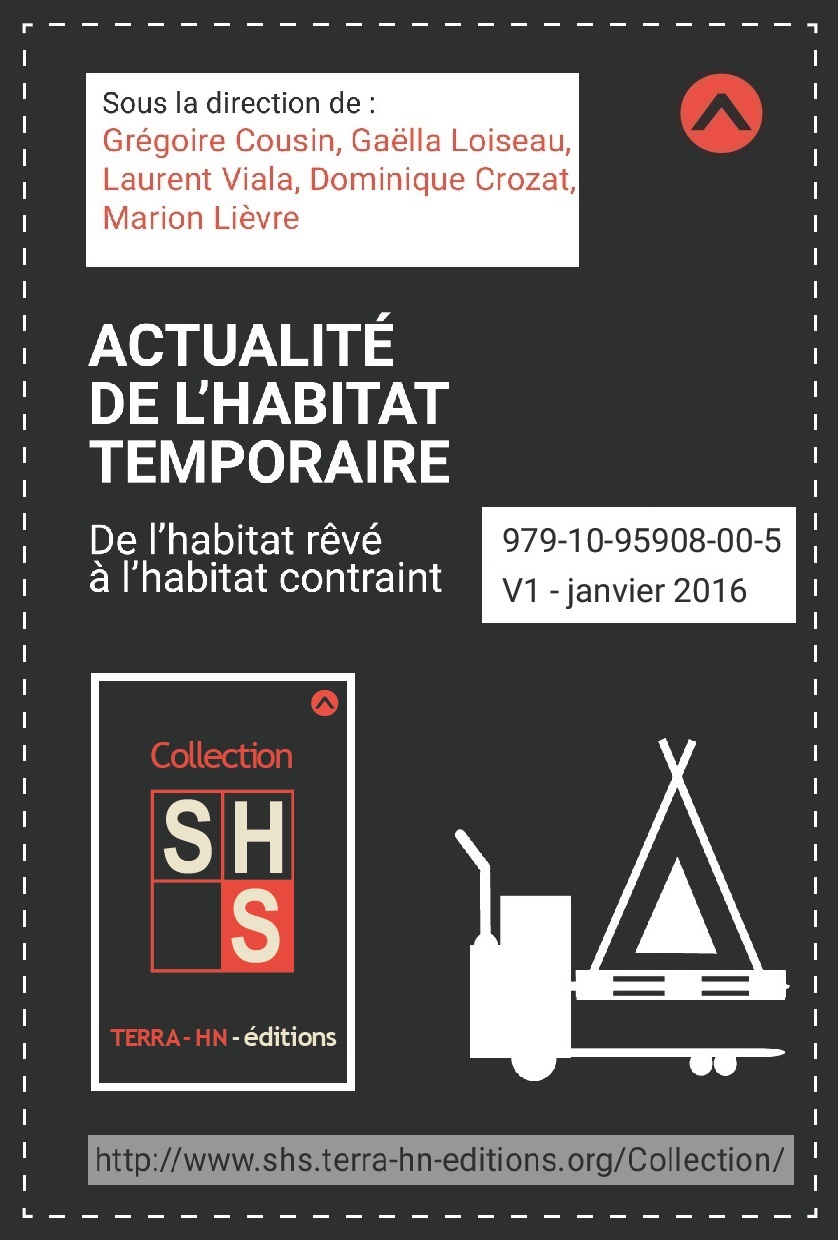
PUBLICATION WEB EN ACCÈS LIBRE
Terra-HN Éditions, Collection SHS, (V1) janv. 2016
et espace-temps
de la mobilité
Marc Bernardot
Arnaud Lemarchand
Catalina Santana
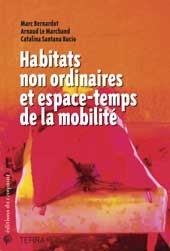
TEXTE INTÉGRAL EN ACCÈS LIBRE
Éditions du Croquant, Collection TERRA
novembre 2014
Patrick Bruneteaux
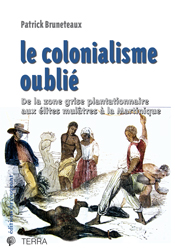
TEXTE INTÉGRAL EN ACCÈS LIBRE
Éditions du Croquant, Collection TERRA
mai 2013
Jim Cohen

TEXTE INTÉGRAL EN ACCÈS LIBRE
Éditions du Croquant, Collection TERRA
octobre 2012
Arnaud Lemarchand
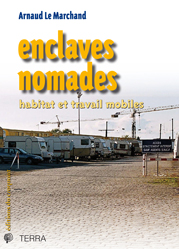
TEXTE INTÉGRAL EN ACCÈS LIBRE
Éditions du Croquant, Collection TERRA
septembre 2011
Carol Mann
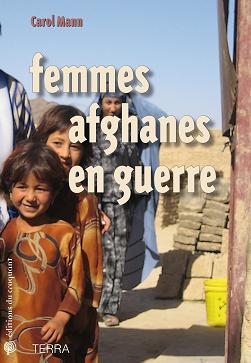
TEXTE INTÉGRAL EN ACCÈS LIBRE
Éditions du Croquant, Collection TERRA
octobre 2010
Patrick Bruneteaux
Daniel Terrolle
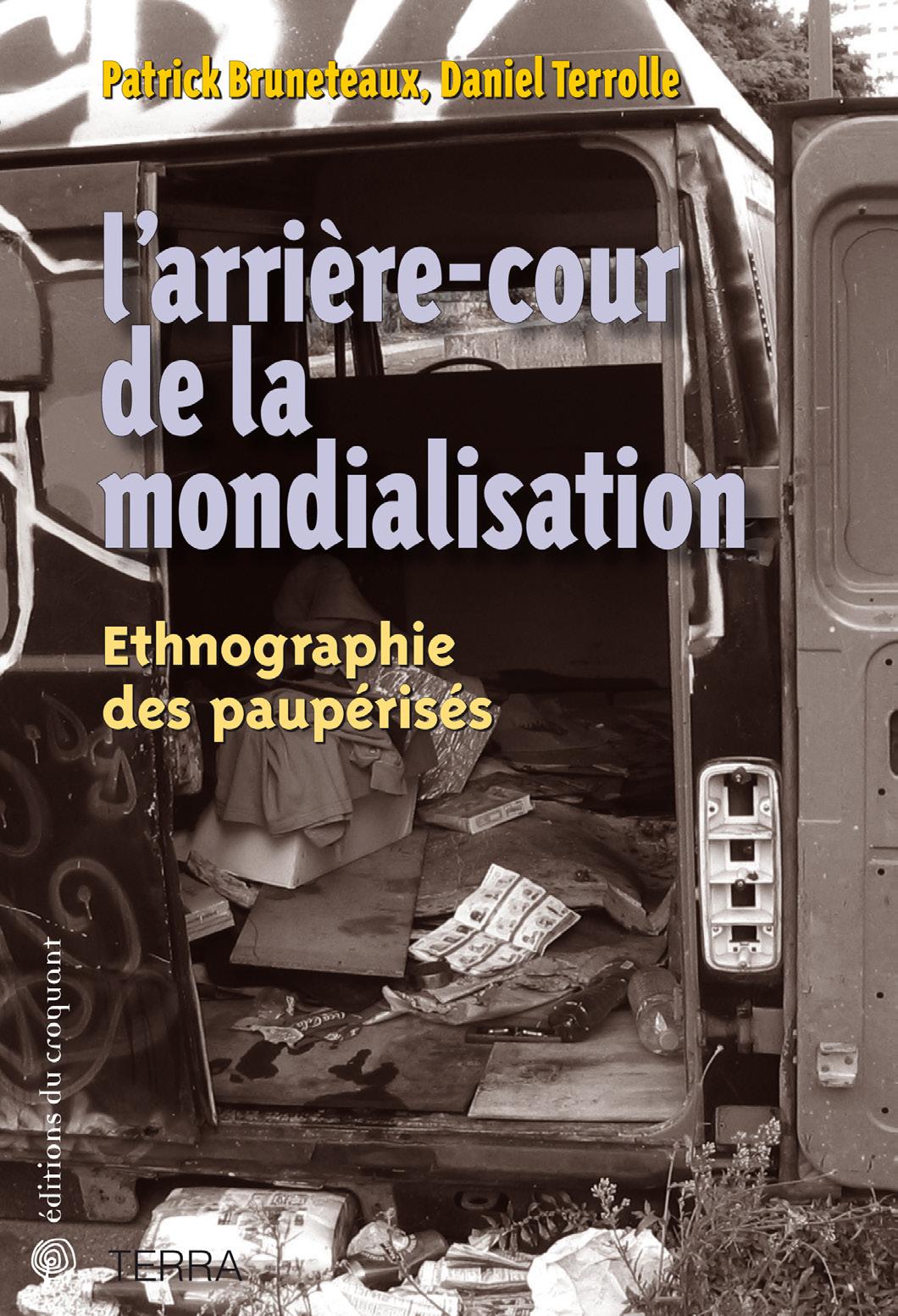
TEXTE INTÉGRAL EN ACCÈS LIBRE
Éditions du Croquant, Collection TERRA
septembre 2010
Hélène Thomas
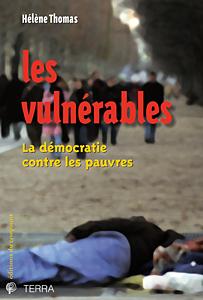
TEXTE INTÉGRAL EN ACCÈS LIBRE
Éditions du Croquant, Collection TERRA
février 2010
Julien Brachet
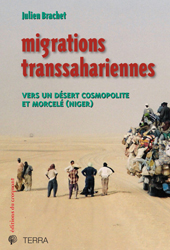
TEXTE INTÉGRAL EN ACCÈS LIBRE
Éditions du Croquant, Collection TERRA
novembre 2009
Carolina Kobelinsky
Chowra Makaremi
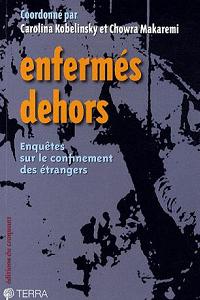
TEXTE INTÉGRAL EN ACCÈS LIBRE
Editions du Croquant, Collection TERRA
mars 2009
Jérôme Valluy
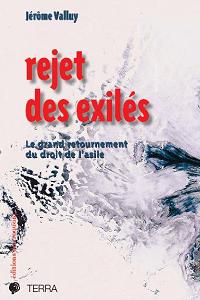
TEXTE INTÉGRAL EN ACCÈS LIBRE
Éditions du Croquant, Collection TERRA
janvier 2009
Marc Bernardot
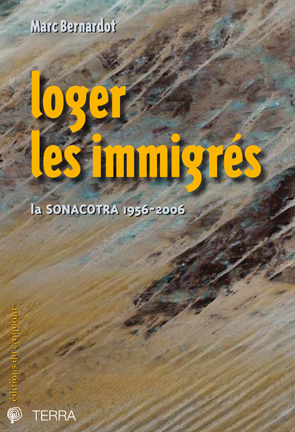
TEXTE INTÉGRAL EN ACCÈS LIBRE
Éditions du Croquant, Collection TERRA
octobre 2008
Marc Bernardot

TEXTE INTÉGRAL EN ACCÈS LIBRE
Editions du croquant, Collection TERRA
mars 2008
Jérôme Valluy
Jane Freedman
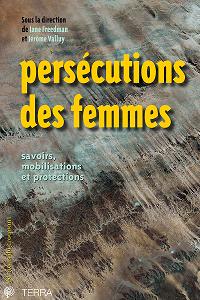
TEXTE INTÉGRAL EN ACCÈS LIBRE
Éditions du Croquant, Collection TERRA
novembre 2007
 Fil des publications
Fil des publications
