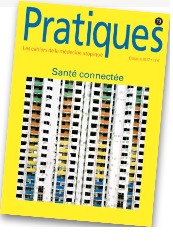août 2023
Christiane VollaireLa longue marche d’un clic
résumé
Lorsque Norbert Wiener, mathématicien, popularise en 1948, le terme de « cybernétique », c’est pour désigner une analogie : celle qui existe entre les modes de fonctionnement des êtres vivants et ceux des machines. Cette analogie interroge la recherche sur le vivant depuis ses origines, comme elle interroge, depuis ses origines aussi, la recherche technique. (...) Ce qu’on voudrait interroger ici, c’est la façon dont cette étroite relation entre recherche biologique et théorie de l’information, qui semblent pourtant deux domaines radicalement dissociés, produit des interactions qui peuvent éclairer le rapport quotidien à l’informatique, les satisfactions qu’il offre autant que les addictions qu’il génère. Les modes de manipulation qu’il produit, autant que son efficacité intellectuelle et sociale.
Mots clefs
à propos
Lorsque Norbert Wiener, mathématicien, popularise en 1948, le terme de « cybernétique », c’est pour désigner une analogie : celle qui existe entre les modes de fonctionnement des êtres vivants et ceux des machines. Cette analogie interroge la recherche sur le vivant depuis ses origines, comme elle interroge, depuis ses origines aussi, la recherche technique. Elle conduira en particulier Otto Schmitt, chercheur américain en ingénierie, à forger le concept de « biomimétisme » après la Deuxième Guerre mondiale, lorsqu’il fonde la Société de Génie biomédical au Massachussetts Institute of Technology. Le terme désigne la manière dont l’ingénierie technologique peut se modéliser sur le fonctionnement des êtres vivants pour créer des machines. À un stade simplement macroscopique, c’est le standard de l’invention de l’aviation à partir de l’observation des oiseaux. À un stade infinitésimal, c’est l’analyse des modes de fonctionnement du système nerveux pour déterminer le schématisme informatique. Et c’est l’ingénierie militaire, à laquelle Otto Schmitt est lié, qui en sera la première bénéficiaire. La notion inspirera aussi, dans son sens esthétique et écologique, les architectes et designers, comme le montre un ouvrage récemment paru [1].
Ce qu’on voudrait interroger ici, c’est la façon dont cette étroite relation entre recherche biologique et théorie de l’information, qui semblent pourtant deux domaines radicalement dissociés, produit des interactions qui peuvent éclairer le rapport quotidien à l’informatique, les satisfactions qu’il offre autant que les addictions qu’il génère. Les modes de manipulation qu’il produit, autant que son efficacité intellectuelle et sociale.
1. Forme et information
Son premier effet est l’accélération des processus, produisant des effets d’instantanéité. « En un clic » est le mode de relation qui constitue l’ordinaire de tout rapport à la mécanisation informatique, rendant l’écriture immédiatement lisible, le texte immédiatement transmissible, la correction immédiatement effective, sans le temps de latence de la rature, du remplacement d’une phrase par une autre, de l’interversion des paragraphes. Du projet à la réalité, du désir à son actualisation, il n’y a plus que le temps d’un clic. Et cette accélération de l’action est une des données majeures de la dynamique contemporaine, dans les formes les plus élémentaires ou sophistiquées de l’action / réaction. L’informatique produit d’abord de l’information, et l’information n’est pas prioritairement de la transmission. Elle est d’abord ce qui donne forme à la pensée elle-même : ce qui l’informe la fait, par là même, entrer dans une forme.
Dans sa thèse soutenue en 1958, le philosophe Gilbert Simondon écrivait :
La notion de forme doit être remplacée par celle d’information, qui suppose l’existence d’un système en état d’équilibre métastable pouvant s’individuer. [2]
La capacité de penser est ainsi conformée, configurée par ce rapport instantané à la construction informatique. Un potentiel de pensée va trouver sa forme et s’individualiser par la médiation d’un dispositif technique qui n’en est pas seulement le support, mais la condition. Autrement dit, la forme du dispositif informatique (et pas seulement le contenu des informations qu’il transmet) va contribuer à configurer la subjectivité de chacun : elle est elle-même un processus d’individuation, parce qu’elle nous fait entrer dans un nouveau régime de temporalité, et que c’est justement notre rapport au temps qui donne forme à notre pensée. Et cette accélération des procédures par la mécanique informatique se fait sur le modèle des connexions neuronales : on a bien là une forme de biomimétisme précisément pensé sur ce mode dans la création même de la technique informatique, c’est-à-dire de ce qu’on appelle, dans ses origines, la cybernétique. Et les effets générationnels de cette relation sont massifs : elle relève aussi d’un conditionnement neuronal dont la précocité détermine l’efficacité. C’est pourquoi les automatismes de pensée des générations nées dans l’informatique ne sont pas les mêmes que ceux des générations qui les ont précédées : le rapport à la machine est pour chacun étroitement connecté à son fonctionnement neurobiologique et aux acquis précoces qui le construisent.
Ces acquis générationnels qui informent l’histoire individuelle de chacun ont aussi une histoire collective : celle de la naissance de l’informatique, à la fois comme théorie, comme pratique, comme source d’invention technologique, comme reconfiguration des expériences collectives et comme mode de ce que Michel Foucault appellera « gouvernementalité ».
2. Une histoire de la cybernétique
Si l’on tente une histoire de la cybernétique, on peut en faire remonter les recherches à la plus haute Antiquité : la civilisation égyptienne avait inventé le principe de la clepsydre, instrument hydraulique qui servait à mesurer le temps par le débit de l’eau, et dont le contrôle supposait déjà des mécanismes rétroactifs qui en règlent la mémoire. Sur l’Acropole d’Athènes la fontaine sacrée était une clepsydre. Et dans l’œuvre de Platon le mot grec « kubernètikè » désignait l’art de gouverner les navires : le pilotage. Au XVIIème, Blaise Pascal avait mis au point la première machine à calculer (d’où les logiciels actuels qui portent son nom) ; et dès le XIXème, l’invention du métier à tisser de Jacquard, puis celle du contrôle de la machine à vapeur, relèveront d’une sorte de proto-cybernétique, tout autant, pourrait-on dire, que les cartes perforées qui règlent le son des orgues de Barbarie. En 1936, le mathématicien anglais Alan Turing invente un dispositif permettant la décomposition numérique d’un problème en vue de son traitement. Et c’est là que le terme de « numérique » prendra son sens contemporain.
Mais c’est pendant la Deuxième Guerre mondiale, en 1942, que la fondation Macy, fondation américaine d’aide dans le domaine de la santé, organise à New-York la première d’une série de rencontres interdisciplinaires intitulées Conférences Macy [3], qui aboutit à la publication en 1943 des articles regroupés sous le titre Comportement, intention et principe de finalité. À ces conférences participent des chercheurs en neurophysiologie, en mathématiques, en logique, en ingénierie, en psychanalyse, en anthropologie. Et c’est de ce brainstorming mêlant sciences exactes et sciences humaines, technologie et psychanalyse, que sortira le concept de « cybernétique », tel qu’il est forgé par Wiener en 1947.
Dès l’origine, cette configuration interdisciplinaire crée autant de convergences que de conflits entre sciences humaines et sciences exactes sur l’usage qui peut être fait des découvertes associant la technologie à la neurophysiologie. Et dans les années cinquante, Gregory Bateson, qui y a participé en tant qu’anthropologue, fondera en Californie l’École de Palo Alto, spécialisée dans l’étude de la schizophrénie, qui mettra en évidence le concept de « double bind » ou d’injonction paradoxale. La notion de double contrainte est corrélative des réflexions sur l’effet de « feed-back », qui irriguent autant la psychanalyse que les sciences physiques et la réflexion sociale.
La période de l’après-guerre devient ainsi un creuset où se prépare l’alchimie de ce qu’on appellera les « sciences cognitives », entre expérimentation psychologique, recherche neurobiologique, développements logico-mathématiques et constructions technologiques, autour de la fondation de la cybernétique. Et ce qu’on appelle désormais « capitalisme cognitif » [4] est bel et bien lié à cette informatisation de la société.
Mais on ne peut pour autant perdre de vue le sens que le physicien Ampère avait précédemment donné à ce mot en 1834 dans son Essai sur la philosophie des sciences : celui d’un art de gouverner, au sens politique du terme, selon son origine grecque. Entre les organismes neurobiologiques, les systèmes automatiques et les institutions humaines sont ainsi reconnues non pas seulement des analogies, mais de véritables liens d’interdépendance. Ils alimenteront largement l’imaginaire de science-fiction (chez Isaac Asimov en particulier, ou avec le concept de cyborg comme cyber-organisme), mais il sont aussi la source inépuisable d’une réalité : ce que Michel Foucault appellera des « technologies de pouvoir ». C’est parce qu’existent ces analogies, qu’existent aussi des processus de subjectivation qui font de l’objet technologique un outil véritablement addictif et manipulatoire, précisément parce qu’il a été conçu sur le modèle du fonctionnement du système nerveux.
De même, les recherches du XIXème siècle en médecine et en sciences physiques nourriront la réflexion cybernétique : recherches sur l’homeostasie (état d’équilibre dynamique de l’organisme), telles qu’elles ont été initiées par Claude Bernard, ou recherches sur l’entropie (loi de dégradation de la matière) issues de la thermodynamique.
3. Usages militaires, mise en réseau et gestion technocratique
Cette théorie de l’information issue de la recherche neurobiologique va désormais penser l’usage de la technologie sur le mode de la connexion, à la manière des synapses neuronales. L’immédiateté en devient le paradigme, et le réseau le mode de diffusion. Une technologie numérique ou digitale, fonctionnant sur le discontinu du chiffre [5], crée son continuum de façon réticulaire. Dans les années soixante, période de la Guerre froide, des chercheurs du Massachusetts Institute of Technology penseront l’informatique comme réseau de communication entre les chercheurs du Ministère de la Défense aux USA. Le réseau suppose ici le secret, la circulation sous-jacente de l’information. Les années soixante-dix verront en ce sens les premiers nœuds de réseaux informatiques et l’apparition du courrier électronique.
Mais ce sont les années quatre-vingt qui en constitueront l’extension à ce qu’on appelle « la société civile » : l’appellation Internet (interconnexion des réseaux) devient officielle en 1983, pour en désigner l’extension internationale, et, dans le même temps, l’ouverture au trafic commercial, à partir de la commercialisation, élaborée dans la rivalité entre Steve Jobs et Bill Gates, des technologies de l’ordinateur, et de leur diffusion par la miniaturisation. Et l’on sait que cette miniaturisation suppose non pas seulement des technologies de fabrication, mais une main d’œuvre dont le bas coût va paradoxalement de pair avec la spécialisation : c’est en Asie du Sud-Est qu’on en trouvera les conditions socio-économiques d’exploitation du travail, dans le temps où les modalités en seront réglées dans ce qui est devenu la « Silicon Valley » aux USA. La diffusion et la commercialisation de l’informatique hors de son champ militaire supposent la délocalisation du travail, dans son sens le plus politiquement désocialisant.
Les années quatre-vingt-dix voient l’apparition du web (dont la métaphore est éloquente, puisque le mot signifie « toile d’araignée »), créé par un informaticien anglais de la Recherche nucléaire. Et la capitalisation des noms de domaines du web dans les années quatre-vingt-dix donnera lieu à un krach boursier, signifiant l’étroite relation, dans la montée en puissance de l’abstraction numérique, entre l’informatisation du monde et sa financiarisation [6].
Très clairement, cette informatisation du monde, née de la technique anglo-saxonne, ne peut pas prétendre être assignée à une gouvernance étatique. Et elle représente bien, de ce point de vue, ce que Michel Foucault appelait « gouvernementalité ». C’est en ce sens qu’on peut interpréter la conférence qu’il donne, dès 1967, au Cercle d’études architecturales (et qui sera publiée en 1984 dans la revue Architecture, Mouvement, Continuité). Elle apparaît véritablement comme prémonitoire d’une société informatique en train de se construire dans ses effets de simultanéité :
L’époque actuelle serait peut-être plutôt l’époque de l’espace. Nous sommes à l’époque du simultané, nous sommes à l’époque de la juxtaposition, à l’époque du proche et du lointain, du côte à côte, du dispersé. [7]
Et il ajoute, décrivant précisément ce qui deviendra l’espace abstrait de la Toile, dans sa virtualité :
De nos jours, l’emplacement se substitue à l’étendue qui elle-même remplaçait la localisation. L’emplacement est défini par les relations de voisinage entre points ou éléments ; formellement, on peut les décrire comme des séries, des arbres, des treillis. D’autre part, on sait l’importance des problèmes d’emplacement dans la technique contemporaine : stockage de l’information ou des résultats partiels d’un calcul dans la mémoire d’une machine, circulation d’éléments discrets, à sortie aléatoire (comme tout simplement les automobiles, ou après tout les sons sur une ligne téléphonique), repérage d’éléments, marqués ou codés, à l’intérieur d’un ensemble. [8]
Mais les questions du codage de l’espace virtuel et du « stockage de l’information dans la mémoire d’une machine » rejoignent aussitôt celles de la gestion de l’espace réel, pensé en termes de stockage et de circulation des personnes. L’abstraction technologique est aussitôt envisagée dans ses effets sur une gestion technocratique des populations, et l’analogie en est éloquente :
D’une manière encore plus concrète, le problème de la place ou de l’emplacement se pose pour les hommes en termes de démographie. (…) C’est aussi le problème de savoir quelles relations de voisinage, quel type de stockage, de circulation, de repérage, de classement des éléments humains doivent être retenus de préférence dans telle ou telle situation pour venir à telle ou telle fin. Nous sommes à une époque où l’espace se donne à nous sous la forme de relations d’emplacements. [9]
Ainsi, dès 1967, en un temps où le terme d’informatique n’existe que depuis cinq ans, et où son usage technologique relève encore principalement des usages occultes de la défense militaire, Foucault en met les conséquences en relation avec le contrôle des populations, en des termes qui résonnent fort, actuellement, avec ceux de la gestion technocratique des politiques migratoires, autour de la question de l’ « emplacement ».
4. De la gouvernementalité et des effets de feed-back
Mais, dans un entretien avec le sociologue Howard Becker paru en 1984, Foucault dit :
Il me semble qu’il faut distinguer les relations de pouvoir comme jeux stratégiques entre des libertés (…) et les états de domination qui sont ce qu’on appelle d’ordinaire le pouvoir. (…) Dans mon analyse du pouvoir, il y a ces trois niveaux : les relations stratégiques, les techniques de gouvernement et les états de domination. [10]
Ce sont ces trois niveaux qu’il nous faut maintenant interroger. Car la gouvernementalité n’est pas seulement la manière dont les États gouvernent les populations, elle est aussi la manière dont les sujets se gouvernent eux-mêmes, et dont d’autres formes de pouvoir se substituant à celui de l’Etat, produisent des effets en retour sur cette gouvernementalité elle-même. Foucault écrivait déjà, en 1978, pour son cours au Collège de France Sécurité, territoire, population :
L’État n’est peut-être qu’une réalité composite, une abstraction mythifiée, dont l’importance est beaucoup plus réduite qu’on ne croit. Peut-être, ce qu’il y a d’important pour notre modernité, c’est-à-dire pour notre actualité, ce n’est pas l’étatisation de la société, c’est ce que j’appellerais plutôt la « gouvernementalisation » de l’État. [11]
Que signifie une telle distinction ? Elle signifie d’une part que la question du pouvoir n’est pas nécessairement celle de l’État, et que ce dernier est bien loin d’en avoir le monopole. Pour le meilleur et pour le pire, puisque l’ultralibéralisme contemporain donne l’exemple d’une destitution de l’État au profit de systèmes de gouvernementalité globalisés. Et Internet est précisément l’un des acteurs de cette destitution. De ce point de vue, les « états de domination » tels que les évoque Foucault sont d’autant plus puissants, violents et omniprésents qu’ils sont précisément désétatisés, comme le montrent les systèmes entrepreneuriaux de délocalisation, ou l’exemple emblématique de ce qu’on nomme « paradis fiscaux », échappant au contrôle étatique.
Mais la distinction opérée par Foucault signifie aussi le niveau des « jeux stratégiques entre les libertés ». La gouvernementalité n’est pas seulement la manière dont s’exerce un gouvernement. C’est aussi la manière dont se tissent des réseaux qui, dans le même temps où ils peuvent donner prise à ce gouvernement, sont aussi susceptibles de lui échapper. Le fait qu’il y ait gouvernementalité signifie non pas seulement que l’État n’a pas le monopole du pouvoir politique, mais que ce pouvoir ne peut pas être centralisé dans une commande unique. Si toute forme de pouvoir subjective les individus, c’est-à-dire les conditionne aussi bien physiquement que mentalement, cette subjectivation elle-même ne produit pas que de l’uniformité, mais ouvre au possible de la singularité, de même que toute éducation participe à la construction de ce qui va lui échapper. Une partie de la gouvernementalité relève de la domination (étatique ou globalisée), mais une autre relève des « jeux stratégiques entre les libertés », c’est-à-dire qu’il y a, dans toute forme de pouvoir, du « jeu » au sens mécanique du terme : ça bouge, ça vacille, ça grince, ça ne colle pas. Et ça produit des réactions. Là se trouvent désignés, entre autres, les effets-retour qu’Internet peut permettre, et la façon dont son instantanéité peut produire des formes de réactivité, ou de contournement brutal des pouvoirs comme on l’a vu, depuis les années deux mille, avec les affaires Assange et Snowden. Et sur ce point, la cybernétique, comme art du gouvernement, est aussi destitutrice de l’hégémonie. Si elle engage des formes d’homogénéisation de la pensée, elle suscite aussi des forces plurielles, dont les effets ne sont jamais prédictibles. La grande conférence Macy de 1947, qui a lancé le concept de cybernétique, s’intitulait Feedback mechanisms and circular causal systems in biological and social systems [12].
Foucault en annonçait les effets dans sa préface à L’Histoire de la sexualité :
Il m’a semblé qu’il fallait plutôt se tourner du côté des procédés du pouvoir. (…) Ce qui impliquait qu’on place au centre de l’analyse non le principe général de la loi, ni le mythe du pouvoir, mais les pratiques complexes et multiples d’une « gouvernementalité », qui suppose d’un côté des formes rationnelles, des procédures, techniques, des instrumentations à travers lesquelles elle s’exerce et, d’autre part, des jeux stratégiques qui rendent instables et réversibles les relations de pouvoir qu’elles doivent assurer. [13]
Que les relations de pouvoir soient « réversibles » nous dit très clairement que l’espace des « jeux stratégiques » ne doit pas être laissé aux nouvelles féodalités créées par la globalisation, mais qu’il peut être aussi investi par les mouvements solidaires permettant non pas seulement des résistances, mais des reconstructions de l’espace public. Un certain nombre de mouvements de revendication contemporains, dont l’ampleur a été potentialisée par la capacité de diffusion et de contournement d’internet (Occupy, Nuit debout, ou les multiples modalités des « printemps arabes ») en ont ouvert comme une amorce, et peuvent nous donner à repenser à nouveaux frais le concept foucaldien de gouvernementalité.
La technique informatique du piratage, celle des hackers, entre elle-même dans ce double régime : celui qui sert en sous-main les intérêts d’un pouvoir (à la manière de Jean Bart, « corsaire du roi ») et celui qui au contraire vient en dynamiter les bases. Elle peut servir une guerre technologique, mais aussi faire voler en éclat un système de contrôle. Elle peut étendre la toile d’araignée de la surveillance, mais aussi le rhizome de la vitalité solidaire, et renforcer ainsi l’énergie collective.
Dans un entretien de 1982, Foucault revenait sur ses propres analyses :
J’appelle « gouvernementalité » la rencontre entre les techniques de domination exercées sur les autres et les techniques de soi. J’ai peut-être trop insisté sur les techniques de domination et de pouvoir. Je m’intéresse de plus en plus à l’interaction qui s’opère entre soi et les autres. [14]
Ces interactions sont au cœur du rapport contemporain au pouvoir et à la solidarité. Si elles supposent une vigilance sans faille à l’égard des risques que la connexion fait courir aux libertés, elles nécessitent aussi une confiance dans les possibilités nouvelles de lutte offertes par l’outil informatique, qu’on ne peut ignorer. Diffuser une information alternative à celle des grands médias, appeler à un rassemblement, faire circuler une pétition, dénoncer les abus de pouvoir, susciter la colère, proposer de nouvelles voies ou d’autres pistes d’action, internationaliser les solidarités, sont des ambitions qui passent désormais par un outil qui, s’il est celui de la surveillance, peut devenir aussi celui de la revendication. Et de ces modalités contradictoires, il est désormais nécessaire de savoir jouer.
NOTES
[1] Manola Antonioli (dir), Biomimétisme, Loco, 2017.
[2] Gilbert Simondon, L’Individuation à la lumière des notions de forme et d’information, Millon, 2005, p. 35.
[3] Voir à ce sujet le livre de Jean-Pierre Dupuy Aux origines des sciences cognitives, La Découverte, 2013.
[4] Voir à ce sujet l’essai de Yann Moulier-Boutang Capitalisme cognitif : la nouvelle grande transformation, Amsterdam-Multitudes, 2007.
[5] Digital signifie, en anglais tiré du latin, le nombre qui se compte sur les doigts (digitus) d’une main.
[6] Une analyse en est faite par David Graeber dans son ouvrage La Bureaucratie, Les liens qui libèrent, 2015.
[7] Michel Foucault, « Des espaces autres », in Dits et écrits, Gallimard, 2001, t. II, p. 1571.
[8] Ibid.
[9] Ibid.p. 1572.
[10] Idem, « L’éthique du souci de soi comme pratique de la liberté », op. cit, p. 1547.
[11] Idem, « La gouvernementalité », op. cit., p. 656.
[12] Mécanismes d’effet-retour et systèmes de causalité circulaire dans les systèmes biologiques et sociaux.
[13] Michel Foucault, « Préface à l’histoire de la sexualité », op. cit., p. 1401.
[14] Michel Foucault, « Les techniques de soi », op. cit., p. 1604.
 Fil des publications
Fil des publications