Femmes afghanes en guerre
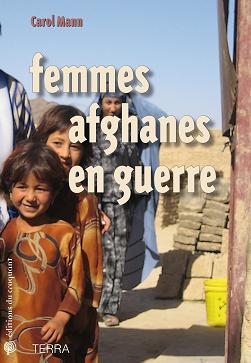
Éditions du Croquant, Collection TERRA
978-2-914968-81-2
| Commander en ligne |à lire sur Terra
TEXTE INTÉGRAL EN ACCÈS LIBRE
 Présentation de l’ouvrage par Marina Da Silva, dans Le Monde Diplomatique, mars 2011
Présentation de l’ouvrage par Marina Da Silva, dans Le Monde Diplomatique, mars 2011
 TEXTE INTÉGRAL EN ACCÈS LIBRE (version auteur non paginée)
TEXTE INTÉGRAL EN ACCÈS LIBRE (version auteur non paginée)
Présentation de l'éditeur
Le destin des femmes afghanes est au centre d’un certain discours politique depuis la destruction des tours jumelles à New York, le 11 septembre 2001 et l’invasion américaine de l’Afghanistan qui a suivi. Ultra-médiatisé, le sujet a cependant été très peu recherché par les sciences sociales. Cette étude critique, la première dans son genre, replace la vie des femmes afghanes dans leur contexte historique, social et ethnographique tout en tenant compte des changements tentés par divers gouvernements du début du xxe siècle jusqu’à aujourd’hui. Ce travail prend en compte les éléments de continuité et de transformations des femmes, surtout rurales, des camps de réfugiés jusque dans la province afghane aujourd’hui et permet d’évaluer l’influence véritable des multiples agents sur place : état de guerre chronique, programmes d’aide, stéréotypes démocratiques importés de l’Occident, l’Iran, brutales exigences de l’économie mondialisée. Et pourtant, les femmes subissent surtout la double influence de l’islam politique et de la tradition reconfigurée, ignorée tant par les chercheurs que les agences humanitaires. À elles de négocier une place au sein de ces multiples étaux, parfois au prix de leur propre existence. Ce livre résulte d’une longue étude de terrain (de 2001 à 2009) et d’un travail humanitaire avec des associations de femmes.
Mots clefs
Auteur :
Carol Mann est historienne de l’art et sociologue, spécialisée dans la problématique du genre et du conflit armé dont elle a contribué à initier l’étude en France, à partir de ses propres travaux, dès 1993, en Bosnie durant le siège de Sarajevo. Chercheure associée au SOAS à Londres, elle a créé, en 2000, l’association Femaid qui travaille avec des femmes en Afghanistan rural ; auteure d’études, de romans, et de nombreux articles, son dernier ouvrage paru est Femmes dans la guerre (1914-1939), chez Pygmalion en 2010.
Contact email : cmann@femaid.org
Sommaire
Introduction
![]() Du questionnement à l’ingérence
Du questionnement à l’ingérence
![]() L’observatrice observée : quelques éléments réflexifs
L’observatrice observée : quelques éléments réflexifs
![]() L’après-terrain
L’après-terrain
![]() Remettre les femmes au centre du récit des guerres
Remettre les femmes au centre du récit des guerres
Chapitre I - Un regard ethnographique sur l’Afghanistan rural
![]() La cité, la tribu et la question des origines
La cité, la tribu et la question des origines
L’invention d’une tradition
![]() L’élite à Kaboul aujourd’hui
L’élite à Kaboul aujourd’hui
![]() Droit coutumier et maintien identitaire
Droit coutumier et maintien identitaire
Droit coutumier dans le contexte de guerre contre l’URSS et les Etats-Unis
![]() Alliances matrimoniales dans le monde afghan
Alliances matrimoniales dans le monde afghan
![]() Le statut de l’enfance en Afghanistan
Le statut de l’enfance en Afghanistan
Chapitre II - Une modernité paradoxale : le statut de la femme dans la réalité afghane
![]() Les droits des femmes en Afghanistan
Les droits des femmes en Afghanistan
Les « féminisme colonial » comme prototype de progrès
Réformes royales
La République d’Afghanistan (1973-1978)
Le PDPA et la mise en place d’une gouvernement communiste en Afghanistan
La montée du fondamentalisme Afghan
Face à l’influence de l’occident
Le développement de l’islam politique
Dans les camps de réfugiés
La guerre civile et les conséquences pour les femmes
Les talibans et l’émirat islamique d’Afghanistan (1997-2001)
Mode, costume et politique
![]() Résister
Résister
Le unique de Rawa
Un criminel aveuglement occidental
Le statut des femmes depuis la chute des talibans
Chapitre III - Une anthropologie de la souffrance féminine en guerre
L’expression de l’émotion des femmes
Dans la culture des femmes afghanes
Culture populaire et expression de l’émotion
Stéréotypes et fantasmes
Le monde fantasmatique masculin : le cinéma de Pathane
Troisième, quatrième sexe
Culture populaire par temps de guerre et d’exil
Depuis la chute des talibans
Disruptions sociales en temps de guerre
Du malheur à la catastrophe, une étude de cas
Ruptures de guerre
La douleur de l’exil au camp de réfugiés et la compensation du Watan imagine
Aux frontières de l’inacceptable
![]() Souffrances du corps, souffrances de l’âme
Souffrances du corps, souffrances de l’âme
Souffrances du corps
Souffrances de l’âme
Chapitre IV - La vie quotidienne dans les camps de réfugiés
Une urbanisation du précaire
![]() Brève histoire de deux camps de réfugiés voisins
Brève histoire de deux camps de réfugiés voisins
Topogrraphie des camps
Circulation des hommes et des femmes à Khetwa
Naviguer dans l’espace public d’un camp de réfugiés
![]() La création d’un habitus féminin - Un espace sexué
La création d’un habitus féminin - Un espace sexué
Un espace masculin
Un habitus de guerre : créér un intérieur
Dans des conditions extrêmes
Décors, couleurs et costumes
La gestion du quotidien
Conclusion
Chapitre V - L’Afghanistan après les talibans
![]() Comprendre l’intervention américaine
Comprendre l’intervention américaine
![]() Une périphérie en Asie centrale ?
Une périphérie en Asie centrale ?
![]() Les PRT et les problèmes de reconstruction vus à partir de la province
Les PRT et les problèmes de reconstruction vus à partir de la province
![]() La vie reprend
La vie reprend
Construction d’écoles et illettrisme
Avoir 20 ans à Kaboul aujourd’hui
Au bout de huit ans, quel progrès ?
![]() À qui la faute ?
À qui la faute ?
Chapitre VI - Conclusion. Quel avenir pour les femmes d’Afghanistan ?
![]() Comment penser la notion de progrès dans le contexte afghan actuel
Comment penser la notion de progrès dans le contexte afghan actuel
![]() Une existence sans droits
Une violence illimitée contre les femmes
Une existence sans droits
Une violence illimitée contre les femmes
![]() Le suicide des jeunes filles afghanes
Le suicide des jeunes filles afghanes
![]() La prise de conscience des femmes pendant l’exil
La prise de conscience des femmes pendant l’exil
![]() Une impossible modernité : le modèle islamiste
Une impossible modernité : le modèle islamiste
![]() Les shahidé du monde traditionnel
Les shahidé du monde traditionnel
![]() Quel avenir pour les femmes afghanes ?
Quel avenir pour les femmes afghanes ?
Bibliographie raisonnée
![]() Le Pakistan, l’Inde, le Raj Britannique
Le Pakistan, l’Inde, le Raj Britannique
![]() L’Afghanistan
L’Afghanistan
![]() Pachtounes et Pathanes
Pachtounes et Pathanes
![]() L’Afghanistan en guerre et leurs réfugiés
L’Afghanistan en guerre et leurs réfugiés
![]() Femmes Afghanes en période de paix et de guerre
Femmes Afghanes en période de paix et de guerre
![]() Femmes et société islamique
Femmes et société islamique
Introduction
Mon bien-aimé, mon soleil, lève-toi sur l’horizon, efface mes nuits d’exil
Les ténèbres de la solitude me couvrent de toutes parts.
(Sayd Bahodine Majrouh, le Suicide et le Chant, Poésie populaire des femmes pachtounes Gallimard, Paris, 1994.)
Après la destruction des tours jumelles en septembre 2001 et le début des opérations militaires américaines un mois plus tard, les camps de réfugiés, oubliés depuis le retrait de l’armée soviétique d’Afghanistan en 1989, sont catapultés dans un même champ global qui relie une des cités les plus riches de la planète à un segment de sa population la plus misérable. L’opinion publique se tourne alors vers la situation des femmes sous le régime taliban, jusqu’ici critiqué principalement par des associations féministes occidentales. Aussitôt, la burqa est brandie sur tous les écrans comme une sorte de logo mondialisé d’une indistincte répression islamiste.
 Remplaçant l’icône musclée du « freedom-fighter » dans les médias populaires comme les cercles intellectuels des années 1980, une ombre bleue hante à présent tout discours sur l’Afghanistan, voire toute critique de l’islam. Le stéréotype orientaliste de la femme musulmane lascive dans son harem (ou son équivalent) est remplacé par une autre icône voilée, uniformément misérable d’un bout du monde islamique à l’autre. Entre surmédiatisation, propagande et désinformation, les femmes en Afghanistan sont prises dans une guerre sans perspective de fin, dans une des sociétés les plus brutalement patriarcales sur terre.
Remplaçant l’icône musclée du « freedom-fighter » dans les médias populaires comme les cercles intellectuels des années 1980, une ombre bleue hante à présent tout discours sur l’Afghanistan, voire toute critique de l’islam. Le stéréotype orientaliste de la femme musulmane lascive dans son harem (ou son équivalent) est remplacé par une autre icône voilée, uniformément misérable d’un bout du monde islamique à l’autre. Entre surmédiatisation, propagande et désinformation, les femmes en Afghanistan sont prises dans une guerre sans perspective de fin, dans une des sociétés les plus brutalement patriarcales sur terre.
Ma thèse de doctorat, qui est à l’origine de la présente recherche, a débuté à travers un travail humanitaire, entrepris en 2001, dans les camps de réfugiés afghans plus précisément au North Western Frontier, province du Pakistan, dans la région frontalière avec l’Afghanistan [1]. J’ai terminé ma thèse en 2005 et j’ai continué ma recherche en Afghanistan, surtout à Kaboul et à l’ouest du pays, près de la frontière iranienne. Le présent ouvrage, largement réécrit depuis la thèse, couvre cet ensemble, sur neuf ans de réflexion continue.
Au départ, je désirais répertorier les éléments de stabilité, de continuité, ainsi que les mécanismes de bouleversement et en même temps comprendre les effets d’une guerre moderne. Par les déplacements massifs, les interventions de troupes étrangères et des agences humanitaires, l’arrivée des médias de masse et l’économie d’urgence, la société afghane (comme d’autres dans le même cas) s’est trouvée catapultée dans un monde nouveau dont la violence s’ajoute à celle du conflit armé. Le contexte politique, en particulier la montée de l’islam politique né dans les camps de réfugiés et intégré dans une tradition pré-islamique est également d’une importance capitale dans la vie et les perspectives des femmes afghanes [2].
Si les réfugiées au Pakistan se référaient à l’exil, à l’éloignement, celles en Afghanistan ne peuvent que constater dans leur propre pays les ravages qui continuent à les priver de leur passé comme trop souvent de réelles perspectives d’avenir. La société pachtoune, majoritaire en Afghanistan, est du type segmentaire et un bon nombre de caractéristiques se retrouvent chez les Kabyles décrits par Germaine Tillion et Pierre Bourdieu. Les personnes interrogées dans le présent travail, principalement des femmes d’origine rurale, préfèrent se référer à une coutume prise dans un continuum idéal « c’est comme ça qu’on fait », à des souvenirs d’une vie qu’elles n’ont souvent pas connue, comme si elles puisaient dans leur « capital symbolique ». Les préceptes évoqués, jamais explicités sont tout à fait intégrés par les femmes qui en sont les vecteurs et souvent les victimes séculaires. Devant la perte de terrain et de prestige, la tradition laisse des repères, comme autant de crampons agrippés sur une falaise glissante, pour une société exilée cherchant à maintenir son honneur dans la mouvance de la guerre. Repères qui sont également des repaires pour des femmes démunies qui ont intériorisé des valeurs d’une communauté hyper-virilisée, quitte à en mourir. Les nouvelles expériences qui vont de l’alphabétisation jusqu’aux médias, en passant par les modifications dans les alliances matrimoniales sont réintégrées dans des schémas d’intelligibilité. Les valeurs de base, principalement la préservation de l’honneur du groupe, dominent tous les aspects de la vie jusqu’à la décision d’aller accoucher en milieu hospitalier aujourd’hui, comme nous le verrons. Des passerelles ont été jetées entre la religion et des pratiques pré-islamiques, souvent pour légitimer les aspects les plus brutaux de celles-ci, en particulier envers les femmes. C’est ainsi que fonctionne la justice actuelle, sous le règne de Karzai, en dépit d’une constitution supposément égalitaire. Pour reprendre la comparaison de Marc Augé, ces cultures travaillent comme du bois vert [3], constamment reformulées par l’irruption d’une modernité multiforme, tant par la politique internationale, la globalisation et une timide conception d’un destin individuel.

Bien entendu, il y a un avant et un après, même s’il y a continuité avec des façons de faire observées dans un village et un camp de réfugiés. Entre les deux se situent les épisodes les plus douloureux, le souvenir de la guerre, la dévastation, la perte des êtres chers, et le périple qui les a menés, famille par famille, jusqu’au camp, puis le retour au pays. L’intervalle des années, les heurts de la guerre ont introduit des cassures violentes nécessitant une recomposition parfois en profondeur. Celles qui sont nées en exil s’approprient par l’imaginaire ce passé idéalisé de loin ; cependant, la désillusion et la dureté des conditions en Afghanistan dominent le quotidien. Bien plus qu’en exil, les femmes vivent pleinement le présent. Toute dimension héroïque concernant le combat contre les Soviétiques est depuis longtemps évacuée du discours chez les femmes, n’en reste que l’amertume et la désolation, même si les vétérans se remémorent des moments de gloire. Les plus âgés comparent les présences soviétique et américaine, allant parfois jusqu’à regretter la première. De nombreuses femmes (surtout les veuves) se plaignent de dépression chronique, mais paraissent ne pas vouloir s’attarder sur ce passé trop douloureux, du moins quand elles sont avec leurs enfants dont le devenir reste leur priorité. Mais à présent, elles imaginent un avenir, sinon pour elles-mêmes, du moins pour leur progéniture.
 Cette vie rêvée comprend de longues études, l’acquisition d’une profession, des options nouvelles, liées à la présence des troupes d’occupation étrangères et surtout les grandes ONG qui sont devenues les principaux donneurs d’emploi dans les villes. Cependant, le manque d’infrastructures, le niveau catastrophique de l’éducation, l’extrême pauvreté de leur pays devenu le premier narco-État du monde ne permettent pas d’élaborer des plans à long terme. Mais, ces infatigables Pénélopes ravivent au quotidien ce fantasme d’un futur plus clément construit sur les cendres d’un passé évanoui : il arrive qu’elles soient plus ambitieuses pour leurs enfants que ne le sont leurs maris.
Cette vie rêvée comprend de longues études, l’acquisition d’une profession, des options nouvelles, liées à la présence des troupes d’occupation étrangères et surtout les grandes ONG qui sont devenues les principaux donneurs d’emploi dans les villes. Cependant, le manque d’infrastructures, le niveau catastrophique de l’éducation, l’extrême pauvreté de leur pays devenu le premier narco-État du monde ne permettent pas d’élaborer des plans à long terme. Mais, ces infatigables Pénélopes ravivent au quotidien ce fantasme d’un futur plus clément construit sur les cendres d’un passé évanoui : il arrive qu’elles soient plus ambitieuses pour leurs enfants que ne le sont leurs maris.
Peut-on donc parler d’une culture de guerre au féminin, même si les principales intéressées n’en ont pas conscience ? C’est ici qu’il faut répertorier des gestes infimes qui prennent une importance insoupçonnée, suivre la recommandation de Michel de Certeau : analyser les pratiques microbiennes, singulières et plurielles, qu’un système urbanistique devait gérer ou supprimer et qui survivent à son dépérissement [4]. C’est ce qui permet de restituer le courage et la détermination des femmes qui, à leur niveau, ne cessent de lutter pour leur dignité et la survie de leurs familles. Il s’agit, pour la chercheure, de mettre des mots à une série de non-dits implicites, cherchant une signification à la béance entre ce qui est raconté (les souvenirs ou les rêves d’avenir) et le vécu présent qui se passe de paroles, tellement il est fondé sur une action de survie continue. Comme un processus photographique, où une double signification émerge du tirage et de son négatif. Entendre à fois ce qui est dit et ce qui est tu.
L’accès à de pareils espaces pose de nombreux problèmes pour les chercheurs, mal perçus par des personnes en souffrance qui au mieux les prennent pour des journalistes. Les situations extrêmes que j’ai rencontrées ne m’ont pas autorisée à cultiver une attitude de détachement et de mise à distance généralement exigée par la recherche scientifique.
 Ces critères ne me semblaient pas applicables sur les terrains de guerre qui sont devenus les miens. L’humanitaire permet une forme d’échange, malgré tout. Dès le départ, j’ai voulu allier la recherche et une action pratique : plus qu’une excuse ou une tentative de déculpabilisation, il me semblait indécent de me positionner en tant que simple observatrice de situations à la limite de l’extrême et du supportable. Les camps afghans étaient en principe interdits aux personnes qui n’avaient pas de permis réglementaire délivré par les autorités, surtout les camps non-officiels comme Khewa. Après le début des opérations militaires américaines, il était quasiment impossible de voyager librement dans la région et les zones tribales étaient interdites. L’élément de danger n’était pas négligeable et a limité le temps passé dans certains camps tels que Jalozai, où de longs entretiens n’étaient pas possibles. C’est de façon illicite et anonyme qu’il a souvent fallu circuler dans la région, de préférence avec un accompagnateur armé. Le travail humanitaire à cette époque avec RAWA, une organisation clandestine [5], m’a permis de séjourner dans le camp de Khewa à cinq reprises et d’en visiter d’autres, en particulier celui, voisin, Sharwali, véritable ambassade des talibans de l’époque qui, évidemment aurait été totalement inaccessible dans d’autres conditions. J’avais suivi une démarche comparable pour mon terrain précédent, en Bosnie, pendant la guerre (1992-1995). Quand je suis allée à Sarajevo pendant le siège (ce qui aboutit à la reconstruction d’une école et à un DEA en sociologie sur la survie des femmes [6]), il paraissait difficile d’arriver dans un lieu où les obus tombaient jour et nuit dans un contexte de souffrance continue, pour simplement prendre des informations qui m’étaient utiles sans offrir quelque chose en échange, en guise de reconnaissance symbolique des malheurs inouïs qui m’étaient contés. Peut-on simplement rédiger des notes devant la mère dont l’enfant vient d’être tué par un sniper, devant la femme afghane qui a tenté de s’immoler pour échapper à un mari violent ?
Ces critères ne me semblaient pas applicables sur les terrains de guerre qui sont devenus les miens. L’humanitaire permet une forme d’échange, malgré tout. Dès le départ, j’ai voulu allier la recherche et une action pratique : plus qu’une excuse ou une tentative de déculpabilisation, il me semblait indécent de me positionner en tant que simple observatrice de situations à la limite de l’extrême et du supportable. Les camps afghans étaient en principe interdits aux personnes qui n’avaient pas de permis réglementaire délivré par les autorités, surtout les camps non-officiels comme Khewa. Après le début des opérations militaires américaines, il était quasiment impossible de voyager librement dans la région et les zones tribales étaient interdites. L’élément de danger n’était pas négligeable et a limité le temps passé dans certains camps tels que Jalozai, où de longs entretiens n’étaient pas possibles. C’est de façon illicite et anonyme qu’il a souvent fallu circuler dans la région, de préférence avec un accompagnateur armé. Le travail humanitaire à cette époque avec RAWA, une organisation clandestine [5], m’a permis de séjourner dans le camp de Khewa à cinq reprises et d’en visiter d’autres, en particulier celui, voisin, Sharwali, véritable ambassade des talibans de l’époque qui, évidemment aurait été totalement inaccessible dans d’autres conditions. J’avais suivi une démarche comparable pour mon terrain précédent, en Bosnie, pendant la guerre (1992-1995). Quand je suis allée à Sarajevo pendant le siège (ce qui aboutit à la reconstruction d’une école et à un DEA en sociologie sur la survie des femmes [6]), il paraissait difficile d’arriver dans un lieu où les obus tombaient jour et nuit dans un contexte de souffrance continue, pour simplement prendre des informations qui m’étaient utiles sans offrir quelque chose en échange, en guise de reconnaissance symbolique des malheurs inouïs qui m’étaient contés. Peut-on simplement rédiger des notes devant la mère dont l’enfant vient d’être tué par un sniper, devant la femme afghane qui a tenté de s’immoler pour échapper à un mari violent ?
 En vérité, dans le cas de la Bosnie, le travail humanitaire a été le moteur pour reprendre mes études afin de comprendre et rationaliser un tant soit peu ce que je pouvais observer en direct. C’est à ce moment-là, que j’ai voulu entreprendre un champ quasiment nouveau, soit l’étude de genre et conflit armé, non pas à distance historique ou géographique, mais en plein dans une situation de guerre.
En vérité, dans le cas de la Bosnie, le travail humanitaire a été le moteur pour reprendre mes études afin de comprendre et rationaliser un tant soit peu ce que je pouvais observer en direct. C’est à ce moment-là, que j’ai voulu entreprendre un champ quasiment nouveau, soit l’étude de genre et conflit armé, non pas à distance historique ou géographique, mais en plein dans une situation de guerre.
J’ai créé des associations loi 1901 à Paris, d’abord « Enfants de Bosnie » puis, pour l’Afghanistan, « Femaid [7] ».
 Ma collaboration, dans les deux cas avec des associations de femmes de terrain a servi de carte de visite, sinon d’alibi, et m’a permis d’éviter la méfiance et la suspicion qui peuvent naître dans ces contextes de guerre, très politisés. Dans les contrées frontalières du Pakistan (au NWFP et au Balouchistan) et en Afghanistan, cette façon de faire m’a permis de voyager dans des régions où parfois aucune instance étrangère ne s’était rendue, traversant au besoin des frontières de manière clandestine, mais toujours sous l’œil vigilant de mes associées locales auxquelles je dois le présent ouvrage, et il faut le dire, dans certains cas, ma survie.
Ma collaboration, dans les deux cas avec des associations de femmes de terrain a servi de carte de visite, sinon d’alibi, et m’a permis d’éviter la méfiance et la suspicion qui peuvent naître dans ces contextes de guerre, très politisés. Dans les contrées frontalières du Pakistan (au NWFP et au Balouchistan) et en Afghanistan, cette façon de faire m’a permis de voyager dans des régions où parfois aucune instance étrangère ne s’était rendue, traversant au besoin des frontières de manière clandestine, mais toujours sous l’œil vigilant de mes associées locales auxquelles je dois le présent ouvrage, et il faut le dire, dans certains cas, ma survie.
Le travail humanitaire est utile à la recherche en sciences sociales parce qu’on est souvent confronté au réel des situations d’urgence et aux façons locales de chercher des solutions tout à fait en dehors d’un discours lénifiant ou d’une éventuelle mise en scène. Bien entendu, et on me l’a reproché, un pareil positionnement entraîne une vision fatalement pessimiste et négative de quasiment toute situation, puisque c’est la seule qui nous est donnée à voir. Je tiens à préciser que sur la durée, mon expérience s’est élargie : j’ai pu contempler d’autres choses que des conjonctures désespérées, celles, plus joyeuses, qui jaillissent dans les rares interstices d’une situation qui demeure néanmoins globalement dominée par les effets d’une guerre discontinue. Dans de nombreuses configurations rencontrées, les relations familiales et amicales ont été empreintes d’une chaleur exceptionnelle. Depuis la chute des talibans, de nouvelles opportunités pour les jeunes filles, éducatives, professionnelles ont émergé et celles qui ont su en profiter le font avec une ténacité et une imagination admirables. J’ai voulu néanmoins proposer un contexte historique : sous le régime du dernier roi Zaher Shah, puis surtout celui de Daoud et sans oublier les années communistes, bien plus de femmes encore furent actives dans l’espace public. Près de la moitié du fonctionnariat était féminin, comme nous le verrons au chapitre III. L’Afghanistan n’a pas attendu l’intervention américaine pour découvrir le monde moderne et les droits humains.
Les informations collectées pendant près de neuf ans présentent une cohérence et une continuité qui me sont apparues rapidement. Dans ma première recherche, j’avais constaté que ces camps de réfugiés étaient devenus de véritables villages afghans. D’une certaine façon, l’Afghanistan s’étendait alors jusqu’à ces structures, puisqu’une importante partie de sa population exilée y habitait, dans un contexte culturel quasiment identique. La Durand Line, qui forme depuis l’Empire britannique une frontière dans la région montagneuse du Khyber Pass, a toujours constitué une démarcation extrêmement poreuse et tout à fait artificielle. Comme nous le verrons plus en détail, c’est la même population qui habite des deux côtés, dénommée pachtoune en Afghanistan et pathane sur le versant pakistanais, unis par la même langue et les mêmes traditions. Les militants du Pakhtunkhwa, du Pachtounistan, soutiennent pour ces raisons la réunification de cette région avec son versant afghan. Les trois millions et demi de réfugiés qui ont traversé cette frontière pour s’y installer à partir de l’intervention soviétique (décembre 1979) n’avaient pas l’impression d’être que des réfugiés. À 80 % pachtounes, partageant la langue, la culture et le mode de vie des habitants de l’autre côté de la ligne Durand, ceux du Sud particulièrement se considéraient comme des déplacés internes ayant migré vers une autre partie du territoire pachtoune [8]. La plupart avaient franchi la frontière sans être inquiétés pour des papiers ; sauf quand celle-ci est fermée par les instances pakistanaises, la traversée à Torkham au Khyber Pass se fait le plus souvent sans contrôle ni vérification, tout le contraire de l’Iran où le passage est sévèrement réglementé. La vie dans les camps, tout en étant semblable à celle des villages alentour, n’était pas identique, à cause des pertes et de la misère consécutives à la guerre et à l’exil. Entre autres, des mécanismes de compensation symbolique se sont mis en place : une nouvelle rigueur et un traditionalisme exacerbé ont été appliqués à l’égard des femmes, d’autant renforcés par la perte de territoire. Néanmoins, les transformations, dues à la guerre, à l’aide humanitaire, à l’influence de la société de consommation, des médias, ont également eu lieu et seront répertoriées. De plus, la vie dans les camps de réfugiés a constitué un formidable laboratoire où les formes politiques et sociales ont été expérimentées, puis exportées vers Kaboul, côte à côte avec la présence et l’influence de l’Occident. À partir de la guerre civile et la domination des instances de pouvoir par une forme particulière d’islam politique, quasiment toute la riche culture afghane, qui comprenait une tradition religieuse souple, teintée de mysticisme, a disparu. Le pays décrit amoureusement par Pierre et Micheline Centlivres et Louis et Nancy Dupree évoque un conte de fée : peut-on imaginer une région qui n’aurait pas été bouleversée par la guerre et qui ressemblerait encore à ces magnifiques descriptions ?
 L’ensemble décrit dans les deux premiers chapitres, recouvrant les considérations ethnographiques et historiques, compose l’habitus des deux générations qui ont vécu dans ce contexte de guerre et d’exil : si 30 ans constituent une génération en Occident, dans un pays où l’on ne vit pas, en moyenne au-delà de 42 ans et où la plupart des primipares accouchent avant 18 ans, la durée a une autre valeur. J’ai choisi de parler surtout des femmes du monde rural, univers peu exploré depuis la guerre, avec quelques références à leurs contemporaines à Kaboul.
L’ensemble décrit dans les deux premiers chapitres, recouvrant les considérations ethnographiques et historiques, compose l’habitus des deux générations qui ont vécu dans ce contexte de guerre et d’exil : si 30 ans constituent une génération en Occident, dans un pays où l’on ne vit pas, en moyenne au-delà de 42 ans et où la plupart des primipares accouchent avant 18 ans, la durée a une autre valeur. J’ai choisi de parler surtout des femmes du monde rural, univers peu exploré depuis la guerre, avec quelques références à leurs contemporaines à Kaboul.
 Certes leur existence n’est pas identique partout, ce n’est pas un monolithe uniforme que j’ai voulu décrire. Cependant, si une variété de destins est envisageable en milieu urbain, ce n’est pas tout à fait le cas dans les zones rurales où, par classe d’âge et degré de confort matériel, les expériences se ressemblent singulièrement. Si la vie d’une femme, mère de fils adultes, relativement prospère, peut être satisfaisante, c’est rarement le cas de sa plus jeune bru, nouvellement arrivée dans la maisonnée qui n’a pas encore mis d’enfant au monde. Si de plus, comme dans la plupart des foyers, la misère est tenace, ce seront les petites filles de la famille qui en souffriront le plus. Nous y viendrons.
Certes leur existence n’est pas identique partout, ce n’est pas un monolithe uniforme que j’ai voulu décrire. Cependant, si une variété de destins est envisageable en milieu urbain, ce n’est pas tout à fait le cas dans les zones rurales où, par classe d’âge et degré de confort matériel, les expériences se ressemblent singulièrement. Si la vie d’une femme, mère de fils adultes, relativement prospère, peut être satisfaisante, c’est rarement le cas de sa plus jeune bru, nouvellement arrivée dans la maisonnée qui n’a pas encore mis d’enfant au monde. Si de plus, comme dans la plupart des foyers, la misère est tenace, ce seront les petites filles de la famille qui en souffriront le plus. Nous y viendrons.
Que ce soit dans les camps au Pakistan ou aujourd’hui en Afghanistan, il subsiste une condition chronique de guerre larvée : ce que Hobbes appelle un état de nature… la guerre de chacun contre chacun qui provient surtout, comme il le dit, de l’absence d’État, d’intérêts communs et partagés qui vont au-delà des priorités personnelles ou au mieux claniques.
Du questionnement à l’ingérence
Les projets d’aide sur lesquels mon association a travaillé sont multiples et m’ont permis chaque fois de voir un autre aspect de la situation. La mise en place d’un orphelinat à Peshawar, par exemple, a été à l’origine de ma réflexion sur l’enfance. La rencontre avec une fillette nouvellement sauvée de la rue, les cheveux coupés courts comme un garçon, afin de travailler dehors – comme dans le film Osama [9], m’a beaucoup appris sur la vie des plus pauvres. Cette gamine, comme d’autres autour d’elles, avait un retard de croissance d’au moins deux ans. Incrédule, j’ai vérifié plus d’une fois leur âge en examinant leurs dents. De plus, ces fillettes étaient affamées et, pendant les premières semaines de leur séjour, dérobaient la nourriture systématiquement à l’intérieur de l’orphelinat. Certes la population afghane rurale a toujours été pauvre, mais la guerre a apporté la misère véritable, scindant les familles de façon brutale. De même que c’est à l’hôpital de Hérat, dans le département des grands brûlés, où des jeunes filles croupissent dans des conditions d’hygiène pour le moins douteuses, sans avoir droit à des analgésiques forts, que j’ai rencontré les premières victimes des tentatives de suicide par le feu.
Mon association, Femaid, étant totalement indépendante et non affiliée, ne bénéficie pas de soutien institutionnel régulier. Si les donateurs étaient généreux dans les premières années suivant les événements du 11 septembre 2001, ce n’était plus le cas après la crise en Europe et avec la forte concurrence des malheurs simultanés. J’ai donc dû restreindre mes champs d’aide à ce qui me préoccupait le plus, l’instruction des filles et surtout la mortalité maternelle avec son pendant infantile. Dans ma recherche, ce qui me troublait et continue à me troubler c’était la poursuite de cette hécatombe en dépit des milliards investis. Certes, les décès qui ont lieu loin de toute structure hospitalière peuvent à la limite être attribués à des raisons logiques, mais comment évaluer ceux qui se produisent près des hôpitaux ? Les grands organismes humanitaires refusent de prendre en compte les blocages culturels, qui s’enracinent dans les façons de faire et l’histoire du pays. Ceux-ci sont réellement à l’origine de ce refus de dépossession que constitue une hospitalisation pour la société rurale, en particulier pour l’accouchement. J’ose espérer que le présent ouvrage contribuera à dessiller les yeux des agences humanitaires, tout à fait ignorantes des facteurs ethnographiques pourtant dominants. Toutefois, depuis le temps que je vais les voir, et que j’écris délibérément des articles dans une presse non-universitaire, je commence à soupçonner une volonté de tout formater, de tout standardiser selon des schémas globalisés, anonymes. Même l’Empire britannique aux Indes britanniques, sur lequel je reviendrai, a agi de façon plus intelligente et sensible : ses officiers ont appris le hindi et le pachtou et étudié de près les cultures locales. Les agences humanitaires (à la différence des services de renseignement mieux dotés) n’imagineraient même pas mettre en place de pareils programmes pour leurs employés.
Aujourd’hui, après neuf ans de présence militaire étrangère, un très important programme d’aide financé par 60 pays, comme nous le verrons, l’Afghanistan pulvérise plusieurs records mondiaux. Les mortalités maternelle et infantile sont les plus élevées sur terre [10]. C’est le premier pays producteur d’opium et aussi de hashish. Il est permis de poser quelques questions pour lesquelles les sciences sociales pourraient apporter des éléments de réponse.
L’observatrice observée : quelques éléments réflexifs
Dans les zones de guerre, sur lesquelles les sciences sociales se penchent rarement, les personnes sur place ne pensent pas que des intervenants peuvent avoir les moyens d’agir en dehors de l’aide, ou que le journalisme puisse servir leur cause, et les imaginent toujours grassement payés par les institutions censées les employer. La présence sur le terrain afghan d’un chercheur universitaire, qui plus est d’une chercheuse, voyageant à ses propres frais, est quasiment inconcevable et exige de longues explications. De plus, au Pakistan, une femme active dans le caritatif ou dans l’éducation à haut niveau appartient nécessairement à la grande bourgeoisie et elle est donc riche, même si ces dames patronnesses ne se déplacent jamais sur le terrain, à moins de rendre visite à des parents en province, ce qui fait qu’une activité comme la mienne est aussi incompréhensible dans un élégant salon de Lahore que dans une hutte en boue d’un camp de réfugiés. La même chose se passe à Kaboul aujourd’hui : à cause des consignes draconiennes de sécurité onusiennes, leurs employés n’ont pas le droit de quitter leur bureau et parfois même pas leur appartement. C’est ainsi que des projets se mettent en place sans la moindre consultation avec les principaux intéressés : l’échec de pareilles entreprises devient patent.
Sur le terrain, le rapport n’est initialement simple qu’à cause de l’attente discrète ou manifeste d’une action concrète de la part de beaucoup des personnes interrogées qui colore fatalement leur récit. Quand la première rencontre est suivie d’autres (contrairement à ce qui se passait avec les intervenants extérieurs habituels), une relation plus désintéressée peut s’installer où des échanges véritables deviennent possibles.
Les premières demandes sont parfois exorbitantes, mais jamais insistantes, voire parfois inexistantes. Les sympathisants des talibans aux camps de Sharwali ou Kobobian ne s’attendaient nullement à ce que mon association participe à la construction d’une école de filles ou d’un orphelinat, que nous réalisions dans le camp voisin ; ces hommes étaient politiquement le plus à l’opposé de tout ce que je représentais mais se sont montrés, in fine, les plus désintéressés. Les hommes de Sharwali, auprès de qui je ne pouvais me rendre qu’accompagnée d’un interprète/garde masculin, me considéraient comme une espèce à peu près masculine, le fait d’être étrangère et non-musulmane leur épargnant toutes les restrictions normalement associées au contact avec des femmes. Si, devant eux, j’étais considérée comme un homme, c’est parce que je suis une femme qu’ils autorisaient ma rencontre avec celles de leur famille. De plus, être mariée, mère de deux enfants et plus très jeune, me conférait d’emblée une certaine respectabilité. Mes propres origines m’avaient légué une certaine façon de bouger, une relation corporelle spontanée avec les autres femmes et les enfants, ainsi qu’un sens instinctif de la pudeur qui ont contribué à me rapprocher de mes interlocutrices, même avant de maîtriser les premiers rudiments de pachtou et de dari. Le physique de la chercheure a son importance : c’est ainsi que ma jeune amie et assistante Zala m’a dit un jour, voulant me flatter : Mais khala (tante) Carol, tu es peut-être vieille, mais tu es blanche et grosse, tu peux facilement encore te trouver un mari chez nous, tu pourrais au moins devenir la troisième épouse de quelqu’un de tout à fait convenable !
Pour les jeunes dont je me suis rapprochée, je suis devenue « khala », la tante assimilée à la sœur de la mère. Il était inconcevable pour eux de m’appeler simplement par mon prénom et, par ma proximité physique et les liens d’intimité, je ne pouvais qu’occuper un rôle familial. En Europe aussi, et je m’en souviens, les enfants faisaient de même pour les amis des parents.
Dans un pareil contexte, la question s’est posée de la légitimité d’une démarche critique. Le fait d’être une femme enquêtant sur d’autres femmes permet un accès privilégié à des domaines intimes interdits aux hommes, mais autorise-il la prise de parole au nom des femmes rencontrées ? Peut-on revendiquer des droits humains pour une population qui n’en a guère conscience ? Cette approche appelle aisément la critique, comme l’a fait remarquer Nicole-Claude Mathieu, répondant aux attaques de ses collègues : des ethnologues et aussi certaines femmes du tiers-monde (disent) que les analyses féministes occidentales en anthropologie ne sont qu’une projection de « nos » contestations, un nouvel avatar de l’impérialisme [11].
Lila Abu-Lughod, dans un essai célèbre, « Do Muslim Women need saving ? », dont le titre résume ce qui est devenu une véritable polémique, nous dit que les missionnaires, ces féministes libérales […] se perçoivent comme un groupe éclairé, doté de la lucidité et de la liberté nécessaires pour aider les femmes en souffrance d’autres contrées à bénéficier de leurs droits », et que ces projets occidentaux se fondent sur leur sentiment de supériorité et le renforcent en retour [12].
Est-il possible de réagir, de mener une recherche en sciences sociales à la fois engagée et dépourvue de prétentions, même en tant que féministe sans doute libérale mais pas forcément intolérante ? Sur de pareils terrains, dont l’accès est à la fois difficile, dangereux et propre à susciter les critiques les plus acerbes, mon engagement humaniste et féministe est le fondement de la recherche que j’ai entreprise dès le début de mes études à l’EHESS, en commençant par mon premier terrain pendant le siège de Sarajevo. L’éthique qui sert de référence est résumée par Michelle Olivier et Manon Tremblay : À la séparation radicale entre objet et sujet de recherche, la recherche féministe oppose la notion d’engagement personnel de la chercheuse envers son objet de recherche, engagement théorique envers une perspective féministe, engagement pratique pour une transformation des rapports sociaux [13].
Néanmoins, il a fallu être vigilant à ce que cette attitude permette un mode d’écoute ouvert sans servir de grille d’analyse exclusive et réductrice ; de même qu’il a fallu négocier avec la compassion à l’origine du travail humanitaire qui mène à des propositions spontanées de solutions pratiques aux problèmes présentés par les informatrices. Il est certain que l’identification mutuelle propre à des rencontres entre femmes ayant des expériences de vie semblables facilite le contact entre êtres issus des cultures les plus différentes, bien plus que pour les hommes. De plus, partout au monde, les conversations spontanées entre mères de famille qui ne se connaissent pas vont souvent vers l’échange d’opinions et de conseils. Mais cette identification et cette projection mutuelles ne sont pas suffisantes pour comprendre. Dans le domaine de l’humanitaire comme dans celui des sciences sociales, les critères servant à discerner ce qui constitue un problème comme une solution acceptable doivent être constamment affinés, pour résister à la tentation d’interpréter la problématique d’autrui en fonction de ses propres valeurs. La divergence des points de vue s’est manifestée, par exemple, autour de la question de l’éducation des enfants. Le maternage européen hyperprotecteur, respectueux de la sécurité et l’intégrité de l’enfant, paraît risible, voire nuisible à une mère afghane qui laisse son bambin jouer avec une hache et n’hésite pas à le gifler sans explications. Néanmoins, les Afghanes estiment qu’elles aiment mieux leurs enfants que les Occidentales : Vous à l’Ouest, vous n’aimez pas les enfants, c’est pourquoi vous en mettez aussi peu au monde.
En tant que chercheuse, il est nécessaire de se donner des limites à l’interaction, dépasser le contact spontané et sympathique pour créer une mise à distance permettant l’observation. C’est bien difficile quand l’entretien est toujours entrepris comme une conversation entre égaux. L’apparente égalité n’est qu’une illusion dont les femmes rencontrées dans les camps de réfugiées, puis dans les villages à l’intérieur de l’Afghanistan, ne sont pas dupes, gardant le contrôle de la situation bien plus que celle qui tente de les interroger. Ainsi des informations révélées d’une façon qui convient surtout à l’informatrice, on s’en rend compte a posteriori, quand on se retrouve devant un amas de notes parfois incompréhensibles.
Mais comment procéder autrement ? Est-il possible néanmoins de se limiter à répertorier des éléments méconnus pris dans la réalité sociale et culturelle des interlocutrices, pour les interpréter selon un système préétabli ou inventé après coup. Une formation classique en sociologie et en anthropologie m’a sans doute fait défaut, j’ai procédé à l’inverse de l’orthodoxie méthodologique, commençant par le terrain pour tâtonner ensuite vers les textes, au lieu du contraire. Le recours à la construction théorique aurait-il permis de conserver la gestion du matériel à collecter en se préservant de l’intensité des situations humaines qui constituent l’environnement d’un pareil travail ? L’intuition informée, impossible à codifier, demeure pourtant un outil extrêmement précieux.
Dans un souci d’honnêteté avec soi-même, au sein d’un camp de réfugiés, ou d’un village du sud de l’Afghanistan où sévit une situation de guerre larvée, il est légitime de se demander s’il est vraiment possible de se scinder dans des catégories étanches d’objectivité et de subjectivité. Les interlocutrices afghanes n’en sont nullement persuadées. Si la neutralité et l’objectivité scientifique paraissent illusoires, la précaution reste de mise à chaque instant, le retour fréquent sur soi demeure essentiel pour comprendre les limites de l’observation personnelle et de l’objectivation suscitée, comme l’explique Bourdieu.
Le sociologue n’a quelque chance de réussir son travail d’objectivation que si, observateur observé, il soumet à l’objectivation non seulement tout ce qu’il est, ses propres conditions sociales de production et par là les limites de son cerveau, mais aussi son propre travail d’objectivation, les intérêts cachés qui s’y trouvent investis, les profits qu’ils promettent [14].
Il aurait fallu une vie passée dans un milieu pachtoune pour en comprendre toutes les subtilités, à tel point que toute interprétation ne saurait être définitive et demande à être requalifiée en fonction de l’acquisition de nouvelles connaissances. Par exemple, pendant longtemps je n’ai pas compris pourquoi on ne me remerciait jamais quand j’apportais des cadeaux ou quand j’invitais un large groupe au restaurant, ce qui m’arrivait à la fin de chaque voyage. Je n’osais même pas m’avouer que j’étais franchement blessée alors que, de mon côté, je me confondais en remerciements partout où j’étais reçue. Ce n’est que très tard que j’ai appris qu’on ne remercie pas un égal, parce que dans la mentalité pachtoune cela impliquerait une inégalité de statut entre celui qui reçoit et celui qui donne. Cela m’a fait comprendre l’expression amusée de mes interlocutrices chaque fois que je les quittais avec moult « tachakor » (merci, en dari). Inutile de préciser que de pareils détails ne figurent dans aucune des études ethnographique sur les Afghans, bien qu’il soit probable que les auteurs aient rencontré de pareilles situations. L’ennui, l’exaspération, l’impuissance, la dépression font partie des aspects les plus fâcheux et les plus récurrents du travail de recherche, mais ne sont jamais décrits par des chercheurs enclins à idéaliser leur expérience sur « leur » terrain [15].
Dans le quotidien du camp de Khewa où j’ai passé le plus de temps dans la première partie de ma recherche, avant d’aller à Kaboul et à Farah, l’enquête sociologique et anthropologique a été perçue à sa juste valeur, un questionnement venant à la suite d’une pratique que les interlocutrices acceptaient en raison de l’idée -qu’elles se faisaient de ma vie à Paris : Dans ton pays, toi, tu es professeur, alors c’est normal, tu écris un livre sur l’Afghanistan, parce que les professeurs, ça écrit des livres [16]. Pour les Pachtounes, il ne pouvait que s’agir d’un livre sur leur propre ethnie : Tu es sûre que ça va les intéresser dans ton pays comment on fait chez nous ?
Mais ailleurs, surtout en Afghanistan, ce n’était pas toujours aussi simple. Dans mon cas particulier, gérant en plus une minuscule association caritative, peu de gens arrivaient à me différencier des organismes onusiens – à ceci près que les représentantes de ces institutions ne se déplaçaient jamais comme moi, ce que tous savaient. C’était ma présence physique souvent voilée dans des lieux aussi difficiles d’accès qui surprenait le plus. Il me fallait ensuite expliquer que je ne disposais ni d’argent ni de relations puissantes et seules mes accompagnateurs pouvaient expliciter ma recherche auprès de mes interlocuteurs.
Lors d’une première entrevue, les réfugiés ont souvent une idée préconçue de la demande qui peut leur être faite, basée sur leur expérience des membres de la presse ou de l’aide humanitaire. Quand on rencontre dans les camps de réfugiés une femme afghane qui a déjà eu affaire à des journalistes, la première chose qu’elle fait, c’est de montrer sa burqa en vous proposant de l’essayer, non pas parce qu’elle estime que c’est un supplice exceptionnel, mais parce qu’elle sait que les Occidentaux se polarisent là-dessus, et donc s’imagine que c’est la burqa qui les intéresse principalement. Ces femmes ont compris qu’à travers les médias, en Occident, la burqa en est venue à représenter tous les malheurs des Afghanes.
 À leur tour, elles ont repris ce symbole comme pour conforter une certaine attente imaginaire qui crée un système d’équivalences entre le fait féminin et un signe vestimentaire, sans pour autant toujours évoquer ouvertement la mainmise islamiste, simplement parce que la plupart des journalistes ou des agents humanitaires rencontrés ne reconnaissent pas la dimension politique, s’imaginant trouver là une antique tradition locale. C’est ainsi, dans ce jeu de reflets et réverbérations croisés, qu’une image fragmentaire est construite dans les médias mondiaux, avec la connivence accidentelle des femmes afghanes elles-mêmes, pour être ensuite réimportée sur place et intériorisée aux côtés des autres représentations. À Kaboul, j’ai retrouvé les mêmes schémas d’attente, parce que les femmes interrogées avaient déjà été sensibilisées aux demandes potentielles de leurs interlocuteurs, par les médias et les nombreux projets humanitaires.
À leur tour, elles ont repris ce symbole comme pour conforter une certaine attente imaginaire qui crée un système d’équivalences entre le fait féminin et un signe vestimentaire, sans pour autant toujours évoquer ouvertement la mainmise islamiste, simplement parce que la plupart des journalistes ou des agents humanitaires rencontrés ne reconnaissent pas la dimension politique, s’imaginant trouver là une antique tradition locale. C’est ainsi, dans ce jeu de reflets et réverbérations croisés, qu’une image fragmentaire est construite dans les médias mondiaux, avec la connivence accidentelle des femmes afghanes elles-mêmes, pour être ensuite réimportée sur place et intériorisée aux côtés des autres représentations. À Kaboul, j’ai retrouvé les mêmes schémas d’attente, parce que les femmes interrogées avaient déjà été sensibilisées aux demandes potentielles de leurs interlocuteurs, par les médias et les nombreux projets humanitaires.
Une informatrice connaît souvent la valeur des renseignements qu’elle donne, situation qu’elle peut utiliser à son profit. C’est plus encore le cas pour l’informateur masculin, surtout s’il s’estime un témoin utile, un représentant fiable d’une catastrophe ayant touché toute la population du camp (par exemple, la guerre contre les soldats soviétiques, la vie sous les talibans ou plus récemment les bombardements américains à partir du mois d’octobre 2001). Les relations prennent tout de suite l’allure de la confidence, du lien personnel, de l’échange et de la perspective d’un échange ultérieur, y compris monétaire ou relationnel. On imagine toujours que la chercheure est un personnage bien plus puissant qu’elle ne l’est en réalité, puisqu’elle appartient, à leurs yeux, à la communauté qui détient le pouvoir.
Ainsi, à la suite d’entretiens j’ai reçu plusieurs demandes en mariage pour ma fille. Le prétendant qui a proposé que ma fille devienne sa troisième co-épouse s’est enquis de la présence de frères dans ma famille. C’est qu’il comptait rallier ses éventuels futurs beaux-frères à ses projets de badal, de vendetta. Une veuve qui préparait son retour dans un village afghan s’intéressait également à ma fille pour son fils, mais cherchait surtout à juger si son éducation en France permettrait à ma fille d’être une bru convenable. L’intérêt timide que certaines jeunes filles portaient à mon fils pouvait également s’interpréter dans un projet d’avenir imaginaire où j’aurais pu théoriquement négocier leur mariage en discutant avec leurs parents. La perspective d’une vie au service d’une belle-mère en France leur paraissait plus douce que celle qu’on leur infligerait sur place ! Plus que tout, ces propositions renfermaient de précieux enseignements sur les pratiques du mariage dans la société afghane. Cependant, à cause du ton de confidentialité immédiate, une différence d’opinions (chez les hommes en particulier) pouvait être interprétée comme un manque de reconnaissance, l’informateur peut se sentir incompris, voire trahi par la personne qui lui fait face.
Comme on le voit, les personnes interrogées mènent leur enquête à leur tour et les renseignements sur le visiteur circulent dans un camp de réfugiés ou une communauté rurale. Le fait d’habiter sur place implique une certaine intimité, un échange d’informations personnelles et une participation occasionnelle aux tâches quotidiennes.
Il m’a paru essentiel de prendre en compte les conditions dans lesquelles ces informations étaient collectées, tant le rapport au terrain paraît déterminant sur la qualité de ce qui est recueilli. D’autres recherches récentes sur les camps de réfugiés n’ont pas suffisamment précisé dans quelles conditions elles ont été réalisées. La circulation, même dans les camps, les modalités d’entretien, la relation complexe et ambiguë avec des interprètes sont souvent d’une extrême complexité qui mériterait d’être décrite plus en détail : l’ensemble constitue un sujet de réflexion indépendant.
Il faut toujours se souvenir qu’en dépit de leur chaleur, les relations entre adultes ne sont jamais symétriques et que ce sont les interlocuteurs qui maîtrisent les échanges. Avec les jeunes, le contact est plus spontané, mais il faut du temps pour établir une relation avec des enfants et surtout des filles peu socialisées pour la prise de parole. C’est ainsi que j’ai passé deux heures très difficiles avec un groupe d’enfants hazaras rescapés d’un massacre pachtoune dans la province de Bamyan. Ces enfants, qui provenaient des régions les plus reculées, étaient en état de choc et n’avaient jamais rencontré une étrangère. L’impossibilité de communication dans une situation de ce genre renvoie aux limites de toute interaction, où l’on est forcé de constater à quel point toute compréhension peut se révéler illusoire.
Pour me rassurer en ces lieux lointains dont je censurais toujours le danger, j’étais tentée par la projection, l’illusion de la compréhension mutuelle et de valeurs partagées. Maurice Godelier parle de cette sollicitation :
C’est vrai qu’on est constamment tenté de construire l’autre en miroir de soi. Mais c’est justement cette tentation ou cette pratique qu’il faut détruire en soi… [17]
Dans d’autres situations, le miroir se ternit rapidement, ce qui est sans doute plus facile dans une zone de guerre. Par souci d’auto-préservation et consciente de ma lâcheté, j’ai choisi de ne pas poser, en particulier aux hommes, certaines des questions sur le terrorisme et Al-Qaida [18], ce qui fait que ces problèmes n’ont pas été abordés dans le présent travail. En traversant la région du NWFP ou la frontière au Khyber Pass, habillée en costume local, ensevelie sous un voile pour ne pas me faire repérer dans des autobus décrépis, jamais je ne me suis sentie plus étrangère, coupée à la fois de mon monde et de celui dans lequel j’étais plongée. Je ressentis la même chose quelques années plus tard sur la route entre Hérat et Farah, cachée sous une burqa. C’est à ces moments-là que je me retrouvais face à ma colère impuissante devant l’injustice flagrante des usages à l’encontre de ces femmes, me remémorant les manifestations d’une souffrance multiforme rencontrées au quotidien, produites par le croisement de systèmes anciens et actuels convergeant vers une répression pour moi inacceptable, même si j’avais tenté de démonter, par la présente recherche, ses rouages et ses mécanismes. Un travail en sciences sociales, trop souvent en France, n’est pas censé être le lieu d’expression d’opinions personnelles, mais une mise à distance. On me l’a fait comprendre pendant la soutenance de ma thèse de doctorat ! Cependant, le destin des femmes en Afghanistan a trop souvent été sacrifié, depuis le dernier quart de siècle, sur l’autel de politiques d’une misogynie d’une brutalité inouïe. Dans une situation extrême comme celle-ci, ce refus de prendre position est-il réellement souhaitable, ne fausse-t-il pas la réflexion critique ? Ne pas en faire cas, taire l’outrage, minimiser la violence, in fine censurer la douleur, au nom d’une quelconque « science » politiquement correcte en diable, est-ce vraiment faire preuve de plus d’objectivité ? Ou bien une forme de négationnisme. Ailleurs qu’en France, l’engagement féministe, antimilitariste auprès des universitaires n’est pas aussi mal vu, comme l’ont démontré les travaux admirables de Cynthia Enloe et Cynthia Cockburn. Si elles s’appliquent à reconnaître les poches de résistance individuelle de la part de femmes qui refusent les normes dominantes, elles n’ont pas hésité à montrer du doigt la condition de victimes qui caractérise trop souvent encore les femmes, en particulier dans les pays où leur statut de sujet n’est guère reconnu. Comme en Afghanistan rural.
La collecte des informations s’est réalisée sur le mode du repérage non systématique qui sera mis en forme au retour à Paris devant l’ordinateur. D’un côté des questionnaires complétés à moitié, de l’autre d’épais cahiers remplis de réflexions et de notes, prises au cours d’entretiens, souvent après coup, à la lumière d’une lampe torche, griffonnées dans un bus, la main recouverte d’un voile. Dans la société afghane, on n’est jamais seul. Dans un camp, à Kaboul ou dans un village, une femme ne peut pas se promener seule : faillir aux convenances pourrait faire croire au voisinage que ses hôtes ne remplissent pas leur devoir d’hospitalité. De plus, il ne faut pas sous-estimer le danger réel, surtout, ces dernières années en Afghanistan, celui de l’enlèvement que mes hôtes craignaient bien plus que moi.
L’après-terrain
Une fois de retour, le travail le plus ardu s’amorce. Les conversations se poursuivent par l’imaginaire, d’innombrables questions restent en suspens. La reconstitution des données à partir des bribes de phrases remémorées, superposées à de nombreuses lectures peut susciter des conclusions opposées, il faut constamment faire des choix tout en revendiquant ici le droit à la contradiction. On se surprend à déplorer son propre manque d’organisation et à se demander si une méthodologie plus rigoureuse aurait été souhaitable. Est-il en effet possible d’observer et de présenter une recherche de ce type comme s’il s’agissait d’une collecte de données effectuées in vitro ? Pour éviter le brouillage imputé à l’émotion, faut-il opter pour une approche impersonnelle ? Cette dernière garantit-elle réellement une objectivité savante dans l’évaluation de données qui ne sont pas comptabilisables sur un mode scientifique ? À moins de se restreindre au calcul du nombre de burqas par mètre carré dans les allées du camp de Jalozai, ou de tchadors-namaz noirs à Hérat, une enquête selon des critères d’objectivité tirés de l’expérience scientifique classique ne pourra jamais livrer des informations pertinentes. C’est un des écueils du travail humanitaire qui fausse les renseignements par les limites du mode de recherche en plus de l’ignorance du contexte. C’est pourquoi j’ai évoqué au chapitre III les statistiques données dans le rapport de l’association Physicians for Human Rights sur la situation des femmes afghanes de 2001 durant l’ère taliban. Seules 5 % des femmes interrogées en Afghanistan et dans les camps pakistanais relatent des actes de violence subis (comprenant la détention, des coups, des blessures provenant d’armes à feu, des viols) – ce qui constitue sans doute une baisse globale de criminalité ouverte.
 Mais ces chiffres ne signifient rien dans une société où les femmes sont évacuées de l’espace public et comparativement moins exposées à ce type d’actes, alors que la principale source de souffrance provient de la brutalité conjugale rarement avouée et perçue comme faisant partie des aléas du mariage. Comment systématiser le recueil d’informations de ce genre ? Pour identifier des structures, des comparaisons sont de mise avec des limites inhérentes. Par exemple, les catégories sociales énumérées, y compris le système occidental des classes calqué sur une société aux référents tribaux et celui des castes, représentent des raccourcis pour le lecteur comme la chercheuse.
Mais ces chiffres ne signifient rien dans une société où les femmes sont évacuées de l’espace public et comparativement moins exposées à ce type d’actes, alors que la principale source de souffrance provient de la brutalité conjugale rarement avouée et perçue comme faisant partie des aléas du mariage. Comment systématiser le recueil d’informations de ce genre ? Pour identifier des structures, des comparaisons sont de mise avec des limites inhérentes. Par exemple, les catégories sociales énumérées, y compris le système occidental des classes calqué sur une société aux référents tribaux et celui des castes, représentent des raccourcis pour le lecteur comme la chercheuse.
L’appréhension du vécu des femmes, l’écoute et la réception des explications des interlocutrices ont été filtrées par la conscience aiguë de nos propres limites, la distance entre leur vécu et la schématisation conceptuelle entreprise spontanément. Travaillant depuis des années sur la Shoah, ensuite en zone de guerre à partir du diplôme, puis du DEA, sur la résistance des femmes pendant le siège de Sarajevo, il m’est parfois difficile d’échapper à la formulation d’un jugement sur une situation qui met en évidence une souffrance extrême produite par l’arbitraire. J’ai néanmoins tenu à marquer la différence entre une douleur acceptée avec résignation parce qu’elle s’intègre à des principes patriarcaux intériorisés depuis des siècles, voire des millénaires, et celle, intolérable, infligée par un agent exogène, comme un édit islamiste ou un fait de guerre. Vue de l’extérieur, la souffrance produite par une société patriarcale paraît au quotidien souvent plus extrême, puisqu’elle normalise les mariages forcés, la brutalité des rapports interfamiliaux surtout conjugaux, même la mortalité maternelle. Si la travailleuse humanitaire se permet d’intervenir sur les conséquences sur la santé de ces pratiques, la chercheuse s’est abstenue autant que possible d’ingé-rence, s’intéressant davantage à définir ce qui constituait véritablement une souffrance inacceptable par celles qui la subissaient. Néanmoins, la frontière n’est pas claire et la rigueur pas toujours possible. Comme le résume Christian Ghasarian :
Le terrain est le lieu où le chercheur connaît une sorte de conflit existentiel entre le subjectivisme et l’objectivisme d’une part, la bonne conscience due à l’idée d’utilité scientifique et la mauvaise conscience associée au fait d’être un témoin indiscret d’autre part. Dans ce contexte, la séparation nette entre le personnel et le professionnel, l’observateur et les observés est problématique… Or, les résultats ne doivent pas négliger l’interaction du chercheur avec ceux qu’il étudie car la prise en considération des faits subjectifs favorise, au lieu d’anéantir, l’objectivité du travail. [19]
C’est pourquoi j’ai voulu penser les tentatives de survie des femmes afghanes dans des conditions de guerre extérieure et d’oppres-sion intérieure, dans la lignée des efforts surhumains entrepris par des femmes dans d’autres lieux, d’autres guerres tandis que, partout, les hommes étaient au front, au loin.
 Les femmes dans le camp de Jalozai, après les bombardements américains à partir d’octobre 2001, ont réinventé leurs foyers, avec des tentes faites de bouts de plastique dont le le seuil est marqué par une brique. Comme leurs congénères que j’ai connues à Sarajevo sous les obus serbes, celles de Stalingrad ou celles du ghetto de Varsovie de la génération de mes parents, elles ont déployé des trésors d’imagination, des ressources qu’elles n’imaginaient pas être à leur disposition. Les femmes afghanes prennent leur place parmi toutes ces femmes appliquées à rassembler les fragments, les lambeaux, les débris du monde connu pour tisser chaque jour la promesse parfois illusoire d’un lendemain. Comme dans d’autres situations de ce genre, l’histoire de leur patiente résistance risque d’être gommée, d’autant plus que l’islamisme à l’afghane dans la région a oblitéré la présence des femmes dans l’espace public, ce qui aura des répercussions dans la réécriture opportune de l’histoire de ce dernier quart de siècle.
Les femmes dans le camp de Jalozai, après les bombardements américains à partir d’octobre 2001, ont réinventé leurs foyers, avec des tentes faites de bouts de plastique dont le le seuil est marqué par une brique. Comme leurs congénères que j’ai connues à Sarajevo sous les obus serbes, celles de Stalingrad ou celles du ghetto de Varsovie de la génération de mes parents, elles ont déployé des trésors d’imagination, des ressources qu’elles n’imaginaient pas être à leur disposition. Les femmes afghanes prennent leur place parmi toutes ces femmes appliquées à rassembler les fragments, les lambeaux, les débris du monde connu pour tisser chaque jour la promesse parfois illusoire d’un lendemain. Comme dans d’autres situations de ce genre, l’histoire de leur patiente résistance risque d’être gommée, d’autant plus que l’islamisme à l’afghane dans la région a oblitéré la présence des femmes dans l’espace public, ce qui aura des répercussions dans la réécriture opportune de l’histoire de ce dernier quart de siècle.
Remettre les femmes au centre du récit des guerres
L’absence des femmes dans les récits de guerre est frappante. Dans le cas de la Shoah, par exemple, on sait qu’un travail d’occultation a été réalisé au sujet des rescapés (hommes et femmes) des camps d’extermination dont personne ne voulait entendre – ni ne supportait – le récit de leurs expériences dans la France (et ailleurs) de l’après-guerre. À l’exception de quelques rares ouvrages parus vers 1946-1948, la plupart des témoignages ont été publiés après le milieu des années 1980, dans le sillage des travaux des historiens américains sur la collaboration, également censurée à l’époque dans la mémoire officielle française.
 Ce sont les souvenirs des femmes qui paraissent en dernier (jusqu’à aujourd’hui, 60 ans après les faits), parce que, plus que tout autre témoignage, c’est leur vie qui a subi la plus grande censure – du fait de l’urgence du quotidien, de la reprise d’une certaine normalité, de la nécessité de banaliser, pour achever de gommer à tout prix, tant l’exceptionnel que l’inavouable. Cette évacuation pourrait être le résultat d’une infériorité imaginée et intériorisée par les femmes elles-mêmes, minimisant depuis toujours leur rôle dans toute guerre, à la faveur de récits généraux sur la guerre considérés uniquement d’un point de vue masculin. Je suis revenue à ces considérations sur deux guerres mondiales, vécues au féminin récemment. Mon analyse de ces données historiques a été revue et corrigée par mes expériences bosniaques et afghanes [20].
Ce sont les souvenirs des femmes qui paraissent en dernier (jusqu’à aujourd’hui, 60 ans après les faits), parce que, plus que tout autre témoignage, c’est leur vie qui a subi la plus grande censure – du fait de l’urgence du quotidien, de la reprise d’une certaine normalité, de la nécessité de banaliser, pour achever de gommer à tout prix, tant l’exceptionnel que l’inavouable. Cette évacuation pourrait être le résultat d’une infériorité imaginée et intériorisée par les femmes elles-mêmes, minimisant depuis toujours leur rôle dans toute guerre, à la faveur de récits généraux sur la guerre considérés uniquement d’un point de vue masculin. Je suis revenue à ces considérations sur deux guerres mondiales, vécues au féminin récemment. Mon analyse de ces données historiques a été revue et corrigée par mes expériences bosniaques et afghanes [20].
Telle a été la situation que j’ai pu constater en Bosnie à partir des années 1997 : le vécu des femmes, les formes extraordinaires que prit leur résistance durant le siège de Sarajevo ont été complètement « oubliés » en tout cas remisés dans la période qui a suivi. De véritables héroïnes que j’ai rencontrées pendant la guerre et dont l’expérience a servi de base pour mon DEA ont été happées par un quotidien âpre. Les autorités n’ont rien fait pour les reconnaître, au contraire des militaires qui au moins ont pu prétendre à des médailles, même si leur vie actuelle n’a rien d’enviable. Des cancers galopants sont venus terrasser nombre de ces femmes qui avaient pourtant tenu bon dans des conditions extrêmement dures. Et si les chercheurs et chercheuses qui s’attellent aujourd’hui à une recherche sur la guerre en Bosnie n’ont pas la possibilité de s’appuyer sur des réseaux établis auparavant, ils rencontreront les plus grandes difficultés, puisqu’une chape de silence recouvre le souvenir de cette période.
Le présent travail prétend se ranger parmi les premiers concernant le vécu des femmes afghanes en exil dans les camps et la reconstruction du quotidien dans les années qui ont suivi en Afghanistan, afin que soit reconnue en lieu officiel la mémoire de leur combat, pour permettre à d’autres chercheuses, en particulier afghanes, de prendre la relève.
NOTES
[1] . Traditions et transformations dans la vie des femmes afghanes dans les camps de réfugiés au Pakistan, depuis 2001, EHESS, Paris, 2006.
[2] . Ce sont les travaux d’Olivier Roy qui serviront de référents à toute discussion sur l’islam politique.
[3] . Marc Augé, Non-lieux, Introduction à une anthropologie de la surmodernité, Paris, Seuil, 1992, p. 33.
[4] . Michel de Certeau, L’invention du quotidien I., Arts de faire, Paris, Folio-Gallimard, 1990, p. 145.
[5] . RAWA Revolutionary Association of the Women of Afghanistan, la seule organisation afghane féministe et laïque.
[6] . C. Mann, Une banlieue de Sarajevo en guerre, Les amazones de la kuca, la résistance des femmes de Dobrinja, DEA sous la direction de Marc Augé, Paris, EHESS, 2000, publié à Sarajevo (Svjetlost) en 2005.
[7] . www.femaid.org
[8] . Grant M. Farr, « Afghan refugees in Pakistan : definitions, repatriation and ethnicity » in Ewan Anderson and Nancy Hatch Dupree (eds), The Cultural Basis of Afghan Nationalism, Londres, Pinter, 1990, p. 134.
[9] . Osama, film de Siddiq Barmak, 2004.
[10] . Voir la discussion de ces chiffres au chapitre iii.
[11] . Nicole-Claude Mathieu, « Quand céder n’est pas consentir » in L’arraisonnement des femmes. Essais en anthropologie des sexes, Paris, Éditions de l’EHESS, 1985, p. 6.
[12] . Lila Abu-Lughod, « The Muslim woman. The power of images and the danger of pity », octobre 2006, http://www.tropismes.org/post/96
[13] . Michelle Olivier et Manon Tremblay, Questionnements féministes et méthodologie de la recherche, Paris, L’Harmattan, 2000, p. 11.
[14] . Pierre Bourdieu, « Sur l’objectivation participante. Réponse à quelques objections », Actes de la recherche en sciences sociales, n° 23.
[15] . Christian Ghasarian, « Sur les chemins de l’ethnographie réflexive » in C. Ghasarian, De l’ethnographie à l´anthropologie réflexive. Nouveaux terrains, nouvelles pratiques, nouveaux enjeux, Armand Colin, Paris, 2002, p. 11.
[16] . Commentaire entendu fréquemment au camp de Khewa en 2002 et en 2003.
[17] . Maurice Godelier, « Briser le miroir du soi » in C. Ghasarian, De l’ethnographie à l´anthropologie réflexive... op. cit., p. 194.
[18] . C’est un aspect de la vie des camps qui néanmoins préoccupe le gouvernement américain, entre autres. Un bon nombre de détenus actuels à Guantanamo ont été arrêtés au camp de Sharwali, ici étudié à la suite d’opérations conjointes menées par la CIA et l’ISI.
[19] . Christian Ghasarian, op. cit., p. 11.
[20] . Carol Mann, Femmes dans la guerre, 1914-1945, Paris, Pygmalion/Flammarion, 2010.
 Fil des publications
Fil des publications

 retour à la liste des ouvrages
retour à la liste des ouvrages