Le mythe de l’identité nationale
présentation de l'éditeur
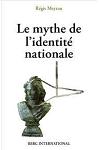 |
Régis MEYRAN, Le mythe de l’identité nationale , Berg International, nov. 2008, 240 p. En librairies le : mars 2009 - Éditeur : Berg International - Reliure : Broché - Description : 194 pages au format 15x24 cm - ISBN : 978-2-917191-19-4 Prix : 19 € |
Mots clefs
A lire ci-dessous, avec l’aimable autorisation de l’auteur et de l’éditeur, un chapitre complet Chapitre 2. Identité nationale ou lutte des classes ?
Pour acheter ce livre : en ligne
Lire le compte-rendu de lecture de Bruno Modica sur Clionautes : Compte-rendus des Clionautes
.
PRESENTATION
Régis Meyran est docteur de l’Ehess, et chercheur affilié au Laboratoire d’anthropologie et d’histoire de l’institution de la culture (Lahic/Iiac). Il est l’auteur de nombreux travaux traitant de l’histoire de l’anthropologie et des sciences humaines,dans des revues scientifiques (L’Homme, Gradhiva), mais aussi dans des magazines de vulgarisation (Sciences Humaines, Pour la Science). Il a coordonné : « Usages publics de l’Histoire en France », numéro de la revue Matériaux pour l’histoire de notre temps, n°85, 2007 ; et (avec Denis-Michel Boëll et Jacqueline Christophe), Du Folklore à l’ethnologie, 1936-1945, Paris, Éditions de la MSH, 2008.meyranr@yahoo.fr
.
Qu’est-ce qu’un « Français » ? Au-delà de cette notion existe une croyance, très largement répandue et mythique de l’idendité nationale. Le « vrai » Français, « de souche », serait un « Gaulois » de race blanche dont les traditions, ancrées dans un « terroir », se perdraient dans la nuit des temps. C’est dans le domaine de l’anthropologie, ou dans ses marges, entre 1870 et 1945, que se sont élaborées les théories les plus sophistiquées de l’identité nationale. D’un côté, l’anthropologie physique, cherchant à mesurer et à classer les hommes, n’a pas su éviter de se poser la question de la « pureté » de la « race française ». De l’autre, les études de folklore, visant à recueillir les survivances de traditions paysannes ou artisanales en déclin, ont exclu de fait celles de bon nombre de Français qui n’étaient pas « de souche ». Une conception figée de l’identité nationale atteignit son paroxysme avec l’Occupation et le Régime de Vichy, mais on la trouve aussi jusque chez les anthropologues antiracistes de l’entre-deux-guerres et les folkloristes du Front populaire. L’auteur retrace la genèse du récit mythique qui a imprégné la communauté scientifique française. Par un curieux effet d’inertie, ce mythe, aujourd’hui abandonné par les anthropologues, est toujours présent dans le sens commun et dans la sphère médiatico-politique. Ce livre s’adresse donc, au-delà du cercle des spécialistes de l’histoire des sciences sociales, à tous ceux qui s’intéressent aux débats actuels sur les questions "d’identité nationale". |
 |
.
SOMMAIRE
.
1re partie. Race et identité nationale.
Chapitre 1. Mesure de l’homme et lutte des races à la Société d’anthropologie.
Chapitre 2. Vers une norme raciale. Les ambiguïtés de l’antiracisme chez les ethnologues de l’entre-deux-guerres.
Chapitre 3. Les vertus de la race française. Anthropologie et utopie raciale en France occupée.
2e partie. Tradition et identité nationale.
Chapitre 1. Traditions, pays et races locales. Retour sur les débuts du folklorisme.
Chapitre 2. Identité nationale ou lutte des classes ? Les folkloristes dans l’entre-deux-guerres.
Chapitre 3. La paysannerie française, entre race et tradition. Les folkloristes sous Vichy.
Conclusion : Disparition et retours de la question raciale.
Chapitre 2. Identité nationale ou lutte des classes ?
© 2009 Éditions Berg International Editeurs - Paris
Les folkloristes dans l’entre-deux-guerres
Dans les années d’entre-deux-guerres, avec les victoires de la gauche (Cartel des gauches, Front populaire), des intellectuels « progressistes » vont tenter à la fois d’institutionnaliser le folklore et de lui donner un nouveau souffle, comme un nouveau sens. Mais ont-ils réussi à infléchir les présupposés qui dans cette discipline font la part belle à une mythologie de l’identité nationale ? La réponse n’est pas évidente. Située entre internationalisme et régionalisme, entre modernisme et traditionnisme, leur posture théorique est difficile à appréhender.
Le folklore nazifié en Allemagne
Il faut tout d’abord bien considérer que, dans les années trente, à un moment d’exacerbation des identités nationales, les études de folklore comportent un aspect politique accru dans les pays européens. Le meilleur exemple est donné par la science folklorique allemande déjà fortement teintée de nationalisme (volkskunde), développée tout au long du XIXe siècle dans le sillage des frères Grimm et de Wilhelm Heinrich Riehl. Pour l’anthropologue Hermann Bausinger, « s’il est une science où le national-socialisme ne s’est pas introduit par effraction mais où il en a été une conséquence interne, c’est bien la Volkskunde » [1]. Selon cet auteur en effet, la science du peuple demeurait, depuis la période romantique au moins, sous le charme d’un engouement mythologisant pour l’Antiquité et était fascinée par une conception organique de la société qu’on retrouve à l’œuvre dans la Volkskunde nazie, qui connaît un essor important. Alors qu’il n’y avait auparavant que deux chaires d’Université consacrées à l’étude de la Volkskunde, une dizaine supplémentaire apparaissent entre 1933 et 1935 et les musées historico-culturels consacrés aux traditions populaires se développent de manière impressionnante.
Quand les nazis prennent le pouvoir et procèdent dans l’Université à l’éviction des professeurs juifs, les trois grandes disciplines de l’anthropologie deviennent officiellement racistes [2]. Elles théorisent la nécessité de maintenir pure la « race aryenne » ou « nordique », notamment vis-à-vis de la « race juive », supposée venir « souiller » le sang germain. C’est le cas de l’anthropologie raciale (la Rassenkunde, qui se rapproche de l’hygiène raciale allemande) avec les anthropologues Hans Günther, Egon von Eickstedt et Eugen Fischer, de l’ethnologie (Völkerkunde) qui hiérarchise les différentes races primitives, avec Gunther Hecht, mais aussi des études de folklore (Volkskunde). Sont alors réhabilitées, dans un sens raciste, les notions de Volksgeist (qu’on trouvait chez Heymann Steinthal) et de Weltanschauung (théorisée par Wilhelm von Humboldt). Quant à la notion de Volkstum, elle comprenait un sens raciste depuis la fin du XIXe siècle (avec les écrits du nationaliste Friedrich Ludwig Jahn).
Hannjost Lixfeld a étudié en détail l’idéologie présente dans le folklore allemand sous la période nazie [3]. Selon cet auteur, Alfred Rosenberg et Heinrich Himmler étaient persuadés de l’utilité de la propagande par le folklore. Johann Matthes Ziegler, un S.S. proche de Rosenberg, devient à la prise du pouvoir par Hitler le personnage important de la Volkskunde nazie. Il est nommé dès 1933 rédacteur en chef du journal culturel du parti, le NS-Monatschefte. On lit dans ses publications qu’il tente, via le folklore, de restaurer « l’antique pureté raciale » des Germains [4]. Il cherche ainsi à faire revivre les « lois » de la vie nordique à travers des poèmes et des chansons et crée des festivals, organise des expositions et des congrès ainsi que des cérémonies « rituelles » supposées ancrées dans la tradition. S’inspirant de l’anticatholicisme de Rosenberg et de la théorie nordiste de Hans F. Günther, il compte instaurer une religion païenne, une « piété germanique » qui serait vouée à la gloire du national-socialisme. Alfred Rosenberg, ministre national-socialiste « des fêtes, du temps libre et des célébrations » instaure au même moment, en accord avec Joseph Goebbels, un folklore appliqué constitué notamment de fêtes annuelles (Jehresfeiern) et de cérémonies dites « fêtes de vie » (Lebensfeiern). Ces dernières, évoquées dans l’ouvrage d’Édouard Conte et Cornelia Essner, La Quête de la race, mélangent des éléments d’un culte au führer avec des éléments hétéroclites du folklore allemand. Tel est le cas par exemple de la célébration de la « Nuit du 21 juin », qui marque le solstice d’été, et auquel assistent les Jeunesses hitlériennes. Un rite est inventé puis mis en scène par le parti et mis en œuvre dans une clairière où des cors entonnent un hymne au soleil, alors que des porteurs de torches s’avancent et allument un brasier. Un maître de cérémonie proclame alors que le feu est le symbole de la victoire des forces vitales du peuple, de la terre allemande et du sang germanique pour finir son discours par des louanges à Adolf Hitler [5]. La science folklorique et raciste nazie est d’ailleurs relayée par des associations de loisirs : la plus importante est l’organisation Kraft durch Freude (qu’on peut traduire approximativement : « La force par la joie »). Ce mouvement possède un bureau « volkstum und heimat », spécialisé dans la propagande nationale-socialiste par le folklore : il organise chants, danses, artisanat, excursions, fêtes populaires [6]. En 1934, le chef du mouvement, le docteur Ley, écrit : « Le volkstum est la plus profonde et la plus claire expression de la race d’une nation. » [7] Au Congrès mondial des loisirs organisé à Hambourg (23-30 juillet 1936), le professeur de volkskunde Adolf Spamer explique au public (où sont présents des représentants de l’Italie fasciste et de la France du Front populaire) : « C’est seulement à notre époque que l’on a reconnu aux travaux de folklorisme une valeur primordiale pour la race. » [8]
Dans le cas de la volkskunde nazie, la notion de « race » renvoie à une définition anthropologique (et non au sens folklorique), sur fond de guerre des races (la « race aryenne » étant supposée menacée en particulier par la « race juive »). Le folklore n’est plus alors qu’une sinistre caricature, mais dans l’Europe des années trente, les associations populaires de jeunesse, de droite comme de gauche, lui font une place importante dans leurs activités de loisir.
Le folklore conservateur de Louis Marin
Dans les années d’entre-deux-guerres, la vision conservatrice du folklore parmi les notables locaux français n’a pas vraiment disparu. À Paris, un homme politique de premier plan, folkloriste à ses heures perdues, va se faire le chantre d’un tel folklore : c’est Louis Marin.
Louis Marin (1871-1960), lorrain de naissance et de cœur, boulangiste dans les années 1890, ami de François de Wendel (puissant industriel et protecteur des mouvements d’extrême droite), découvre à vingt ans le milieu nationaliste de droite de la capitale en participant à des déjeuners mondains organisés par Gustave Le Bon. Il y rencontre Maurice Barrès et Frédéric Mistral. Puis c’est l’ascension politique : il est député de Meurthe-et-Moselle entre 1905 et 1942 (sans interruption), mais aussi secrétaire de l’Assemblée nationale (1907-1908), et plusieurs fois ministre entre 1924 et 1940 [9]. Dans les années 1920 et 1930, il dirige en outre la Fédération républicaine [10], organisme de droite qui fut le principal opposant au Front populaire. Ce parti est conservateur et nationaliste, voire réactionnaire, sans être fasciste. Un bon nombre de ses membres vont se prononcer pour l’avènement du régime de Vichy [11]. Sur le plan des idées, Marin cumule des positions intellectuelles qui pourraient nous sembler aujourd’hui contradictoires : c’est un régionaliste convaincu (élu en 1908 président de la Fédération régionaliste française) ainsi qu’un défenseur du colonialisme français ; il se prononce pour la liberté de culte, pour le suffrage des femmes et se déclare en faveur de la « défense des peuples opprimés » (il milite notamment pour la cause arménienne).
Mais Marin est également un homme important dans le milieu des sciences de l’homme. Dès son arrivée à Paris, il est accueilli par la Société d’économie sociale, organisme de recherche et de réforme sociale, catholique et conservateur, fondé en 1857 par Frédéric Le Play. En quelques années, il devient un personnage de premier plan, cumulant les fonctions de président de la Société d’ethnographie (plusieurs fois entre 1920 et 1956) et de la Société de statistiques (dès 1930), directeur de l’École d’anthropologie (par deux fois entre 1923 et 1944), président de la Société géographique de Paris (1925-1960). Il est en outre l’un des fondateurs de l’Académie des sciences coloniales en 1922 (laquelle deviendra l’Académie des sciences d’outre-mer), où il enseigne en tant que professeur titulaire.
Dès le départ, ses cours à l’École d’anthropologie portent la trace de son engagement politique : il y expose en effet les résultats de ses études sur les moyens de lutter contre l’exode rural (1908), sur la crise de la civilisation occidentale (1929), sur la famille occidentale ou sur la crise des traditions (1950). Marin développe une science sociale nationaliste, républicaine et régionaliste qui n’est pas sans ambivalences : il chante la grandeur de la civilisation française et ses progrès techniques [12] tout en désirant ardemment sauver les coutumes locales qui risquent de péricliter par la faute de cette même civilisation, tout entière tournée vers la mode et la « nouveauté » [13]. Il propose, du coup, que les traditions relevées par l’ethnographe soient enseignées dans les écoles des régions – un projet qui ne verra le jour qu’à l’époque de Vichy, et sans le concours direct de Marin. Il prône une « ethnographie » strictement descriptive, par opposition à l’« ethnologie » interprétative et à ses yeux spécieuse des savants de l’Institut d’ethnologie, du musée de l’Homme ou du MNATP : ces derniers analysent les faits sociaux par le biais du symbolique, alors que lui propose de se cantonner à la description pure des faits ethnographiques, et de se livrer à ce qu’il appelle l’« ethnodicée », c’est-à-dire une méthode de classement des sociétés selon qu’elles ont plus ou moins de « valeur » [14]. L’idée d’ethnodicée se combine avec celle de la supériorité absolue de la civilisation occidentale : idée en quelque sorte naturelle pour un défenseur du colonialisme.
Les études folkloriques du savant, notamment celles concernant les veillées ou les contes traditionnels lorrains, sont toujours empreintes d’une nostalgie du passé d’un peuple sain et serein, qu’il préfère à une société moderne vivant dans l’instant et refusant la longue durée. Il voit l’exode rural comme la conséquence d’un progrès qui menace des traditions se perpétuant depuis des millénaires. Ainsi, les Lorrains d’aujourd’hui sont pour lui profondément semblables à leurs ancêtres sous l’Empire romain chrétien du IVe siècle : « La première généralité est que, par un mécanisme encore mal connu, le caractère et, surtout, le “génie” d’un peuple ou d’une province ne changent guère avec le temps : le portrait des Lorrains tracé minutieusement par Ausone, au IVe siècle de notre ère, vaut étrangement pour ceux de maintenant. » [15]
On retrouve ici le discours sur « l’esprit des lieux » formulé à la fin du XIXe siècle par Barrès et qui joua dès cette époque sur la constitution du folklore. Marin établit par ailleurs, dans un ouvrage posthume, Regards sur la Lorraine, l’idée force des folkloristes du tournant du siècle, celle de la détermination de la race des paysans par le pays : « [Le village], c’est la plus petite “cellule sociale”, sous la forme administrative, du genre de l’État, et sous la forme de “la plus petite patrie”, du genre de la Nation. Le village natal exerce une action prépondérante sur l’être entier et pour toujours quand l’enfance s’y passe et que, par la suite, de longs séjours réalisent la permanence du contact. L’endroit où s’est opéré le miracle de la création d’une âme a toujours porté les hommes aux réflexions salutaires, parce que le sol a façonné, à son image, les parents, surtout quand leurs diverses lignées ont été de la race des paysans, gens du pays, gens de la terre. » [16]
Selon Marin, la race paysanne, tant du point de vue psychologique que culturel – il souligne l’importance de la forme d’habitation en villages –, est donc naturellement en harmonie avec la géographie du lieu qu’elle habite. D’où la nécessité de mettre en œuvre une ethnodicée « appliquée », méthode par laquelle il souhaite éliminer les composantes culturelles de la société qui nuisent au bon fonctionnement des traditions ancestrales [17].
Mais dans ses jeunes années, Marin s’est élevé contre les théories racistes : ainsi, il défend, au premier Congrès international d’anthropologie (Paris, 1900), la « thèse de la liberté des peuples et des individus, de leur égalité en droit fondée sur l’identité de la nature de la personne humaine » [18]. Il écrira plus tard, dans Regards sur la Lorraine, son mépris pour les thèses racistes de Gobineau : « L’homme est foncièrement partout le même. Aucun homme n’a, nulle part, un organe, une fonction en moins ou en plus qu’ailleurs […]. L’Homme ne compte que des races différentes qui, elles-mêmes, peuvent comporter des “sous-races” et, surtout, des variétés : les unes et les autres ne sont que des différenciations “superficielles” de dimensions, de formes et de lignes, de couleurs et d’organes, de composition de leurs éléments. Sauf ces dissemblances qu’on doit, à juste titre, appeler secondaires, l’homme est partout semblable à l’homme. […] [À propos de Gobineau], j’expliquai à un de mes anciens professeurs mon total mépris pour l’ignorance raciologique de ce faux penseur. » [19]
Malgré tout, une interrogation subsiste quant à ses conceptions en matière de race : quand il parle du « caractère » ou du « génie » des peuples, de la « race » des paysans, il s’inscrit dans une conception de la race qui est, on l’a vu, celle des folkloristes et régionalistes depuis la fin du XIXe siècle. Néanmoins, Marin dirige l’École d’anthropologie, lieu où la race a un tout autre sens. Dans ces conditions, il est difficile d’imaginer qu’il ait été complètement imperméable à la notion de race, théorisée et enseignée au sein de l’organisme qu’il dirigeait. D’ailleurs, Marin partageait bon nombre d’idées avec les professeurs de l’École, notamment la peur que la civilisation occidentale ne s’effondre et un souci de conserver la pureté de la race (Marin conservait sur son bureau un crâne de « Gaulois » [20], symbolisant l’éventuelle collusion entre sa quête d’une culture pure et celle que d’autres vouaient à une race pure). Certes, il ne prit jamais publiquement position sur la question de l’eugénisme ni sur celle du vieillissement de la population – les leitmotiv de professeurs de l’École – et sa xénophobie, jamais promue au rang de théorie scientifique, semblait se concentrer presque uniquement sur le peuple allemand. Marin se situe malgré tout à la jonction du folklore et de l’anthropologie raciale. Il illustre de manière exemplaire cette conception de la race chez les folkloristes conservateurs, comme un continuum entre deux extrêmes, d’un côté la race au sens anthropologique, de l’autre la race comme vision métaphorique d’un peuple idéalisé.
Sur l’autre rive : la politique culturelle du Front populaire et le folklore
Pour l’historien Pascal Ory, la grande originalité du Front populaire est d’avoir inventé une « politique culturelle » (même si l’expression n’existait pas à l’époque) : celle-ci se manifeste à travers le développement du sport et des activités de plein air, de l’art accessible à tous dans les musées, enfin de l’institution d’une politique de la recherche sans égal auparavant. Le député radical-socialiste Jean Zay, ministre de l’Éducation nationale entre 1936 et 1939, favorise la création d’associations comme les Auberges de jeunesse, le développement des mouvements de jeunesse tel le scoutisme, ou encore la pratique associative de la musique, du théâtre ; il œuvre aussi pour la vulgarisation scientifique (et c’est la création du Palais de la découverte), la connaissance des arts (le musée d’Art moderne) ou pour la pratique des loisirs (la radio, le cinéma, les sports d’hiver, le cyclotourisme), au moment du passage à la semaine des 40 heures et aux congés payés annuels de deux semaines. Mais surtout, une nouvelle « politique de la science » est mise en œuvre par le physicien Jean Perrin, sous-secrétaire d’État à la Recherche dans les deux gouvernements Blum. Perrin précise lors d’un débat budgétaire à la Chambre (11 décembre 1936) que « Berthelot ne doit pas faire oublier Renan » [21], invitant par là les députés à faire voter des fonds pour que les sciences traitant des « problèmes actuels de la vie des peuples » puissent se développer. Se créent alors divers instituts et surtout, par un arrêté du 10 juillet 1936, un Comité scientifique pour les « sciences humaines » au sein de la Caisse nationale de la recherche scientifique (sorte d’ancêtre du CNRS).
Ce nouvel essor des sciences humaines concerne très particulièrement le folklore. Or, avec le Front populaire, la gauche investit d’un sens nouveau la notion de « folklore ». En effet, avec les grandes grèves de 1936, les intellectuels communistes parlent d’un renouveau du « folklore ouvrier ». Un article de mars 1937 paru dans Clarté donne le ton : « il est tout à fait inexact de penser que le folklore ouvrier est mort. On a bien vu qu’il était encore vigoureux et sain en mai et juin 36 ». De même, dans la revue Regards datée d’août 1936, l’écrivain prolétarien Tristan Rémy appelle à une enquête ethnographique des grèves, pour en saisir les traits folkloriques [22]. Ainsi donc, pour la gauche, le folklore peut être désormais du côté des prolétaires, mais il reste par ailleurs ancré dans le « traditionnel » : en témoigne le Congrès d’Arles (décembre 1937) du Parti communiste qui accueille en son sein une manifestation du Félibrige, ou encore le parcours d’un Yann Sohier qui, avec son association Ar falz, cherche dès 1935 à combiner régionalisme breton, autonomisme et marxisme [23]. On pourrait citer aussi le cas de Léo Figuères, dirigeant important des Jeunesses communistes, qui en 1936 fait danser la sardane à ses ouailles. Rétrospectivement, ce type de combinaison paraît curieux.
Une période de renouveau du folklore avait commencé avec la création en 1929, sous le patronage de Sir James et Lady Frazer, de la Société de folklore français par Marcel Mauss, Lucien Lévy-Bruhl, Émile Nourry (dit Saintyves), Arnold Van Gennep et André Varagnac. Une revue associée voit le jour deux ans plus tard, la Revue de folklore français. Mais surtout, l’événement qui consacre l’institutionnalisation de la discipline est la création en 1937 du MNATP, placé sous la direction de Georges Henri Rivière.
La création du Musée national des arts et traditions populaires
Rivière (1897-1985) – « GHR » pour les familiers – est plus un muséologue qu’un théoricien de l’ethnologie ; néanmoins, on peut le considérer comme un personnage important sur la scène de l’anthropologie française du XXe siècle. Autodidacte (il est tout juste titulaire d’un baccalauréat), Rivière a dès l’enfance évolué dans un milieu où se côtoyaient artistes peintres, collectionneurs et conservateurs d’art. Organiste et pianiste amateur, improvisant à l’occasion sur des airs de jazz, ami des surréalistes, il connaît dans les années vingt le tout-Paris (il compose par exemple une chanson pour Joséphine Baker) et se fait embaucher par Paul Rivet, en raison notamment de son don pour les relations publiques et mondaines [24]. Personnage complexe, « agglomérat de contradictions », « épris du présent et des formes de la vie moderne » et pourtant s’occupant « de traditionalisme » selon l’ethnologue Alfred Métraux [25], il est animé par une obsession : créer à tout prix un grand musée d’Ethnologie de la France.
On sait que Paul Rivet décide de remanier le vieux musée d’Ethnographie du Trocadéro : il crée en 1937 le musée de l’Homme, qui occupe dès lors une aile du tout récent Palais de Chaillot. L’autre aile abrite un nouveau musée, le MNATP, regroupant officiellement depuis le 1er mai de cette même année les collections d’ethnographie folklorique de l’ancien musée d’Ethnographie du Trocadéro. Sur la demande de Rivière et de son collaborateur André Varagnac, Jean Zay a en effet intercédé auprès du Conseil et du Parlement pour que soit créé un « département de folklore » au sein de la Réunion des musées nationaux (janvier 1937). Les lieux d’étude du folklore se multiplient.
Depuis 1936, la Commission des recherches collectives (CRC), animée par André Varagnac, et sous la responsabilité de Lucien Febvre (qui dirige L’Encyclopédie française), s’occupe de lancer des enquêtes folkloriques sur l’ensemble du territoire. En outre, sont associés au musée parisien toute une série de musées provinciaux « de plein air » (Rivière s’est ici inspiré des musées de folklore suédois, inventés dès le début du siècle), dont les activités seront couplées à celles des Auberges de jeunesse. En 1938, il se voit confier un cours d’ethnographie folklorique à l’École du Louvre. Parallèlement, l’équipe du MNATP se lance dans les premières recherches monographiques de terrain en Bretagne, Berry, Normandie et Sologne [26]. En 1939 enfin, se crée une Commission nationale des arts et traditions populaires (destinée à promouvoir les recherches sur le folklore), composée de représentants des musées de plein air et de grandes figures parisiennes, notamment Marc Bloch et Marcel Mauss. Le folklore a donc le vent en poupe.
Mais de quel folklore s’agit-il ?
Nationalisme et traditionnisme, ou internationalisme et modernisme ?
À l’École du Louvre de Paris s’est tenu, du 23 au 28 août 1937, le 1er Congrès international de folklore. Ce vaste rassemblement (plus de 300 participants) est présidé par Paul Rivet (qui est anthropologue physique, mais s’occupe aussi d’organiser la recherche ethnologique au musée de l’Homme). Le secrétaire général est Georges Henri Rivière, assisté de son bras droit, André Varagnac. Il a pour vice-présidents les principales figures des sciences sociales du moment : Henri Berr, Marc Bloch, Célestin Bouglé, Albert Demangeon, Lucien Febvre, René Maunier, Marcel Mauss, Henri Focillon… auxquels vient s’adjoindre le « pape » du régionalisme, Jean Charles-Brun – il faut dire que le Congrès coïncide avec le 32e Congrès de la Fédération régionaliste française.
L’historienne Catherine Velay Vallantin s’est penchée sur les travaux de ce congrès et relève que les savants français adoptent la même posture qu’au Congrès mondial des loisirs de 1936 : ils se rangent explicitement du côté du Front populaire et de l’internationalisme antifasciste. De ce point de vue, les créations folkloriques sont perçues par eux comme des « terrains nourriciers de rébellions populaires » [27], le « peuple » de province étant du coup placé sur le même plan que les peuples colonisés. Se dessine alors toute l’ambiguïté de la période : d’un côté, les nouveaux folkloristes veulent voir dans les faits folkloriques des témoignages d’une sorte d’internationalisme populaire (le folklore s’inscrivant dans la lutte des classes) mais, de l’autre, cette valorisation du folklore vient paradoxalement renforcer le sentiment national. Rivière le confirme dans le Journal Officiel du 22 juin 1938 en évoquant « le rôle que pourrait jouer le folklore dans les loisirs des citadins et campagnards, en particulier par le chant à l’école et le développement de ces groupes folkloriques qui deviennent un véritable élément de propagande française à l’étranger » [28].
Effectivement, comme ce fut le cas au Congrès mondial des loisirs de 1936, les folkloristes mobilisent les valeurs traditionnelles pour défendre leur vision politique contre celles des organisations folkloriques nazies (le Kraft durch freude) ou fascistes (le Dopolavoro).
Interprété selon une logique « progressiste », le folklore est dès lors présenté à la fois comme un ensemble de traditions à sauver de la disparition (selon un vieux poncif remontant au moins à l’Académie celtique), mais aussi à rénover (et là, c’est une attitude nouvelle). Ainsi, au Congrès de 1936, Guy Le Floch, secrétaire général de la société des amis des arts populaires, annonce : « Nous voudrions sauver nos vieilles danses de folklore, rénover la chanson paysanne, moderniser le costume régional et en répandre la mode, au moins pendant les loisirs. » [29]
Voilà un point rétrospectivement difficile à comprendre, tant le folklore sous le Front populaire nous apparaît comme un mélange d’éléments contradictoires : non seulement le régionalisme et le nationalisme viennent justifier l’internationalisme, mais en outre la « tradition » est sollicitée pour fabriquer la « modernité ».
Recueillir les « survivances » pour sauver le « populaire » : le cas des musiques folkloriques
Dans les actes de ce congrès, le folklore apparaît tout d’abord comme l’étude du « populaire » par le repérage et la conservation de survivances – ce qui ne le distingue pas vraiment du folklore plus ancien, comme celui de l’Académie celtique. Ainsi Rivet définit-il, en séance d’ouverture, cette science comme celle des « survivances », soit une culture restée figée à un degré plus ancien de civilisation. Et il insiste sur l’urgence qu’il y a à les étudier : « Le folklore est l’étude de ce qui survit, dans une société évoluée, de coutumes, d’habitudes de vie, de traditions, de croyances appartenant à un stade antérieur de civilisation. Une telle étude est urgente et l’on peut même se demander si elle n’a pas été entreprise trop tardivement dans bien des pays. » [30] Il est vrai que dans les années trente, la petite paysannerie française, qui avait jusque-là gardé sa stabilité alors qu’elle avait déjà disparu dans les pays plus rapidement industrialisés comme l’Angleterre, se trouve menacée d’extinction. La culture paysanne est bel et bien en train, si ce n’est de péricliter, au moins de se transformer radicalement [31], aussi comprend-on qu’en recueillir les traditions puisse apparaître urgent aux folkloristes. La définition de ce qui « survit » à l’époque, par rapport aux éléments culturels nouveaux, reste cependant problématique. En effet, où placer la limite entre ce qui est « traditionnel » et ce qui ne l’est pas ? Cette question n’est jamais posée, ce qui laisse entendre implicitement que la tradition et la modernité industrielle sont incompatibles.
Rivière, dans une conférence de 1936, expose quant à lui pourquoi le folklore ne fait plus que survivre : la création populaire disparaît car elle est « étouffée par la production industrielle » ou par « l’art moderne savant » [32]. Donc, le « populaire » n’est ni moderne, ni savant et il faut d’urgence sauver ce qui « survit » encore de lui à l’époque contemporaine. Une telle définition est récurrente, elle apparaît comme évidente et n’est jamais explicitée.
Pour le cas du folklore musical, l’entre-deux-guerres voit le développement des techniques d’enregistrement sonores et surtout l’essor de l’industrie du disque. D’un côté, cela permet le développement de la collecte des musiques « traditionnelles ». De l’autre, la diffusion par la radio et le disque de chansons enregistrées va contribuer progressivement à figer la forme du répertoire folklorique traditionnel et à le faire disparaître. Une telle contradiction n’échappa pas bien sûr aux folkloristes. Or, la collecte savante des musiques « populaires » et « françaises » a commencé : en 1911, le grammairien et historien de la langue française Ferdinand Brunot inaugure à la Sorbonne les Archives de la parole, première étape d’un Institut de phonétique voulu par l’université de Paris. Grâce au mécénat d’Émile Pathé, qui fournit un laboratoire d’enregistrement et du personnel, ces archives sonores marquent l’introduction du phonogramme comme outil de connaissance de la tradition. Les Archives de la parole se veulent un lieu d’enregistrement et de conservation, pour les générations futures, des manifestations orales de la langue parlée. Ferdinand Brunot fixe alors un programme d’enregistrements sonores visant notamment à recueillir « la parole au timbre juste, au rythme impeccable, à l’accent pur » comme « la parole nuancée d’accents faubourien ou provincial » [33], mais aussi à enregistrer les patois et dialectes de France (et, dans une moindre mesure, des colonies), afin de constituer un « atlas linguistique [phonographique] de la France ».
En 1924, les Archives de la parole deviennent le musée de la Parole et du geste, qui est renommé Phonothèque nationale en 1938. Le journaliste et écrivain Roger Dévigne (1885-1960) est nommé directeur du musée de la Parole en 1932, puis directeur de la Phonothèque nationale en 1938. À côté de la conservation de tous les enregistrements faits sous dépôt légal, Dévigne préconise la réalisation d’une encyclopédie sonore « des parlers, patois et vieux chants de France ». La première mission a lieu en 1939 (Alpes provençales), mais la plus importante sera réalisée sous Vichy : la mission « Languedoc-Roussillon » permettra de recueillir plus de 100 enregistrements entre octobre 1941 et août 1942.
Le MNATP n’est pas en reste dans cette quête de la « pureté » musicale populaire, puisque des recherches de musicologie populaire y sont menées, sous la responsabilité de Claudie Marcel-Dubois (elle a conduit, notamment, une mission en Basse-Bretagne en juillet-août 1939, avec l’abbé et érudit local Falc’hun). Son allocution au Congrès de folklore de 1937, portant sur la question du folklore musical, commence avec une critique de la « variété », qui vient détruire les anciens instruments : « L’importance actuelle de l’accordéon, des disques, du poste de TSF favorise l’abandon des instruments populaires traditionnels de France. » Puis elle dresse la liste des instruments « survivants » (vielles à roues, flûtes, trompes), qui doivent lutter contre « l’intrusion » des instruments non folkloriques (accordéon, violon, grosse caisse) et contre le développement du pick-up et de la TSF, supposés supplanter toute pratique instrumentale (« même l’accordéon », précise-t-elle ! [34]).
Ce qui est frappant dans cette analyse, c’est le jugement de valeur porté sur l’évolution des pratiques instrumentales populaires. En effet, à côté des bonnes et belles pratiques populaires « traditionnelles », Marcel-Dubois juge de manière extrêmement péjorative les pratiques « modernes », ce qui ressemble à un jugement à l’emporte-pièce, et suscite dès lors des questions : la TSF supprime-t-elle véritablement toute forme de pratique musicale populaire ? On peut sérieusement en douter. Par ailleurs, pourquoi un musicien « populaire » jouant de la vielle ne le serait plus s’il se met à l’accordéon ? Derrière ces jugements de valeur se dessine un mépris de la société industrielle et de ses productions culturelles standardisées (disque et radio), en même temps qu’une glorification des productions musicales folkloriques, « pures » et paysannes, et la hantise de leur disparition. Pourtant, les traditions « pures » ont-elles jamais existé, à part dans un temps largement mythologique, celui où le « vrai » habitant de chaque « pays » chantait, dansait et parlait un dialecte de manière « authentique » ? À côté de l’aspect indéniablement novateur de ces recherches ethnomusicologiques (enregistrer des pratiques anciennes, étudier leur évolution et leur répartition sur le sol national), le participant au congrès est donc renvoyé à un habitant idéal et intemporel associé de manière symbiotique à un pays et une tradition. On a donc du mal à voir en quoi la vision musicale présentée ici pourrait être « moderne » et « internationaliste » et s’inscrire dès lors dans la logique « progressiste » du Front populaire. La contradiction apparue plus haut persiste.
Survivances ou folklore vivant au MNATP ?
Cependant, le projet initial du MNATP prévoyait de faire une place au folklore urbain et ouvrier, c’est-à-dire à un folklore prenant en compte la réinvention de la tradition, la création d’œuvres populaires en contexte contemporain. Ainsi Marcel Maget, ethnologue faisant partie de la nouvelle équipe de Rivière, affirme-t-il avoir réalisé en 1937 et 1938 une série de photographies ayant pour thème les boulangeries parisiennes. Quant à Varagnac, il pense à profiter des grandes grèves de 1936 pour observer les manifestations de « folklore spontané » – des photographies témoignent de cette démarche, comme celle prise par Henry Lehmann sur « l’enterrement de la semaine des quarante-huit heures », au sein d’une manifestation ressemblant quelque peu à un rituel carnavalesque. Une autre collaboratrice du musée, Agnès Humbert, insiste dans Clarté sur la nécessité d’étudier la « culture ouvrière » [35]. Rivière et Varagnac commentent dans cet esprit l’apparition de fêtes improvisées lors des grèves de 1936 : « Vous vous rappelez ce qui s’est passé au début des occupations d’ateliers et de chantiers […] ils se sont mis à improviser des fêtes entre eux. En quelques jours on a assisté ainsi à la plus surprenante éclosion de festivals populaires que notre Histoire ait connu depuis les bals en plein air de la grande Révolution. […] Le folklore manifeste donc la puissance créatrice, les réserves d’art que recèle le peuple de nos campagnes et de nos villes. » [36]
Il s’agit là surtout d’ébauches de recherches sur le folklore ouvrier. En pratique, il en va différemment. Les « véritables » traditions populaires doivent être les plus pures possibles et Rivière lui-même, pourtant concerné par les traditions nouvelles et citadines, entérine une telle vision des choses. Ainsi, le plan d’organisation du nouveau MNATP, établi en 1937 par Agnès Humbert sur les conseils de Rivière, reflète-t-il ses conceptions du nouveau folklore : une salle d’introduction situera le folklore dans son cadre « racial » (le mot est à prendre dans son sens anthropologique), linguistique et historique ; puis les salles seront divisées en treize sections consacrées aux différents « genres de vie ». Plus exactement, les sections définissant chacune un genre de vie renvoient le visiteur, selon les cas, à l’influence de la géographie sur la culture (forêts, champs, montagne, cours d’eau) mais aussi à un ensemble de faits culturels variés (communications, village, ville, commerce, costume, âges de la vie, calendrier) [37]. Or, la salle des villes subit des transformations par rapport au plan initial pour entrer dans une conception plus traditionniste : au lieu du projet d’Agnès Humbert sur « l’évolution ouvrière » est placée une présentation des quartiers populaires et de l’artisanat.
Le cadre conceptuel apparaît donc clairement : le folklore est fait de survivances traduisant la vie symbiotique entre la « race » et les traditions des habitants d’un côté, le climat et la géographie du « pays » de l’autre. Autant dire que, chassée par la porte au nom de la modernisation du folklore, la mythologie de l’identité nationale revient par la fenêtre. Ce choix s’est-il imposé aux concepteurs du musée à cause de l’effet d’exotisme qu’il produit ? Pensaient-ils que le folklore paysan serait plus « vendeur », pour le grand public, que le folklore ouvrier ? Le paysan apparaissait-il comme un objet d’étude plus « sérieux » que l’ouvrier ? Ou simplement les moyens limités et le matériau ethnographique disponible (provenant des collections du musée d’Ethnographie du Trocadéro) commandaient-il ce type d’organisation ? Une autre raison est peut-être que Rivière a cherché toutes les alliances possibles, notamment avec les notables de province, très conservateurs : les liens stratégiques qui se formaient là ont nécessairement influencé la conception globale du « folklore ».
Mais, quelles que soient les véritables raisons – Front populaire ou pas – on trouve là confirmation que, dans les représentations collectives du moment, l’identité nationale française s’échafaude bien plus facilement sur le stéréotype du paysan issu de son « pays » que sur celui des ouvriers.
Traditionnalisme ou recherche de la modernité ? Le cas de Varagnac
André Varagnac (1894-1983), neveu de l’illustre figure de la SFIO Marcel Sembat [38], est dans sa jeunesse professeur de philosophie au collège et, par ailleurs, journaliste situé à gauche : collaborateur littéraire au Journal des Débats (un journal centriste) entre 1912 et 1914, au Crapouillot de 1918 à 1920 (journal pamphlétaire de gauche né dans les tranchées de la guerre de 1914-1918), il devint par la suite secrétaire de rédaction de L’Europe nouvelle entre 1921 et 1922 (ce journal, dirigé par Louise Weiss à partir de 1920, défendait l’idéal de la SDN) puis de Clarté entre 1923 et 1925 (ce journal pacifiste à ses débuts s’orienta vers le communisme à partir de 1923). Il se tourne ensuite vers ce qui va devenir sa passion : le folklore. Il suit les cours d’Henri Hubert puis de Marcel Mauss [39], avant de se lancer dans ses propres recherches. C’est l’année de la parution de son livre Instinct et technique (1929) qu’est fondée la Société de folklore français ; il en est l’un des membres fondateurs.
En 1929, il crée les premiers Comités régionaux de folklore (Champagne, Mâconnais). Il devient ensuite chargé de recherche de la Caisse nationale des Sciences (1931-1935). Dans les années trente, il est aussi secrétaire général de la Commission de recherches collectives (CRC), associée à l’Encyclopédie française (1934-1936) et au Centre international de Synthèse. Au moment de la création du MNATP, il est nommé directeur adjoint.
Varagnac, comme les chercheurs groupés autour de Rivière, s’intéresse aux traditions urbaines voire aux rites en train de naître [40]. Il publie même dans la Revue de folklore français et de folklore colonial un « projet de questionnaire sur le folklore des grèves » [41]. Mais Varagnac s’investit surtout dans la vaste enquête menée au sein de la CRC, qui s’appuie sur un réseau nouveau : la très grande majorité des collaborateurs bénévoles est constituée d’instituteurs qui, dans les villages, sont également en charge du secrétariat de la commune [42].
Entre 1934 et 1939, quatre « questionnaires » sont mis au point ; ils portent sur les usages durant les moissons et les feux traditionnels, la forge de village, l’alimentation populaire, les modes de locomotion et de transport traditionnels. La méthode utilisée est celle du questionnaire fermé, élaboré notamment par André Varagnac en collaboration avec le premier « Comité-laboratoire » de folklore, le Comité champenois établi à Châlons-sur-Marne, dont on s’accorde à dire qu’il permettait de collecter des « faits » localisés mais préalablement construits [43]. Les « faits » existaient en effet en idées avant que l’enquête n’en rende compte, puisqu’ils étaient modélisés par les savants parisiens. Les collaborateurs locaux n’avaient qu’à les vérifier sur le terrain.
À côté de cette conception « idéelle » du folklore, on retrouve dans les enquêtes une tension entre traditionnisme et recherche de la modernité.
Pour Bertrand Müller, si le premier questionnaire se focalise purement et simplement sur des survivances, le second au contraire « [doit] permettre de cerner non pas des survivances, ni même des pratiques folkloriques, mais les transformations d’un métier, dans ses multiples dimensions » [44].
Mais comment Varagnac conçoit-il le folklore ? Dans son ouvrage Définition du folklore [45], il apparaît somme toute assez classique et en parfaite phase avec l’équipe du MNATP. L’auteur refuse de limiter l’étude du folklore à la seule vie paysanne, comme il se refuse d’avoir recours aux seules notions de « traditions » et de « vie populaire ». Sa définition est plus large : « Le folklore, ce sont des croyances collectives sans doctrine, des pratiques collectives sans théorie » [46]. Cette définition est bien celle de Rivière : on y retrouve la notion de croyance collective et la distinction du savant et du populaire. Cependant, la tension entre tradition et modernité s’estompe rapidement pour revenir à une conception nettement moins progressiste de la tradition : « Tout fait folklorique peut répondre, au cours des siècles, à des besoins différents et à des mentalités différentes. Ainsi d’une part, il pourra être considéré comme le témoignage non seulement de pensées et de croyances archaïques, mais aussi de “genres de vie” très anciens, au sens que la géographie humaine a donné à cette notion ; et, d’autre part, il sera susceptible de survivre à la décadence ou même à la disparition complète de sa fonction première. Sa fonction pourra varier à l’avenir comme elle a varié déjà, sans que sa forme devienne vraiment méconnaissable. » [47]
Où est passé le refus de l’archaïsme ? Dans cette définition, la tradition renvoie à un temps long, à un enracinement des modes de vie paysans dans le sol – et à une inquiétude face à la « décadence ». Décidément, l’angoisse des raciologues d’une « décadence de la civilisation » trouve quelque écho chez les folkloristes (même si chez eux, il s’agit d’une civilisation « archaïque »). D’ailleurs, le sentiment qu’éprouve Varagnac à ce sujet se trouve explicité dans un petit ouvrage, à mi-chemin entre les sciences humaines et les sciences naturelles, qui est censé révéler le secret du comportement de l’être humain : Instinct et technique. Remarques sur les conditions externes du comportement humain [48].
Avançant que l’homme posséderait des cycles de vie qui seraient calqués sur ceux de la nature, il conclut que, dans notre « nouvelle activité industrielle », les réactions de l’homme sont commandées « par la machine ou les nécessités de l’échange ». Il pose donc la question cruciale : « Que deviennent nos potentialités instinctives ? » et répond qu’elles disparaissent car l’homme moderne ne subit plus « le cours cyclique des variations d’un milieu naturel ». Il précise : « […] chaque civilisation établissait lentement un modus vivendi particulier, que permettait avant tout le caractère traditionnel des diverses activités, caractère résultant lui-même de leur subordination constante aux forces de la nature. Désormais la dépendance envers un certain agencement perpétuel du milieu a disparu ou tend à disparaître : du coup l’un des éléments régulateurs du comportement naturel s’évanouit ; des stimulations externes indépendantes de notre volonté viennent de moins en moins susciter l’éveil régulier des instincts. »
L’idée directrice de l’ouvrage est la suivante : depuis la révolution industrielle, l’homme ne s’adapte plus à la nature comme il le faisait auparavant ; désormais, il la transforme. Du coup, il perd ses anciens « instincts » (ceux qu’on pouvait observer dans les « civilisations traditionnelles ») qui lui permettaient d’être en harmonie avec son environnement, et il ne possède plus que des « réflexes ». L’homme moderne, victime de la civilisation mécanique et industrielle, ne possède plus la notion de la « longue durée » : il vit désormais dans l’instant. À la limite, il ne porte plus en lui son « destin », c’est-à-dire la trace des générations passées qui fait la richesse de sa culture ; il vit dans « l’existence » éphémère et les plaisirs futiles.
Pour Varagnac, il s’agit alors d’accéder à un nouveau stade de l’humanité dans lequel l’homme aurait à nouveau conscience de son destin : il s’agit de « réorganiser rationnellement » l’être humain, afin qu’il se réinscrive à nouveau dans la longue durée et dans ses instincts ancestraux. En résumé, on trouve dans la pensée de Varagnac des éléments de lamarckisme, de darwinisme social, d’eugénisme et de l’écologie naissante.
En ce qui concerne l’écologie, dont on sait qu’elle n’était pas inconnue des géographes français du début du siècle, et notamment de Vidal de La Blache [49], il faut noter que le botaniste anglais Georges Arthur Tansley proposait en 1935, dans un fameux article pour la revue Ecology, l’un des concepts fondamentaux de cette science : l’écosystème, ou système écologique, notion qualifiant un système (au sens physique du terme) qui comprend à la fois les organismes vivants et les facteurs physiques du milieu. Selon Tansley, l’écosystème est « le résultat inévitable des interactions et par conséquent des ajustements mutuels entre leurs composants » [50]. On pourrait penser que Varagnac a cherché à appliquer cette notion d’écosystème aux sociétés humaines, en postulant que la culture traditionnelle se trouve en équilibre dans un système qui la relie au milieu ambiant. Néanmoins, il ne fait aucune référence directe à une telle notion, ni à aucun autre concept de l’écologie de l’époque (la « niche écologique » est en usage depuis les années vingt, de même que les notions de « chaîne alimentaire », de « facteur limitant » ou de « pyramide des nombres »). En outre, ses idées d’une harmonie entre l’homme et les cycles de la nature relèvent plus du postulat que de la démonstration.
On peut alors évoquer une autre source d’inspiration de la pensée de Varagnac : la tradition ésotérique. En effet, l’idée que l’homme doit régler ses travaux sur les cycles de la nature, eux-mêmes liés aux cycles des planètes, se trouve déjà présente dans la doctrine anthroposophique, fondée par Rudolf Steiner dans les années 1910 [51]. Georges Rose, qui a étudié les racines idéologiques du courant politique « écologique » (à distinguer de la science écologique) ou « biologique » des années 1970 (notamment chez le principal théoricien de l’agriculture biologique, Xavier Florin [52]) rappelle que la « biodynamie », l’une des branches de l’anthroposophie, postulait l’idée d’une harmonie entre l’agriculture « naturelle » et le monde et que grâce à elle, l’homme se réglerait sur les cycles de la nature (c’est-à-dire les rythmes saisonniers réglés par les astres) et trouverait ainsi le bonheur. Steiner postulait, dans son ouvrage Agriculture. Fondements spirituels de la méthode bio-dynamique [53], que l’homme devait faire confiance à son « instinct » pour retrouver la « sagesse paysanne » (en ayant recours à la seule « science pure » : l’astrologie [54]).
Dans sa façon de concevoir le folklore, Varagnac, homme de gauche, se rapproche donc des conservateurs sur bien des points, puisqu’il postule que le progrès est la bête noire de l’humanité. Il s’agira avant tout pour lui de retrouver des traces « durables » de culture, des éléments matériels (costumes régionaux, aliments, mégalithes) qui viendront témoigner de l’ancienneté de la civilisation française. Le parallèle avec son aîné Louis Marin se dessine très nettement, malgré leurs dissensions politiques : Marin était fasciné par les Gaulois ; Varagnac travaillera des années plus tard sur l’art gaulois. Les deux personnages avaient aussi en commun cette obsession de la « longue durée », valeur que ne posséderait plus le monde moderne [55].
La critique des survivances chez Van Gennep
Arnold Van Gennep (1873-1957), autre personnage inclassable, parfois taxé d’« anarchiste » et difficile de caractère, n’a jamais occupé de poste universitaire si ce n’est hors de France, la chaire d’ethnographie de l’université de Neuchâtel entre 1912 et 1915, et il ne touchera sa première subvention de recherche qu’à l’âge de 73 ans (accordée en 1945 par le CNRS) [56]. Il semble céder moins facilement que ses contemporains aux sirènes de l’identité nationale.
Pour le savant, relève tout d’abord de l’étude folklorique tout ce qui est « populaire » [57] (créé par le peuple) mais qui n’a pas été « popularisé » (i.e. inventé par quelqu’un dont l’identité est parfaitement établie et utilisé ultérieurement par le peuple, par exemple : les contes de fées de Perrault). La deuxième caractéristique du fait folklorique est, selon Van Gennep, qu’il relève de l’oral mais aussi dans certains cas de l’écrit (il s’agit ici des notes manuscrites et non imprimées). La troisième particularité du savoir folklorique est enfin pour lui qu’il est par définition « traditionnel », à savoir ni dogmatique ni codifié (il n’est notamment pas le fruit d’une création de l’État).
Après l’avoir défini, Van Gennep décrit la façon dont on doit interpréter le folklore [58]. Notons tout de suite qu’il souscrit à une idée caractéristique de son époque, laquelle apparaît rétrospectivement comme ethnocentrique. En effet, selon lui, le « peuple » raisonne plus par esprit de « participation » que par la raison et il utilise plus l’intuition que les raisonnements inductif et déductif. Il dit emprunter l’idée à Lucien Lévy-Bruhl [59] et précise que le peuple français partage ce type de pensée avec les « primitifs ». Néanmoins il affirme que les deux modes de pensée, rationnel et participatif, sont communs à toute l’espèce humaine et que, selon le niveau de civilisation, ce sont les proportions qui varient.
Précisons aussi qu’il préconise l’explication de type « ethnique » (c’est à dire, ici, raciale), par exemple en définissant la proportion dans tel ou tel village des « type blond dit nordique et du type brun dit alpin » et en citant l’autorité en la matière, George Montandon [60]. Il affirme cependant que des mélanges ont eu toujours lieu entre différents villages et qu’il ne saurait y avoir d’isolats raciaux [61].
Mis à part ces présupposés que l’on trouverait aujourd’hui critiquables, il faut reconnaître au chercheur qu’il prend le contre-pied de bon nombre de théories à la mode de son temps. Il fustige notamment l’importance exagérée accordée aux « survivances », puisque selon lui, par analogie avec les théories sur les primitifs, certains folkloristes en ont déduit que le folklore était uniquement constitué de survivances du passé (soit de la « persistance dans les milieux variés de l’humanité actuelle dite “civilisée” de restes divers de civilisations antérieures considérées comme moins évoluées »). Van Gennep est contre cette notion, qu’il qualifie d’« évolutionniste », quand elle est appliquée de façon systématique et notamment au domaine intellectuel. Cette critique vise, entre autres, Varagnac sans qu’il soit explicitement cité.
Le deuxième type d’interprétation réfuté par l’auteur est ce qu’il nomme l’idée de « dégénérescence » selon laquelle les us et coutumes du passé faisaient de la France un « paradis social et mental » qui se serait irrémédiablement dégradé. Ce refus d’un « âge d’or » du passé français oppose Van Gennep à Varagnac pour qui, on l’a vu, la société, aujourd’hui pervertie, doit retrouver sa forme traditionnelle pour être à nouveau en accord avec la nature.
Van Gennep conclut sur la nécessité qu’il y a à repousser ces deux théories de la survivance et de la dégénérescence, puisqu’en tous temps et en tous lieux, l’humain a toujours été aussi intelligent, et qu’il n’y a donc pas de jugement de valeur ou de hiérarchie à faire sur les différentes cultures humaines. On sent ici l’influence de Mauss sur le folkloriste. Il préconise d’ailleurs la méthode comparatiste, chère à l’École ethnologique française de l’Institut d’ethnologie, en précisant qu’elle peut par exemple aider à percevoir l’origine orientale de certains contes.
Sa compréhension « maussienne » du folklore se remarque également quand il affirme refuser d’expliquer la mentalité par la géographie ou le climat : « Ici encore, on distinguera entre l’aspect statique et l’aspect dynamique des phénomènes folkloriques et on se gardera d’expliquer absolument par la nature montagnarde ou plagnarde, par le climat humide ou sec, relativement froid ou chaud des diverses régions de la France, non seulement les ensembles cérémoniels et l’activité intellectuelle populaires, mais même les éléments principaux de la civilisation matérielle comme les maisons, les ustensiles et les outils. » [62]
Modernité et tradition, le folklore comme oxymore
On a vu apparaître des différences théoriques notables entre Rivière, Varagnac et Van Gennep, mais tous tentent de reformuler la notion de « folklore ». Cette reformulation passe notamment par la notion de race : car, détail révélateur, ils sollicitent la race « anthropologique », mais ne font pas allusion à la notion folklorique de race. Pour autant, cette reformulation a-t-elle abouti ? On ne peut répondre simplement. De façon générale, le folklore de type Front populaire apparaît comme soumis à une tension assez difficilement tenable : à la fois traditionnel et moderne, à la fois nationaliste et internationaliste. Un des éléments d’explication réside dans le fait que le folklore est en pleine phase de construction institutionnelle : l’aspect scientifique et l’aspect politique sont très intimement mêlés. Les circonstances imposent un folklore élaboré sur fond de lutte des classes, qui se veut « modernisé », « rénové ». Cependant, la « rénovation » passe par la glorification de la tradition et la quête de la survivance, et par la suspicion (certes exceptionnellement exagérée chez Varagnac) vis-à-vis de la société industrielle. On a vu l’importance de la pensée ésotérique dans le milieu des sciences de l’homme. Elle seule permet d’expliquer cette fascination mystique pour « la tradition », sorte de mode de vie naturel idéalisé, situé hors de l’histoire et s’opposant en tout au monde « démoniaque » que propose la société industrielle.
Enfin, et c’est là toute l’ambiguïté, les valeurs de l’identité nationale restent malgré tout très présentes. Remarquons que chez Rivière, Varagnac ou Marcel-Dubois, ce folklore supposé fondé sur la lutte des classes ne traite pas des traditions populaires des migrants plus ou moins récents. Dans les années trente pourtant, nombreux sont les immigrés européens installés en France (Belges, Italiens, Espagnols sont majoritaires depuis le début du siècle, mais il existe aussi des communautés de Polonais juifs, etc.), dont un bon nombre sont naturalisés. Or, Français trop récents, ils ne sont pas étudiés par les folkloristes qui ne s’intéressent qu’à une « tradition » en équilibre avec le milieu naturel. Se pose alors la question de savoir à partir de combien de temps passé sur le territoire français une population peut être considérée comme « française », et a le « droit » d’être étudiée par les folkloristes. Un autre cas-limite se pose : celui des « indigènes » des colonies. Nombreux sont ceux qui ont migré en France métropolitaine, dont le statut juridique est complexe et ambigu, entre « Français » et « étrangers » [63]. En outre, il existe des « folklores coloniaux » dans les colonies françaises, dont certains ethnologues se sont faits spécialistes. Mais ces folklores, dont les populations sont pourtant intégrées au territoire de la « plus grande France », ne sont pas traités dans le projet de Rivière et son équipe. On voit donc de quelle manière le choix des populations « folklorisables » vient fabriquer une certaine idée de l’identité nationale.
Les folkloristes du Front populaire évoquent bien le folklore ouvrier, dont ils recherchent les « manifestations spontanées », mais le « vrai » folklore, le « cœur » du sujet, est surtout pour eux constitué du folklore paysan, dont ils veulent trouver les survivances. Derrière cette recherche se profile l’idée d’une identité nationale, sorte de substance façonnée sur la longue durée par le sol, le climat et la tradition (voire la race anthropologique). Grâce à cette opération magique, qui abolit le fait qu’elles aussi viennent de migrations plus anciennes, les populations paysannes se retrouvent parées de l’authenticité de leur caractère « français », ce qui les distingue absolument des autres populations résidant sur le sol national. Même débarrassé de l’ancienne notion de race « folklorique » chère aux régionaliste de la fin du XIXe siècle, même assoupli car perméable au monde ouvrier, le folklore de type « Front populaire » participe donc tout aussi solidement à la construction de la grande mythologie de l’identité nationale française.
NOTES
[1] Cf. Hermann Bausinger, Volkskunde ou l’ethnologie allemande. De la recherche sur l’antiquité à l’analyse culturelle, Paris, Éditions de la MSH, 1993, [1re éd. allemande : 1971], p. 64.
[2] Cf. Utz xe "Jeggle, Utz" Jeggle, « L’ethnologie de l’Allemagne sous le régime nazi. Un regard sur la Volkskunde deux générations après », Ethnologie française. Ethnologie et racismes, n° 2, 1988, pp. 114-119.
[3] Cf. Hannjost Lixfeld, Folklore and Fascism. The Reich Institue for German Volkskunde, Bloomington/Indianapolis, Indiana University Press, 1994, edited and translated by James D. xe "Row, James D." Row.
[4] Ibid., p. 84.
[5] Cf. Édouard Conte et Cornelia Essner, La Quête de la race, op. cit., pp. 24-26.
[6] Cf. Anne-Marie xe "Thiesse, Anne-Marie" Thiesse, La Création des identités nationales, op. cit., pp. 261 sq.
[7] Cf. Volkstum und Heimat, n° 1, avril 1934, cité in Thiesse, La Création des identités nationales, op. cit.
[8] Cité in Catherine xe "Velay Vallantin, Catherine" Velay Vallantin, « Le Congrès international de folklore de 1937 », Annales HSS, mars-avril 1999, n° 2, pp. 481-506 ; p. 485 pour cette référence.
[9] Sur Louis Marin, cf. Herman xe "Lebovics, Herman" Lebovics, « Le conservatisme en anthropologie et la fin de la troisième République », Les Cahiers de Gradhiva, n° 4, 1988, pp. 3-17 ; Fernande xe "Marin, Fernande" Marin, Louis Marin, 1871-1960 : homme d’État, philosophe et savant, Paris (s. ed.), 1973.
[10] La Fédération républicaine, créée en 1903 (année de la première inscription de Louis Marin), fut successivement renommée : Groupe progressiste (1905), Entente démocratique (1914) et enfin Union républicaine démocratique (1924).
[11] Marin, lui, refusera de voter les pleins pouvoirs à xe "Pétain, Philippe" Pétain (il voulait continuer la guerre), mais conservera malgré tout des rapports avec le gouvernement à Vichy, où son activité politique restera, semble-t-il, discrète. En mai 1944, Marin rejoindra la Résistance à Londres. À la Libération, il tentera de faire revivre son parti, sans grand succès, et abandonnera la politique en 1951.
[12] Au passage, il précise que cette grandeur est menacée par les ennemis extérieurs et les ennemis « intérieurs », les communistes. Cf. Louis Marin, L’Éternel communisme et sa menace présente, Paris, Société d’économie sociale, 1925.
[13] Cf. Louis Marin, Regards sur la Lorraine. Réflexions sur des notions fondamentales, particularités du caractère lorrain, Paris, Publication posthume par Mme Louis xe "Marin, Fernande" Marin, 1966.
[14] Id., « Questionnaire d’ethnographie », extr. Bull. de la Société d’ethnographie, 1925.
[15] Id., Les Contes traditionnels en Lorraine : institutions de transfert des valeurs morales et spirituelles, Paris, 1964, p. 158.
[16] Id., Regards sur la Lorraine, op. cit., pp. 25-26.
[17] Cf. Herman xe "Lebovics, Herman" Lebovics, « Le conservatisme en anthropologie et la fin de la troisième République », op. cit., p. 10.
[18] Cité in Jean-André xe "Renoux, Jean-André" Renoux, L’Académie des sciences d’outre-mer, hommes et destins, 7 tomes, 1975-1986. Sur les positions antiracistes de Marin, voir aussi Louis Marin, Regards sur la Lorraine, op. cit., pp. 63-64.
[19] Ibid.
[20] Cf. Herman xe "Lebovics, Herman" Lebovics, La « Vraie France », op. cit., p. 23.
[21] Cf. Pascal Ory, La Belle Illusion. Culture et politique sous le signe du Front populaire, 1935-1938, Paris, Plon, 1994, p. 491.
[22] Ces deux références sont issues de Pascal xe "Ory, Pascal" Ory, La Belle Illusion, op. cit., p. 499.
[23] Cf. Pascal Ory, La Belle Illusion, op. cit., pp. 500-501.
[24] Cf. Nina xe "Gorgus, Nina" Gorgus, Le Magicien des vitrines. Le muséologue Georges Henri xe "Rivière, Georges Henri" Rivière, Paris, Éditions de la MSH, 2003.
[25] Ces deux références sont issues de Martine xe "Segalen, Martine" Segalen, Vie d’un musée, 1937-2005, Paris, Stock, 2005, (« Un ordre d’idées »), p. 9.
[26] Cf. Isac xe "Chiva, Isac" Chiva, « Georges Henri Rivière : un demi-siècle d’ethnologie de la France », Terrain n° 5, 1985, pp. 76-83 ; p. 80 pour cette référence.
[27] Cf. Catherine Velay Vallantin, « Le Congrès international… », op. cit., p. 483.
[28] Cité in Pascal xe "Ory, Pascal" Ory, La Belle illusion, op. cit., p. 502.
[29] Cité in Catherine Velay Vallantin, « Le Congrès international… », op. cit., p. 484.
[30] Ibid., p. 494.
[31] Cf. Robert O. xe "Paxton, Robert O." Paxton, Le Temps des Chemises vertes. Révoltes paysannes et fascisme rural, 1929-1939, Paris, Le Seuil, 1996 (« L’Univers historique »), pp. 23 sq.
[32] Cf. Georges Henri Rivière, in Revue de folklore français et de folklore colonial, mai-juin 1936, p. 13.
[33] Cf. « Le Musée de la Parole », Paris-Journal, 21 mars 1910.
[34] Cf. Claudie xe "Marcel-Dubois, Claudie" Marcel-Dubois, « L’instrument musical populaire en France », in Ier Congrès international de folklore, Paris, août 1937, Tours, Arrault et Cie, 1938, pp. 377-381.
[35] Pour ces références, cf. Nina xe "Gorgus, Nina" Gorgus, Le Magicien des vitrines, op. cit., p. 117.
[36] Georges Henri Rivière et André Varagnac , « Folklore », Midi socialiste, 26 janvier 1937, cité in Edouard Lynch, « L’agriculture au Centre rural de l’Exposition internationale de 1937 : entre agrarisme, folklore et modernisation », in Denis-Michel Boëll, Jacqueline xe "Christophe, Jacqueline" Christophe et Régis xe "Meyran, Régis" Meyran (dir.), Du Folklore à l’ethnologie, 1936-1945, Paris, Éditions de la MSH, 2009, pp. 63-75 ; p. 73 pour cette référence.
[37] Catherine xe "Velay Vallantin, Catherine" Velay Vallantin, « Le Congrès international de folklore… », op. cit., p. 497.
[38] Sauf mention précise, les autres renseignements biographiques sur Varagnac sont extraits des ouvrages suivants : Dictionnaire biographique contemporain, 2e éd., 1954-55 (10) ; le Livre d’or des valeurs humaines, 1970, p. 79 ; Who’s Who 1955-1956 ; Maitron, vol. 44, biographies nouvelles.
[39] Cf. André Varagnac, Civilisation traditionnelle et genre de vie, Paris, Albin Michel, (« Sciences d’aujourd’hui »), 1948, p. 12.
[40] Outre Nina xe "Gorgus, Nina" Gorgus, Le Magicien des vitrines, op. cit., voir Daniel xe "Fabre, Daniel" Fabre, « L’ethnologie française à la croisée des engagements (1940-1945) », op. cit., p. 326. Cf. aussi Pascal xe "Ory, Pascal" Ory, La Belle illusion, op. cit., p. 508.
[41] Cf. André Varagnac, « Projet de questionnaire sur le folklore des grèves », Revue de folklore français et colonial, vii, 1936, p. 130.
[42] Cf. Bertrand xe "Müller, Bertrand" Müller, « Écrire le folklore : les réponses aux enquêtes de la Commission des recherches collectives de l’Encyclopédie française », in Denis-Michel Boëll, Jacqueline xe "Christophe, Jacqueline" Christophe et Régis xe "Meyran, Régis" Meyran (dir.), Du Folklore à l’ethnologie, 1936-1945, op. cit., pp. 29-48.
[43] Cf. Daniel Fabre, « Revues d’ethnologie et ethnologie dans les revues », in Au miroir des revues. Ethnologie de l’Europe du Sud, Carcassonne, Garae/Hésiode, 1991, p. 19.
[44] Cf. Bertrand Müller, « Écrire le folklore : les réponses aux enquêtes de la Commission des recherches collectives de l’Encyclopédie française », op. cit.
[45] Cf. André Varagnac, Définition du folklore, Paris, Éditions géographiques, maritimes et coloniales, 1938.
[46] Ibid., p. 18.
[47] Ibid., pp. 25-26.
[48] Cf. id., Instinct et technique. Remarques sur les conditions externes du comportement humain, Paris, Librairie moderne de droit et jurisprudence, 1929.
[49] Cf. Jean-Marc xe "Drouin, Jean-Marc" Drouin, L’Écologie et son histoire. Réinventer la nature, Paris, Flammarion, 1993, (« Champs »), [1re éd. : Desclée de Brouwer, 1991], p. 95.
[50] Ibid., p. 93.
[51] Rudolf Steiner (1861-1925) fut un membre dissident de la Société théosophique fondée à la fin du xixe siècle par Mme xe "Blavatsky, Helena" Blavatsky. Voir Wiktor xe "Stoczkowski, Wiktor" Stoczkowski, Des Hommes, des dieux et des extraterrestres, op. cit., p. 224.
[52] Florin parlait dans un entretien avec Georges Rose des « paysages harmonisés, adaptés aux milieux où ils ont été façonnés, mettant en valeur les potentialités idéales, la personnalité profonde d’une région ». Cf. Georges Rose, Écologie et tradition. Influences cosmiques dans l’agriculture biologique et les traditions populaires, Paris, Maisonneuve et Larose, 1981, p. 29. L’homologie d’un tel discours avec les articles de xe "Varagnac, André" Varagnac font de ce dernier un précurseur du courant « bio ».
[53] Cf. Rudolf Steiner, Agriculture. Fondements spirituels de la méthode bio-dynamique, Genève, Éditions anthroposophiques romandes, 1974, [1er éd. : ?].
[54] Cf. Georges Rose, Écologie et tradition, op.cit., pp. 29 sq.
[55] Louis Marin écrivait par exemple : « La faiblesse présente des esprits ne va-t-elle pas jusqu’à souhaiter, éperdument et inconsciemment, du “neuf”, toujours du nouveau. Et cela, sans comprendre que le nouveau n’est désirable que quand il représente un progrès répondant à un besoin précis ; sans comprendre que, aux plus belles époques, des artistes et des artisans, la mode elle-même, symbole du caprice, obéissent, dans leurs changements les plus inattendus, à des orientations persistantes qui tendent à durer jusqu’à ce qu’elles aient porté tous leurs fruits. La durée, sous l’épreuve des événements et grâce aux efforts accumulés, est, souvent, la marque décisive de la valeur d’une œuvre et de ses éléments. » Cf. Louis Marin, Regards sur la Lorraine, op. cit., p. 216.
[56] Sur Van Gennep, cf. Daniel xe "Fabre, Daniel" Fabre, « Arnold Van Gennep et le Manuel de folklore français contemporain », in Pierre xe "Nora, Pierre" Nora (sous la direction de), Les Lieux de Mémoire, Paris, Gallimard, 1992 (« Quarto »), iii, pp. 3583-3614.
[57] Pour ce qui touche à sa définition du folklore, cf. l’introduction au Manuel, notamment les pages 41-50. Arnold Van Gennep, « Introduction », in Le Folklore français, t. i : Du berceau à la tombe. Cycles de Carnaval-Carême et de Pâques, Paris, Robert Laffont op. cit., [édition originale : Manuel du folklore français contemporain, op. cit.], pp. 7-105.
[58] Voir la partie consacrée à l’interprétation : Ibid., pp. 92-105.
[59] Lucien Lévy-Bruhl forgea la notion de mentalité pré-logique supposée différencier les primitifs des civilisés.
[60] Rappelons que cette partie du Manuel a été rédigée dans le milieu des années trente, à une époque où xe "Montandon, George" Montandon faisait encore figure de savant reconnu par tous les scientifiques.
[61] Van Gennep, « Introduction », in Le Folklore français, t. i., op. cit. p. 98.
[62] Ibid., p. 96.
[63] Cf. Laure xe "Blévis, Laure" Blévis, « Des “indigènes” en métropole ? Catégories coloniales et catégories métropolitaines », in Laure Blévis, Hélène xe "Lafont-Couturier, Hélène" Lafont-Couturier, Nanette xe "Jacomijn Snoep, Nanette" Jacomijn Snoep et Claire xe "Zalc, Claire" Zalc (dir.), 1931. Les Étrangers au temps de l’Exposition coloniale, Paris, Gallimard/Cité nationale de l’histoire de l’immigration, 2008, pp. 28-35.
 Fil des publications
Fil des publications
 liste des ouvrages
liste des ouvrages





