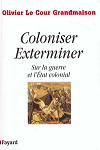Coloniser, exterminer
Sur la guerre et l’Etat colonial
présentation de l'éditeur
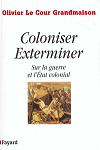 |
Olivier LE COUR GRANDMAISON, Coloniser, exterminer - Sur la guerre et l’Etat colonial . Paris, Fayard, 2005. Paru le : 2005 - Éditeur : Fayard, Paris - Reliure : Broché - Description : 365 pages (220 x 140 cm) - ISBN-10 : 2213623163 - ISBN-13 : 978-2213623160 - Prix : 22 € A lire sur TERRA : le résumé, la table des matières, l’introduction, le chapitre IV en texte intégral |
Mots clefs
| L’auteur : Olivier Le Cour Grandmaison enseigne les sciences politiques et la philosophie politique à l’Université. Il a notamment publié Les Citoyennetés en Révolution (1789-1794) (PUF, 1992), Le 17 octobre 1961 : un crime d’État à Paris (collectif, La Dispute, 2001), et Haine(s). Philosophie et Politique (PUF, 2002). |
 |
.
Télécharger le chapitre IV "L’Etat colonial : un Etat d’exception permanent"
Avec l’aimable autorisation de l’auteur et de l’éditeur , au format PDF (500 Ko )
En dépit de l’évolution du rapport des forces militaires, les défenseurs du "pouvoir du sabre", comme on dit à l’époque, estiment nécessaire de préserver, voire de renforcer, les prérogatives de l’armée et du gouverneur général. Soumettre les "Arabes" à un joug permanent indispensable pour prévenir le surgissement de nouvelles résistances ou, pis encore, celui d’insurrections coûteuses à tous points de vue, tel est encore l’impératif du moment. (...)
.
PRESENTATION :
Quelles furent les spécificités des conflits coloniaux engagés par la France en Afrique du Nord et ailleurs ? Que nous apprennent les méthodes singulières - enfumades, massacres de prisonniers et de civils, razzias, destructions de cultures et de villages - couramment employées par les militaires français sur la nature de la guerre conduite pour pacifier l’ancienne Régence d’Alger ? Pourquoi de nombreuses mesures racistes et discriminatoires ont-elles été élaborées puis appliquées au cours de la conquête et de la colonisation de l’Algérie ? Comment furent-elles codifiées sous la Troisième République puis étendues aux nouveaux territoires de l’empire tels que l’Indochine, la Nouvelle-Calédonie et l’Afrique-Occidentale française ?
Telles sont quelques-unes des questions auxquelles cet ouvrage entend répondre. En effet, la conquête puis la colonisation difficiles et meurtrières de l’Algérie doivent être considérées comme une sorte de vaste laboratoire au sein duquel des concepts - ceux de « races inférieures », de « vie sans valeur » et d’« espace vital », promis à l’avenir et aux usages que l’on sait - furent forgés. De même, on découvre les origines de nouvelles techniques répressives - l’internement administratif et la responsabilité collective notamment - qui, avec le Code de l’indigénat adopté en 1881, firent de l’État colonial un état d’exception permanent. Plus tard, l’internement fut même importé en métropole pour s’appliquer, à la fin des années 1930, aux étrangers d’abord, aux communistes ensuite puis aux Juifs après l’arrivée de Pétain au pouvoir.
S’appuyant sur quantité de documents peu connus voire oubliés, sur la littérature aussi, cette étude originale et dédisciplinarisée éclaire d’un jour nouveau les particularités du dernier conflit qui s’est déroulé entre 1954 et 1962, mais aussi les violences extrêmes et les guerres totales qui ont ravagé le Vieux Continent au cours du XXe siècle.
Pour commander le livre sur Amazon :CLIQUEZ ICI
.
TABLE DES MATIERES :
| INTRODUCTION • L’Algérie : « une question de salut public et d’honneur national » , p 7 • Sur la guerre et l’État colonial, p 17 • Contre l’enfermement chronologique et disciplinaire, p 22 |
CHAPITRE PREMIER. - DES « ARABES »
• Paresse, domination de la nature et sélection des races, p 29
- L’Arabe est toujours semblable à lui-même »
- Piraterie, « hordes arabes » et « belle race berbère »
- Remarque 1 : Engels et Marx : le colonialisme au service de l’« Histoire » universelle
Paresse, agriculture et cheptellisation des hommes
• Sexualité, perversions et hygiène raciale, p 60
- De la dépravation masculine,
- De la débauche féminine et de ses effets,
- « Contagion arabe » et santé publique
• Sauvages et barbares : animalisation et bestialisation, p 81
- Petit portrait du Noir en « animal domestique »,
- Barbares, islam et guerre des civilisations,
- L’« Arabe » : une « bête féroce »
CHAPITRE 2. - GUERRE AUX « ARABES » ET GUERRE DES RACES.
• De la guerre aux « Arabes », p 95
- Tocqueville et la guerre de conquête « On ne peut étudier les peuples barbares que les armes à la main ».
- Pacifier, coloniser et refouler - De la militarisation de la société coloniale. De la dissolution de l’« élément arabe ».
• De la guerre des races, p. 114
- Sur l’anéantissement des « Arabes »
- Faire mourir pour faire vivre : extermination, génocide et espace vital « Des races humaines [...] vouées à la destruction ». « Que l’inférieur soit sacrifié au supérieur ». Le « berceau trop étroit » des peuples européens.
CHAPITRE 3. - DE LA GUERRE COLONIALE
• Massacrer, ruiner, terroriser, p 138
- Sur les enfumades. Des tueries ordonnées et modernes - Une histoire apologétique.
- Razzias et destructions. « J’ai laissé sur mon passage un vaste incendie ».
- Tortures, mutilations, profanations. Supplicier les vivants - Outrager les morts.
- Remarque 2 - Violences et dévastations coloniales : notes sur Au cœur des ténèbres, de J. Conrad.
- Cimetières et « déchets » humains.
• Une guerre totale p. 173
- Guerre conventionnelle et guerre coloniale. Des conflits réglés - « La guerre » d’Algérie « est tout exceptionnelle » .
- Colonisation, dépopulation et « brutalisation ». De la « diminution de nos Arabes » - « L’extermination est le procédé le plus élémentaire de la colonisation ».
CHAPITRE 4. - L’ÉTAT COLONIAL : UN ÉTAT D’EXCEPTION PERMANENT • « Pouvoir du sabre » ou pouvoir civil, p. 201
• Sur le Code de l’indigénat, p. 247
|
CHAPITRE 5. - LA « COLONIALE » CONTRE LA « SOCIALE »
• Des barbares de l’intérieur, p 278
- Du « racisme de classe ».
- L’« émeute » : « ce monstre désorganisateur ».
• L’« Algérie » : « une question de sécurité sociale », p. 292
- Anéantir les « révolutions »
- Déportations et épuration.
- Droit au travail et colonisation
• Juin 1848 : sus aux « Bédouins de la métropole », p 308
- Les « Africains » au secours de l’ordre
- De la guerre coloniale à la guerre civile
CONCLUSION
INDEX DES NOMS DE PERSONNES
INDEX THÉMATIQUE
Introduction
© Editions Fayard, 2005 - Olivier Le Cour Grandmaison, Coloniser. Exterminer - Sur la guerre et l’Etat colonial ; pp. 7 à 28.
- « La conquête de la terre, qui signifie principalement la prendre à des hommes d’une autre couleur que nous, ou dont le nez est un peu plus plat, n’est pas une jolie chose quand on la regarde de près. »
J. Conrad. (1902) Au cœur des ténèbres.
- « Ce contre quoi je réagis est cette rupture qui existe entre l’histoire sociale et l’histoire des idées. Les historiens des sociétés sont censés décrire la manière dont les gens agissent sans penser, et les historiens des idées, la manière dont des gens pensent sans agir. »
M. Foucault. (1988) Dits et écrits.
L’Algérie : « une question de salut public et d’honneur national »
Lundi 24 mai 1847. Assemblée nationale. « La domination paisible et la colonisation rapide de l’Algérie sont assurément les deux plus grands intérêts que la France ait aujourd’hui dans le monde ; ils sont grands en eux-mêmes, et par le rapport direct et nécessaire qu’ils ont avec tous les autres. Notre prépondérance en Europe, l’ordre de nos finances, la vie d’une partie de nos concitoyens, notre honneur national, sont ici engagés de la manière la plus formidable » affirme un député déjà célèbre qui le demeure aujourd’hui. Dés 1828, il s’était prononcé en faveur d’une expédition militaire contre la Régence d’Alger et, quelques années plus tard, pour « la colonisation partielle et la domination totale » de cette dernière. Comment parvenir à ces deux objectifs ? La réponse de ce représentant est claire. Aux quelques philanthropes qui s’émeuvent des méthodes employées par l’armée, il rétorque : « j’ai souvent entendu (…) des hommes que je respecte, mais que je n’approuve pas, trouver mauvais qu’on brûlât les moissons, qu’on vidât les silos et enfin qu’on s’emparât des hommes sans armes, des femmes et des enfants. Ce sont là, suivant moi, des nécessités fâcheuses, mais auxquelles tout peuple qui voudra faire la guerre aux Arabes sera obligé de se soumettre. (…) On ne détruira la puissance d’Abd el-Kader qu’en rendant la position des tribus qui adhèrent à lui tellement insupportable qu’elles l’abandonnent. Ceci est une vérité évidente. Il faut s’y conformer ou abandonner la partie. Pour moi, je pense que tous les moyens de désoler les tribus doivent être employés. Je n’excepte que ceux que l’humanité et le droit des nations réprouvent. » Quels sont donc ces moyens réputés conformes aux sensibilités de saison et au jus belli ? Le premier est « l’interdiction du commerce », le second ; « le ravage du pays. » Et pour conclure, cette personnalité, alors membre de l’Académie des sciences morales et politiques qui deviendra ministre des Affaires étrangères de la Seconde République, ajoute : « je crois de la plus haute importance de ne laisser subsister ou s’élever aucune ville dans les domaines d’Abd el-Kader » et de « détruire tout ce qui ressemble à une agrégation permanente de population. [1] »
Longuement reproduits à dessein pour ne pas laisser croire que nous aurions été abusés par quelques citations trouvées à la hâte dans des textes mineurs, ces passages n’ont pas pour auteur un député extrémiste et marginal s’exprimant dans un journal local et confidentiel. Au contraire, beaucoup de ses contemporains, les nôtres plus encore, tiennent ce parlementaire-écrivain renommé pour un modèle de tempérance qui n’a cessé de plaider, dit-on, en faveur de l’égalité et des libertés politiques, en un mot pour la démocratie. Qui défend donc ces positions ? Alexis de Tocqueville dans un rapport officiel présenté à l’Assemblée nationale en 1847 et dans un opuscule, auquel il accordait la plus grande importance, rédigé dans le silence studieux d’un cabinet quelques mois après son premier voyage en Algérie effectué en mai 1841. Membre de la commission parlementaire chargée d’examiner deux projets de lois portant sur la colonisation de cette contrée, Tocqueville fut désigné rapporteur par ses pairs en raison, notamment, de sa bonne connaissance de la région. Auréolé du prestige consécutif à la publication de La démocratie en Amérique, connu pour ses écrits sur la réforme du système pénitentiaire, tenu enfin pour un spécialiste avisé des affaires étrangères et de la question algérienne, Tocqueville est un homme politique influent. D’autant plus qu’en 1847, il n’intervient pas à titre personnel mais au nom d’une commission ad hoc dont les conclusions ont été entendues par le gouvernement [2]. Au moment où le député de Valognes rédige ces lignes qui disent, de façon exemplaire et insistante, l’importance de l’Algérie pour la métropole, peu conteste encore la nécessité de coloniser ce territoire. En s’exprimant de la sorte, il sait avoir le soutien de la plupart des membres de l’Assemblée nationale, et c’est en porte-parole de cette majorité jugée par lui trop silencieuse qu’il se présente pour mieux défendre les orientations de ses pairs. « De l’avis de tout le monde, pris isolément, un à un, sur ces bancs » il s’agit, comme il le déclarait quelques mois plus tôt, de « la plus grande affaire du pays, qui l’atteint dans son présent, qui le menace dans son avenir, qui, en un mot, est (…) à la tête de tous les intérêts que la France a dans le monde. [3] » Déjà, la question algérienne transcende maints clivages partisans et autorise parfois des accords improbables au regard des confrontations qui divisent habituellement les élus et les responsables de ces temps. Ainsi verra-t-on le maréchal Bugeaud et l’ancien ministre socialiste Louis Blanc, par exemple, farouches adversaires que tout oppose sur le terrain de la politique intérieure, défendre des projets de colonisation voisins en 1848, et le premier approuver le second. Magie des “intérêts supérieurs” du pays.
Les analyses de Tocqueville sont courantes ; de même les propositions concrètes qu’il a faites pour réduire les résistances des populations “indigènes” et anéantir la puissance d’Abd el-Kader, leur chef principal. La lecture des textes et des discours de cette époque révèle, quelle que soit leur nature, une véritable passion collective pour l’ancienne Régence partagée par des élus, des militaires, des écrivains et des réformateurs venus de tous horizons politiques. Ils ne sont pas les seuls ; « l’opinion publique » elle-même, après avoir été « exaltée » par la révolution de 1830, s’est enthousiasmée pour « la conquête d’Alger » soutient Buret. « Coloniste » ardent, lui aussi est convaincu que « l’Afrique » est « une question de salut public et d’honneur national. » Quant à « la guerre » menée outre-Méditerranée, il la conçoit comme une « chasse furieuse » exigeant de recourir à des moyens singuliers comparés à ceux employés à la même époque dans les conflits conventionnels qui se déroulent en Europe. C’est pourquoi il approuve les razzias qui permettent « d’attaquer énergiquement l’ennemi » dans ses intérêts agricoles et de « lui rendre ainsi l’existence (…) malheureuse, jusqu’à ce qu’il reconnaisse notre force et se soumette. » Ce sont là « les conditions du succès dans la guerre d’Afrique [4] » affirme Buret qui salue l’action du général Bugeaud depuis qu’il est devenu gouverneur général de l’Algérie en décembre 1840.
Qu’est-ce qui fonde ces convictions si bien partagées comme le constate Tocqueville qui déplore cependant que le gouvernement n’accorde pas toute l’attention nécessaire à la mise en valeur de l’ancienne Régence ? Pourquoi cette colonie est-elle placée au cœur d’enjeux divers que les contemporains estiment à ce point décisifs qu’il y va du sort même du pays ? Que ce dernier parvienne à ses fins en Afrique, son redressement adviendra, qu’il échoue, laisse entendre Tocqueville et beaucoup d’autres avant et après lui, le pire est à craindre sur le plan international comme sur le front intérieur. Classique rhétorique destinée, par la dramatisation volontaire des questions débattues, à arracher des décisions conformes aux souhaits du rapporteur et de la commission au nom de laquelle il s’exprime ? Sans doute, mais cela ne saurait occulter des réalités plus fondamentales. Multiples, et parfois lointaines, sont les causes de ces analyses que soutiennent, implicitement ici, l’histoire des colonies françaises d’abord, l’actualité de la rivalité avec la Grande-Bretagne ensuite qui, lancée depuis longtemps dans une course victorieuse à l’empire, domine en Inde, au Cap, au Natal et en Australie, et de graves inquiétudes nourries par la situation économique, sociale et politique du pays enfin.
Relativement à la première, c’est le traité de Paris qui est dénoncé. Signé en 1763 pour mettre fin à la guerre de Sept Ans qui avait opposé l’Angleterre et la France, il eut pour conséquence la disparition des territoires les plus importants de l’empire à la suite de la défaite des armées de Louis XV. Du Canada, de la Louisiane, de la côte orientale de l’Inde en passant par le Sénégal, il ne restait rien, ou presque. La victoire de la Grande-Bretagne était complète ; au siècle suivant elle lui assura d’immenses avantages militaires, maritimes et commerciaux qui lui permirent de poursuivre son irrésistible expansion. 1763 ? Date maudite et humiliation nationale réputées avoir ouvert une longue période de décadence – au XIXe le mot est sur de nombreuses lèvres et sous bien des plumes pour dire la situation de la France en Europe et ailleurs - dont les effets se font toujours durement sentir. Cent deux ans plus tard, Prévost-Paradol y voit encore l’origine du déclin français qui a permis à « la race anglo-saxonne » de prendre « possession du globe habitable » alors que la France, consumée par « les guerres civiles » et étrangères, piétinait « dans les boues de la vieille Europe et dans (son) propre sang. [5] » D’un côté, une expansion jamais véritablement contrariée qui a fait de l’Angleterre une puissance à nulle autre pareille. De l’autre, une régression mortifère nourrie des revers essuyés sur la scène internationale, lesquels ont favorisé de violents conflits intérieurs qui ont exténué le pays de la Révolution. La comparaison de ces situations éclaire les destins contrastés de ces deux Etats, et le développement d’un puissant sentiment d’infériorité, qui confine au complexe, chez les Français de cette époque. Vivant dans l’ombre permanente de ce royaume d’outre-Manche, dynamique et conquérant, qui ne cesse de leur renvoyer l’image d’un peuple de colonisateurs obstinés, les premiers se jugent velléitaires, « habitués » qu’ils sont « à laisser tomber le fruit de leur bouche, après y avoir mordu [6] » comme on le lit à l’article « Colonie » du Grand dictionnaire universel du XIXe siècle. Cette critique, qui est aussi une complainte, est courante et elle est répétée dans de nombreux écrits où s’exprime une amertume envieuse pour cette Albion dont les récents succès en Inde ont laissé les contemporains stupéfaits et plus inquiets encore.
C’est à l’aune de ce passé, très présent dans la mémoire des hommes de ces temps, et de l’actualité qu’ils apprécient la seconde question et déplorent les lenteurs, dénoncées comme des atermoiements coupables, de la monarchie de Juillet à coloniser l’Algérie au moment même où la Grande-Bretagne poursuit inlassablement ses conquêtes. L’histoire pluri-séculaire de la rivalité entre les deux nations aide à comprendre l’extrême importance accordée à la prise d’Alger en 1830. Pour beaucoup, elle fut pensée comme le début d’une renaissance depuis longtemps souhaitée, hélas trop souvent différée, qui devait permettre à la France d’atteindre plusieurs objectifs distincts mais liés : poser en Afrique du Nord les fondements nécessaires à la reconstruction d’un empire colonial, recouvrer ainsi une autorité politique et militaire sur le Vieux continent face à une Grande-Bretagne insolente de puissance, et faire de la Méditerranée centrale, cette « mer politique [7] » par excellence où se joue en partie le destin du pays, un « lac français. »
Les contemporains, certains d’entre eux du moins, étaient conscients d’être les témoins, et parfois les acteurs, d’une période caractérisée par le triomphe de la « race européenne » sur « toutes les autres races. » « Il se fait de nos jours quelque chose de plus vaste, de plus extraordinaire que l’établissement de l’empire romain ; c’est l’asservissement des quatre parties du monde par la cinquième. Ne médisons donc pas trop de notre siècle et de nous-mêmes ; les hommes sont petits, mais les événements sont grands [8] » écrit Tocqueville avec une certaine fierté puisque son pays participe à ce mouvement même s’il déplore l’insuffisance de ses efforts. L’histoire, il le sait, est en train de basculer ; pour la première fois l’Europe, emmenée par la Grande-Bretagne, principalement, et par la France, peut envisager de s’imposer sur tous les continents. L’âge des empires mondiaux venait de débuter. Que la position de la France en Europe et dans le monde dépende de ses aptitudes colonisatrices, est un lieu commun ; de même l’analyse que la première demeure en ces matières dangereusement inférieure à l’Angleterre qui est une référence et une rivale constantes que l’on espère concurrencer, à défaut de pouvoir l’égaler.
D’autres enjeux, intérieurs cette fois et tout aussi importants, sont liés au peuplement de l’Algérie par des colons venus de métropole. Si attentif à l’évolution de la situation française, Tocqueville considère qu’il y va des finances du pays et surtout de ses capacités à résoudre partiellement la question sociale qui l’inquiète tant. L’auteur de La démocratie en Amérique ne se laisse pas abuser par « l’apaisement et l’aplatissement universel » engendrés par le régime de Louis-Philippe. Sous ce calme apparent, il « flaire » les affrontements à venir et, dès le mois d’octobre 1847, il affirme qu’ils se concentreront sur les droits de propriété. A ceux qui se rassurent en soulignant que les « classes ouvrières » ne sont plus tourmentées par des « passions politiques », il rétorque que ces dernières « sont devenues sociales » et qu’elles sont plus dangereuses encore car ce n’est pas « telle loi, tel ministère, tel gouvernement » qui sont visés mais les fondements mêmes de la société. La « révolution industrielle » et la centralisation ont fait de Paris la « première ville manufacturière » du pays et le siège de confrontations violentes et d’autant plus inquiétantes - les Trois glorieuses, l’insurrection de juin 1832 et les émeutes d’avril 1834 le prouvent - qu’elles se sont déroulées dans la capitale. C’est sur un véritable « volcan » que « nous nous endormons [9] » conclut Tocqueville dans un discours tenu à la Chambre des députés en janvier 1848. Analyses alarmistes d’un défenseur de l’ordre qui cherche à mobiliser ses pairs pour tenter d’écarter des périls qu’il juge imminents ? Peut-être, mais ces craintes sont depuis longtemps partagées par des réformateurs et des républicains importants.
Quelques années plus tôt, Lamartine s’exclamait à la tribune de l’Assemblée nationale : « Messieurs, voilà la colonisation ! Elle ne crée pas immédiatement les richesses, mais elle crée le mobile du travail ; elle multiplie la vie, le mouvement social ; elle préserve le corps politique, ou de cette langueur qui l’énerve, ou de cette surabondance de forces sans emploi, qui éclate tôt ou tard en révolutions et en catastrophes. On a blâmé l’expédition d’Egypte : ne soyons pas si pressés de répudier la pensée d’un grand homme, attendez encore quelques années pour la juger. » Nul n’ignorait à quoi l’orateur faisait allusion dans ce discours prononcé au lendemain des sanglantes journées d’avril 1834 qui ont vu les artisans et les ouvriers lyonnais d’abord, parisiens ensuite, se soulever pour protester contre la dureté de leur condition de travail et de vie. Le ton exalté et la rhétorique du député-poète disent bien l’urgence « de grandes colonisations » indispensables « à la France » et « nécessaires à nos populations croissantes [10] » dont les pouvoirs publics ne savent que faire. Ces propos ne sont pas le fait d’un homme isolé ; de nombreux auteurs célèbres alors font de l’expansion en Afrique l’une des conditions indispensables au rétablissement de la paix intérieure et au rayonnement de la France en Europe et dans le monde. L’échec des solutions appliquées jusque-là pour soulager la misère des indigents et des prolétaires a nourri des craintes très vives de la « Sociale » ; son spectre hante tous les milieux politiques. La publication, le 15 avril 1834, des sujets mis au concours par l’Académie des sciences morales et politiques en témoigne également puisqu’il est proposé aux candidats d’étudier « la population qui forme une classe dangereuse par ses vices, son ignorance et sa misère », et « d’indiquer les moyens que l’administration, les hommes riches ou aisés, les ouvriers intelligents et laborieux peuvent employer pour améliorer cette classe dépravée et malheureuse. [11] »
Dans ce contexte marqué par les fréquentes émeutes de ceux d’en bas, et par la mobilisation politique et intellectuelle de ceux d’en haut pour tenter d’y mettre un terme, beaucoup estiment que la lutte contre le paupérisme ne doit pas être cantonnée aux frontières de l’hexagone, sauf à demeurer vaine. Pour combattre ce fléau et les violences qu’il n’a cessé d’encourager depuis 1830, l’Algérie doit jouer un rôle majeur. Une fois encore, de nombreux contemporains se tournent vers la Grande-Bretagne perçue comme un modèle. Grâce à son empire et à une politique résolue, elle est parvenue à maîtriser sans heurt significatif une forte croissance démographique et les effets de la révolution industrielle en incitant ses ressortissants les plus démunis à s’expatrier en masse [12]. Quelques années plus tard, la révolution de février 1848 puis la guerre civile de Juin vont être interprétées comme des preuves supplémentaires qui confirment cette vérité : pas de paix sociale sans colonies destinées à accueillir « le trop plein » turbulent et dangereux de la métropole comme on l’écrit à l’époque. Proche et réputée si riche en ressources naturelles mal exploitées par des “indigènes” paresseux et barbares, l’ancienne Régence d’Alger est, pour certains, une « Far-West à découvrir » et « une Californie à exploiter » vers lesquels les pauvres et les aventuriers doivent être dirigés. Là, ils mèneront enfin une vie heureuse et prospère en une contrée qui, pour ces raisons, fut très tôt considérée comme une « nouvelle France [13] » prometteuse et salvatrice. Après 1870, cette dernière a contribué à faire oublier l’humiliante défaite contre la Prusse, l’annexion, plus douloureuse encore, de l’Alsace et de la Lorraine, et la Commune de Paris. Comme leurs prédécesseurs, les défenseurs de la Troisième République, soucieux de trouver à l’extérieur des solutions aux nombreux problèmes intérieurs qu’ils affrontaient, et de renforcer la légitimité encore fragile des institutions, tournèrent leurs regards vers l’empire et l’Algérie. « La colonisation en grand est une nécessité politique tout à fait de premier ordre. Une nation qui ne colonise pas est irrévocablement vouée au socialisme [14] » affirme Renan qui résume bien l’état d’esprit des hommes de son époque. Beaucoup d’entre eux sont convaincus d’être confrontés à cette alternative : ou le colonialisme ou la révolution. On sait le choix qu’ils firent.
Appréhendé sur la longue durée, ce contexte révèle une situation aussi importante pour les contemporains qu’elle est négligée aujourd’hui : l’intrication ancienne, durable et remarquable, bien que peu remarquée, du social et du colonial. Pour être tout à fait précis, il faut y ajouter la question pénale, particulièrement vive dans les années 1830 et suivantes, en raison de la crise du système carcéral métropolitain que l’on espère résoudre par la multiplication des établissements pénitentiaires dans les territoires d’Outre-mer. Soulager la métropole réputée vivre sous la menace constante des faubourgs et d’une criminalité jugée intolérable dont le récidiviste est la figure odieuse parce qu’il dit, par son existence même, la double impuissance de la prison à punir et à réformer efficacement les condamnés, tels sont les objectifs de nombreux libéraux, républicains et socialistes. S’ils divergent, parfois, sur les moyens nécessaires pour peupler massivement l’Algérie d’Européens, ils ne doutent pas que cette dernière réalisera toutes leurs « espérances [15] » et qu’ils pourront maîtriser ainsi un présent difficile et un avenir incertain. Pour beaucoup, la colonie est une terre promise destinée au “bas peuple” sans terre ni emploi qui doit y trouver ce que la mère-patrie ne peut lui offrir en raison de l’exiguïté de son territoire et de son incapacité à lui fournir le travail dont il a besoin.
Le rattachement rapide de l’ancienne Régence au territoire national sanctionne l’importance que les hommes de la première moitié du XIXe siècle accordaient à cette région ; il fut solennellement consacré par les constituants de 1848 désireux et fiers d’inscrire dans la Loi fondamentale [16] cette formule qui fera florès : « l’Algérie, c’est la France. » Les noces sanglantes de la République et du colonialisme venaient d’être conclues ; une longue histoire débutait et ses effets ont durablement marqué les générations de dirigeants qui se sont succédées à la tête du pays. Le souvenir des combats et des morts, le rappel des sacrifices et des efforts consentis pour “civiliser” cette contrée, comme on disait alors, puis la présence de métropolitains venus s’y installer en nombre ont pesé d’un poids considérable sur la conscience des vivants ; ces héritiers pourvus d’un vaste empire conquis avec difficulté qui se sont fait un devoir de le sauvegarder, quoi qu’il en coûte. L’acharnement de l’écrasante majorité des responsables politiques de tout bord à défendre, de 1945 à la fin des années cinquante, l’Algérie française et l’issue particulièrement meurtrière de la guerre longtemps sans nom qui s’y déroula, doivent beaucoup à ce passé réputé héroïque. A ceux qui, pour des raisons économiques et militaires, souhaitaient le retrait de la France, Lamartine scandalisé répondait déjà par une formule définitive que les dirigeants de la Quatrième République n’auraient pas désapprouvée : « nous n’abandonnerons jamais Alger », et le premier stigmatisait cette proposition, « antinationale, antisociale et antihumaine [17] », considérée comme une trahison.
A partir de 1830, les débats sur la politique à mener en Algérie sont aussi importants que nombreux. Poursuivis sous tous les régimes, ils ont traversé le siècle et mobilisé des personnes venues de disciplines, d’horizons politiques et professionnels extrêmement divers. L’ampleur et la permanence de ce phénomène ont surpris les contemporains conscients d’être confrontés à une situation inhabituelle qui a vu des hommes, et quelques femmes, s’engager avec fougue dans les discussions publiques de leur temps. « Il n’y a pas de problème, qui ait autant préoccupé les esprits que celui de la colonisation de l’Algérie. Les écrits auxquels il a donné naissance sont presque innombrables [18] » constatait Tocqueville en 1847 ; pour les raisons que l’on sait, cette passion collective a longtemps perduré. En effet, dans des ouvrages qui traitent de sujets a priori sans rapport avec la colonie, certains de ceux consacrés au paupérisme, aux enfants abandonnés ou à la réforme du système pénitentiaire par exemple, on découvre que leurs auteurs intègrent fréquemment l’ancienne Régence à leurs réflexions et à leurs projets. De même, les livres d’histoire, les essais ou les études démographiques consacrés à la région nous ramènent souvent, par des voies inattendues quelquefois, sur le terrain social, pénal ou sur celui de la politique intérieure alors que rien ne laissait présager qu’il en serait ainsi. Engendrés par l’actualité française et algérienne, se répondant les uns les autres, rédigés à Paris, en province ou dans la capitale de la colonie par des personnalités renommées ou par des obscurs désireux de faire entendre leur voix, et peut-être de se faire connaître, ces écrits nous introduisent au cœur de débats d’une diversité et d’une richesse extraordinaires. Tous éclairent à la fois les ressorts de cet engouement pour l’Algérie qui a saisi les acteurs, le public, de nombreux peintres et écrivains partis « chercher des inspirations de l’autre côté de la Méditerranée [19] », et les difficultés politiques, juridiques et pratiques auxquels les premiers ont été confrontés lors de la conquête et de la colonisation de ce territoire.
Sur la guerre et l’Etat colonial
Alger prise, de nombreuses interrogations demeuraient en suspens ou surgissaient en raison de l’ampleur des problèmes liés à l’évolution de la conjoncture militaire notamment. Que faire de l’ancienne Régence vaincue, certes, mais toujours insoumise ? Jusqu’où pousser la conquête ? Quels moyens employer pour y établir une sécurité durable indispensable à l’arrivée de nombreux colons ? Comment combattre les “indigènes” qui s’organisent contre un pouvoir doublement illégitime à leurs yeux parce que ses détenteurs sont à la fois étrangers et chrétiens ? A ces questions qui ont suscité de longues controverses sur les méthodes nécessaires pour l’emporter dans la colonie, les contemporains ont apporté des réponses variées ; leurs écrits et leurs propositions en témoignent. On y découvre des conceptions particulières de l’ennemi “Arabe”, de la guerre qu’il faut mener contre lui et, in fine, des pratiques systématiques de violences extrêmes comparées à celles qui sont employées en Europe à la même époque. La guerre coloniale donc, ses méthodes, sa nature et ses conséquences dévastatrices pour le pays et les populations concernées ; ce sont là nos objets.
Tocqueville prétendait défendre une voie moyenne destinée, selon lui, à éviter les écueils d’un conflit péchant par défaut de rigueur ou par excès. D’autres, plus radicaux, ont élaboré des projets qui peuvent paraître extravagants aujourd’hui ; c’est méconnaître le fait qu’ils furent conçus par des notables respectables puis discutés en leur temps par des hommes forts connus qui en ont débattus sérieusement. Pour venir à bout des “indigènes” dont les résistances armées compromettaient les projets de colonisation, des auteurs proposèrent de bouleverser la carte raciale de l’Algérie, de refouler les “Arabes” jugés dangereux et inaptes aux exigences du travail modernes, et de les remplacer par des Chinois et des Noirs qui seraient importés en masse. Considérés comme des auxiliaires fiables sur lesquels les Européens pourraient compter, ces “indigènes” dociles seraient employés pour cultiver les terres acquises par la force et pour conquérir les oasis lointaines du sud.
Certains proposèrent même d’exterminer tout ou partie des “Arabes” au motif qu’appartenant à une race inférieure et rétive à la civilisation, ils devaient être anéantis ; le sort réservé aux Indiens d’Amériques ou aux Aborigènes d’Australie étant deux précédents abondamment sollicités pour soutenir cette perspective. Défendu en 1846 par un célèbre médecin républicain qui résidait en Algérie – le docteur Eugène Bodichon –, ce projet fut exposé dans le Courrier Africain, un journal important de l’ancienne Régence pourtant soumise à la stricte censure des autorités militaires. Informés de ces propositions, des membres de l’Assemblée nationale sont intervenus pour les condamner et mettre en garde le gouvernement contre leur diffusion. Quelques années plus tard, l’auteur a persévéré dans cette voie en rédigeant plusieurs volumes [20] destinés à poser les fondements théoriques et historiques de la guerre des races réputée opposée les Européens aux “indigènes” des autres continents voués à une destruction qu’il juge nécessaire et positive. Le terme d’extermination utilisé ici, et dans le titre de notre ouvrage, appelle une précision indispensable pour empêcher de faux débats et de graves mésinterprétations. Nul désir de provocation ou de polémique n’est à l’origine de son usage ; la chose serait aussi dérisoire qu’irresponsable. Si nous nous sommes résolus à employer ce vocable, c’est parce que les nombreux auteurs sollicités y ont couramment recours pour désigner ce qui est perpétré dans les terres conquises par les habitants du Vieux continent. Qu’ils approuvent ou qu’ils réprouvent l’anéantissement physique des “indigènes”, les contemporains savaient que la colonisation allait souvent de pair avec l’extermination des tribus ou des peuplades vaincues et ils ne le cachaient pas ; pas plus qu’ils ne cherchaient à euphémiser les réalités dont ils prenaient connaissance [21]. Ajoutons, c’est essentiel, qu’au XIXe le mot demeure, comme au siècle précédent, polysémique puisqu’il sert à nommer des actes jugés aujourd’hui fort éloignés les uns des autres. Ainsi, la mort d’un individu suivie de la ruine de son corps par le feu ou le démembrement, des exécutions sommaires et des massacres de masse sont-ils tous désignés par ce terme unique [22]. Faut-il le rappeler, les mots et les concepts ont également une histoire, et pour comprendre de façon adéquate l’extermination et ce qu’elle signifie alors, il est impératif de s’affranchir de son acception récente forgée après Auschwitz notamment.
Ces différents projets seront étudiés, de même les opérations et les techniques de l’armée d’Afrique conçues au début des années 1840, lorsque la guerre change de nature en devenant totale puisqu’elle débouche sur la militarisation complète des populations algériennes et de leurs territoires. Les premières sont désormais tenues pour des ennemis non conventionnels qui peuvent, et qui doivent être anéantis en certaines circonstances. Quant aux seconds, ils sont désormais considérés comme des objectifs militaires ce qui entraîne la disparition de tout sanctuaire susceptible d’échapper aux violences des batailles ; cette évolution a pour conséquence la destruction massive des villes, des villages et des cultures. La « brutalisation [23] » du conflit mené dans l’ancienne Régence est aussi rapide que spectaculaire ; elle se produit au moment même où les affrontements armés qui opposent les Etats du Vieux continent se civilisent au contraire. Le développement de ces deux phénomènes est cependant plus complexe que le suggère l’opposition entre un “ailleurs” colonial, voué aux massacres des civils et des prisonniers, à la mutilation systématique des cadavres et au ravage méthodique du territoire, et un “ici” européen où triompheraient des règles plus respectueuses des personnes et des biens.
En juin 1848, certaines des techniques employées dans la colonie furent en effet importées à Paris par des officiers supérieurs – Cavaignac, Lamoricière et Changarnier notamment - qui avaient longtemps servi en Algérie. L’expérience acquise là-bas a ainsi inspiré la conduite de la guerre civile dont les violences extrêmes demeurent peu intelligibles lorsqu’on fait abstraction de ce passé-présent au moment où l’armée et la garde nationale, commandée par de nombreux « Africains », partent à l’assaut de la capitale et des « bédouins de la métropole » comme on disait alors. Contre ces barbares de l’intérieur, d’autant plus haïs qu’ils furent davantage craints, des « moyens algériens [24] » ont donc été mobilisés pour reconquérir les quartiers qu’ils contrôlaient. Un homme incarne, il n’est pas le seul tant s’en faut, ce mouvement qui n’a pas échappé aux contemporains : il s’agit de Bugeaud. Après avoir été l’artisan de la pacification meurtrière de l’ancienne Régence, il devient, au lendemain des journées de Juin, le théoricien de la lutte contre-révolutionnaire en rédigeant un ouvrage intitulé De la guerre des rues et des maisons. Au cours du dernier conflit, en 1954, des pratiques, couramment employées lors de la conquête, furent de nouveau mises en œuvre et perfectionnées dans un contexte où les “nécessités” du combat contre les “terroristes” justifiaient le recours à des moyens non conventionnels tels que la torture de masse, les représailles collectives contre les civils, les exécutions sommaires, l’anéantissement de villages et le regroupement forcé des populations algériennes dans des camps érigés par l’armée. Remarquable permanence de la guerre totale.
La défaite et la reddition d’Abd el-Kader en 1847 ouvrent une ère nouvelle mais les débats ne cessent pas pour autant ; ils changent seulement d’objets et se concentrent désormais sur la question de savoir comment diriger l’Algérie après que les résistances les plus importantes avaient été vaincues. De quelle façon gouverner les “Arabes”, majoritaires, et les Européens, qui constituent alors une faible minorité, pour assurer aux seconds une prééminence jugée fondamentale à la stabilité de l’ordre colonial imposé par la France ? Quel type d’institutions établir dans l’ancienne Régence maintenant pacifiée ? Un « régime du sabre », dénoncé comme une dictature par ses adversaires qui y voient aussi un obstacle au peuplement de la colonie par des familles du Vieux continent, ou un gouvernement civil plus respectueux des droits et libertés dont les colons doivent être les seuls bénéficiaires ? Considérées comme vitales pour l’avenir de l’Algérie française, ces interrogations et les diverses réponses apportées par les contemporains ont suscité de nombreuses et vives polémiques ; la nature de l’Etat colonial s’y révèle. Nous suivrons donc la genèse et le développement de ce dernier conçu comme un état d’exception permanent dominé par un gouverneur général disposant de pouvoirs exorbitants qui l’autorisent à exercer des fonctions exécutives, législatives et judiciaires. Gustave de Beaumont, ami fidèle de Tocqueville et député modéré, qualifiait ce régime singulier de « tyrannie militaire. [25] » Destiné à organiser et à pérenniser le « joug » imposé par la « race victorieuse » - les Européens - sur la « race vaincue [26] » - les “indigènes” –, cet Etat s’est érigé sur ces critères raciaux qui ont donné naissance à deux ordres politiques et juridiques distincts. L’un est opposable aux colons qui jouissent des droits fondamentaux reconnus par la Déclaration. L’autre s’impose aux “Arabes” soumis à une législation extraordinaire et discriminatoire sanctionnant leur statut d’assujettis perpétuels constamment exposés au pouvoir souverain détenu par le gouverneur qui peut les interner sans jugement pour une durée indéterminée, les soumettre à des amendes collectives et séquestrer leurs biens immobiliers.
Par la suite, certaines de ces dispositions ont été étendues aux autres possessions françaises avant d’être importées parfois dans l’hexagone où elles furent appliquées à des étrangers puis à des nationaux. L’internement administratif est exemplaire de ce processus qui a vu une mesure d’exception, employée contre les “indigènes”, devenir la règle dans l’empire et se banaliser ainsi avant d’être intégrée à la législation opposable aux Français résidant en métropole. C’était à la veille de la Seconde Guerre mondiale puis le sous le régime de Vichy ; les réfugiés républicains espagnols, les communistes français, puis, après l’adoption de la loi du 3 septembre 1940, les « traîtres à la patrie », et les Juifs étrangers en vertu d’une législation adoptée le 4 octobre de la même année, furent victimes de ces mesures. On sait que des dispositions majeures de la France de Pétain ont des origines républicaines [27] ; moins connu est le fait que certaines d’entre elles furent inspirées par une législation coloniale riche et abondante. Le Code de l’indigénat – ce monument du racisme d’Etat adopté sous la Troisième République en 1881 pour le territoire algérien et pour les seuls “Arabes” – a, quant à lui, servi de modèle à de nombreux autres Codes du même type forgés peu après pour l’Indochine, l’Afrique de l’Ouest et la Nouvelle-Calédonie ; ils furent appliqués jusqu’à la Libération.
Contre l’enfermement chronologique et disciplinaire
A l’opposé d’approches qui postulent des discontinuités radicales et pratiquent des coupes sauvages dans la trame de l’histoire pour la faire entrer dans les limites de la période contemporaine et dans celles, plus étroites, “du temps présent”, - c’est Clio forcée de s’allonger dans le lit de Procuste - nous entendons renouer les fils épars de ce passé fragmenté. Il ne s’agit pas d’affirmer que de 1830 à 1962, le “même” fut toujours à l’œuvre mais d’atteindre, au-delà de la singularité des événements, des représentations, des logiques, et des pratiques qui permettent de comprendre l’importance et la réitération des massacres perpétrés en cette colonie, et les particularités des conflits qui s’y sont déroulés. La même démarche est employée pour analyser la permanence et/ou l’adoption de mesures exorbitantes au regard du droit commun et de nombreux principes fondamentaux en vigueur dans la métropole. La conquête et la colonisation de l’Algérie furent en effet d’exceptionnels champs d’expériences [28]. Tel que nous l’entendons ici, le concept de champ d’expériences désigne des “lieux” et des époques où des notions et des techniques, parfois inédites, furent conçues et appliquées. Des savoirs et des savoir-faire, militaires, politiques et juridiques en l’occurrence, se sont ainsi constitués au cours d’une phase que l’on peut dire expérimentale. Aux vues de leurs résultats, de leur plus ou moins grande adéquation aux fins changeantes poursuivies par les individus, et compte tenu de l’évolution de la situation, ils ont été par la suite abandonnés ou fixés au contraire dans des instructions, des dispositions et des institutions dont l’une des fonctions était de les pérenniser pour les communiquer à d’autres hommes [29]. Une seconde phase a débuté alors, celle de la transmission laquelle n’est nullement exclusive d’adaptations, de perfectionnements ou d’inventions nouvelles soumises à leur tour au processus général décrit puisqu’il ne connaît pas de terme. Ainsi compris, le concept de champ d’expériences permet de penser en même temps la permanence et le changement, des phénomènes de continuité et de rupture sans céder ni à l’illusion conservatrice de la constante réitération, ni à celle, souvent tout aussi trompeuse, de l’absolue nouveauté. La première tend à interdire de concevoir et d’observer l’avènement de l’inédit ; les faits étant toujours rabattus sur des précédents supposés les contenir tout entier et dont ils paraissent mécaniquement découler. La seconde néglige les éléments proches ou lointains qui ont contribué au surgissement des événements en ne retenant de ces derniers que leur éclat magnifique ou terrible sans voir ce qui les a lentement préparés et brusquement précipités.
Les razzias modernes, organisées avec méthodes par l’armée d’Afrique et plus tard employées en Nouvelle-Calédonie et en Afrique de l’Ouest notamment, l’usage courant de la torture, les amendes et la responsabilité collectives, le séquestre ou l’internement administratif témoignent de ce processus qui se nourrit d’emprunts et d’innovations. De même, l’internement déjà mentionné illustre de façon remarquable la continuité de certaines techniques et la discontinuité, parfois radicale, de leurs usages dans le temps et par des régimes politiques fort divers. S’il s’agit donc d’établir des filiations, de relever de possibles influences et de mettre au jour des phénomènes que seule la longue durée révèle ; l’objectif est de repérer aussi des transformations voire des ruptures provoquées par une conjoncture nouvelle et des desseins inédits.
Pour suivre ces nombreux mouvements d’importations d’Algérie vers la métropole, ou vers d’autres colonies, d’exportations aussi dans le cas du livret ouvrier qui, aboli en France en 1890, fut introduit sept ans plus tard outre-Méditerranée pour assujettir plus étroitement les “indigènes”, il est indispensable de s’affranchir des frontières chronologiques – elles tendent à devenir des prisons - académiquement consacrées à l’intérieur desquelles des spécialistes s’activent en régnant sur « un canton du savoir » qu’ils prennent « pour une patrie. [30] » En effet, ignorer ces années décisives au cours desquelles cette colonie fut fondée, ses liens avec la métropole fixés dans les termes que l’on sait et sanctifiés, selon la formule consacrée, par le sang et les souffrances des soldats de l’armée d’Afrique, ou tenir les premières pour secondaires au motif qu’elles appartiennent à un passé trop ancien, nuit gravement à la compréhension de la période contemporaine que l’on ampute de ses origines. De là d’importantes erreurs ; la torture, la justice singulière appliquée aux « Français musulmans d’Algérie » et les méthodes de guerre employées lors du dernier conflit, par exemple, étant souvent interprétées comme de graves “embardées” principalement liées au contexte particulier de ces années. C’est oublier que ces pratiques furent auparavant les règles en cette contrée pendant longtemps soumise à un état d’exception rétabli par la Quatrième République, et prolongé par la Cinquième jusqu’en 1962.
Les acteurs le savaient et certains d’entre eux ont revendiqué, en des termes qui ne laissent aucun doute sur les connaissances qu’ils avaient de ce passé, cette continuité et cet héritage jugés glorieux dans lesquels ils ont puisé des enseignements précieux pour résoudre les problèmes qu’ils affrontaient. Favorable aux exécutions sommaires, aux sanctions collectives, et aux déplacements forcés des populations civiles, le rédacteur anonyme d’une note rédigée en 1956 écrit ainsi : « Bugeaud, le grand vainqueur de l’Algérie, l’a dit avant nous : “ le seul moyen pour faire céder (les rebelles) est de s’attaquer à leurs intérêts : leurs femmes au premier plan.” [31] » De façon explicite, ce militaire s’inscrit dans cette tradition ; elle le guide, l’aide à déterminer ce qu’il convient de faire sur le terrain, comme on dit, et légitime enfin ses propres agissements qui ont de nombreux précédents.
A l’inverse, se concentrer sur le XIXe siècle et sur l’Algérie seule, en négligeant l’histoire des colonies conquises par la suite et le devenir de certaines pratiques guerrières et juridiques expérimentées dans les années 1840, interdit de comprendre leur extension et leurs usages ultérieurs dans des contextes voisins ou différents. Là encore, le risque est grand de considérer que ces pratiques sont exceptionnelles et conjoncturelles alors que leur devenir respectif prouve souvent le contraire. Pour dépasser l’étroitesse de ces études qui, en s’ignorant, brisent « la solidarité des âges » et tranchent leurs « liens d’intelligibilités [32] », une autre démarche s’imposait. Sur le plan chronologique, c’est elle qui justifie les nombreux aller-retour effectués entre la période de la conquête et l’époque contemporaine que la première éclaire de façon précieuse, et réciproquement. Sur le plan géographique et politique, c’est elle qui nous a conduit, pour connaître la diffusion de techniques répressives et de méthodes de guerre particulièrement importantes, à étendre les recherches à d’autres colonies voire, dans certains cas, à quelques Etats européens où elles furent massivement employées.
Enfin, les particularités des objets étudiés conjointes à celles de notre approche obligent à nous engager dans une voie dédisciplinarisée pour user d’un terme forgé par Foucault qui désignait par là une démarche et une exigence rebelles à l’ordre des savoirs récemment institués. A quelle discipline appartient le présent travail ? Aux relations internationales ? Aux affaires coloniales ? Aux affaires intérieures ? A l’histoire des idées dont la vocation est d’étudier les textes de nature diverse grâce auxquels partisans et adversaires de la colonisation de l’Algérie se sont affrontés ? Vaines interrogations que structurent d’inadéquates taxinomies ; toutes trahissent la position d’observateurs qui, victimes d’illusions rétrospectives, abordent le passé en étant prisonniers de représentations contemporaines. Loin de contribuer à une meilleure intelligence des réalités qui nous intéressent, ces taxinomies les obscurcissent au contraire en faisant disparaître les relations multiples et complexes qui les unissent. Ce que l’on croit gagner en précision se paie d’une partiellité qui nuit gravement à la compréhension de l’ensemble. Ainsi, des pans entiers de cette histoire sont trop souvent oubliés ou relégués dans les marges au motif qu’ils excèdent les champs disciplinaires aujourd’hui établis. En se soumettant, de façon implicite ou explicite, à ces classements d’autant moins maîtrisés qu’ils sont plus spontanés, et plus encouragés par la structuration présente des sciences humaines et des nombreuses spécialités qui prospèrent en leur sein, de telles approches oblitèrent les liens pourtant étroits qui unissent ces domaines distincts, certes, mais contigus. La dissociation radicale des questions coloniales, sociales et pénales, par exemple, en témoigne remarquablement. Contre l’enfermement dans une discipline quelle qu’elle soit – discipline qui semble parfois défendue moins pour cultiver l’esprit que pour le contraindre – et dans des chronologies resserrées et partielles, d’autres voies s’imposaient.
De là une conséquence, les textes étudiés sont d’origine et de statut divers. Ils sont en effet empruntés à l’histoire, à la politique, à la sociologie, au droit, à la littérature et à la philosophie bien que la plupart d’entre eux ne se laissent pas emprisonner de la sorte car ils furent élaborés en des temps où ces domaines n’étaient pas sanctuarisés et gardés jalousement par des spécialistes qui considèrent que l’une de leurs missions principales est de veiller au strict respect des frontières de leur discipline. Certains de ces textes se présentent comme de copieuses et rigoureuses études dont le caractère scientifique, revendiqué par les auteurs, n’était pas à l’époque mis en doute. D’autres sont écrits dans l’urgence d’une conjoncture qui les motive aussi et sur laquelle leurs rédacteurs entendaient peser en prenant partie dans les controverses de leur temps. Des témoignages d’acteurs ayant exercé des responsabilités majeures, des manuels destinés à l’enseignement primaire et supérieur, et des dictionnaires prestigieux ont également été utilisés pour suivre le jeu complexe des représentations et des pratiques appréhendées à différents niveaux de la société.
Quelques mots enfin sur le vocabulaire employé et la forme de cet ouvrage qui comporte d’assez nombreuses notes de bas de pages. En dépit de leur évidente connotation raciste et méprisante que nous n’ignorons pas, les termes “indigène”, “Arabe”, “Kabyle” ou “nègre”, qu’ils soient au singulier ou au pluriel, ont été conservés. Pour éviter des répétitions fastidieuses d’abord, et pour mieux rendre compte surtout des représentations des auteurs sollicités qui usent d’une terminologie spécifique. De même qu’il existe, nous l’étudierons, un riche bestiaire colonial qui est indissociable d’une économie particulière de la violence qu’il légitime, un langage et des métaphores ont été forgés pour dire la place que les Français assignent aux hommes qu’ils asservissent, expulsent et/ou massacrent. Ces vocables condensent et expriment en même temps des conceptions particulières des autres ainsi nommés, et mal nommés en fait puisqu’ils ne sont jamais identifiés comme des semblables mais comme les membres interchangeables de la race à laquelle ils sont supposés appartenir et sur laquelle ils sont constamment rabattus. Aussi ces termes sont-ils toujours assortis de guillemets car on ne saurait impunément user de la langue des colonisateurs. Au XIXe siècle, « L’Afrique » désigne à la fois le continent dans son ensemble et l’Algérie en particulier ; seul le contexte permet de trancher entre ces deux acceptions. L’expression « l’armée d’Afrique » renvoie aux troupes et aux corps spéciaux – les tirailleurs et les spahis - mobilisés en nombre dans l’ancienne Régence pour la conquérir et la pacifier. « Africains » enfin fait partie du vocabulaire couramment employé pour nommer les militaires qui, après avoir servi dans la colonie, venaient souvent chercher en métropole des responsabilités nouvelles jugées plus conformes à leurs ambitions.
Relativement aux notes de bas de page, il nous a semblé qu’en cette matière aussi la médiété était nécessaire. Nous avons donc décidé de cheminer à égale distance de ceux qui jugent qu’il y en a toujours trop, et de ceux qui estiment au contraire qu’elles sont toujours insuffisantes [33]. Ces notes ont pour fonction de certifier que les écrits, ceux que le lecteur découvre par les seules citations qui en sont faites, furent rédigés par des hommes et des femmes dont il est possible de restituer la carrière et les responsabilités. Sauf exception liée à l’absence de données fiables sur les auteurs, des informations précises sont fournies. Elles permettent de savoir qui ils étaient, à quel titre ils s’exprimaient, comment leurs ouvrages ont été accueillis et quelle fut la postérité de ces derniers qui devinrent parfois des classiques aussi célèbres hier qu’ils sont aujourd’hui ignorés. Qu’ils soient écrivains, professeurs, juristes, parlementaires ou auteurs d’études particulières consacrées à l’Algérie ou aux questions sociales et pénales par exemple, la plupart furent, dans leur domaine respectif, connus en leur temps ; certains le sont encore de nos jours même si leurs écrits “algériens” ou coloniaux retiennent peu l’attention alors qu’eux-mêmes leur accordaient souvent une grande importance. Quant aux militaires ou aux officiers de haut rang dont les textes et la correspondance ont été abondamment sollicités, ils sont à l’époque nombreux à occuper aussi des fonctions politiques de premier plan en Algérie ou en France dans un contexte où la colonie est un tremplin précieux emprunté par tous ceux qui entendent faire carrière ; les grades, les distinctions et les renommées s’y obtiennent en effet plus facilement que dans la métropole où les prétendants sont nombreux et les exploits plus difficiles à réaliser. Beaucoup « d’épées » célèbres en raison de leur participation à la conquête de l’ancienne Régence furent ainsi députés et les plus illustres – Cavaignac et Lamoricière en juin 1848, Saint-Arnaud lors du coup d’Etat de Louis-Napoléon Bonaparte - ont exercé des responsabilités gouvernementales majeures lors de ces événements.
Parfois, des citations voisines sont faites dans le corps du texte ou dans les notes. Nul désir d’exhibition érudite ne les motive, il s’agit de montrer que d’autres auteurs et/ou acteurs pensaient de même et que nous ne sommes pas en présence d’un cas exceptionnel, peut-être intéressant en soi mais marginal dès lors qu’il s’agit de tenter de saisir le climat politique, social et intellectuel d’une époque. D’une façon générale, comme l’écrivait Foucault en réaction aux nombreux « faiseurs d’histoire » qui sévissaient déjà à son époque et, ajouterons-nous, aux faiseurs de livres - ce sont parfois les mêmes - qui prolifèrent aujourd’hui, « un travail doit dire et montrer comment il est fait. C’est à cette condition qu’il peut non seulement ne pas être trompeur, mais être positivement utile. [34] » Précieuse règle à laquelle nous avons tenté d’être fidèle.
NOTES
[1] . A. de Tocqueville. La première citation est extraite du « Rapport sur le projet de loi relatif aux crédits extraordinaires demandés pour l’Algérie. », Œuvres, Paris, Gallimard, La Pléiade, 1991, p. 848. Les secondes proviennent de son « Travail sur l’Algérie » rédigé en 1841, idem, p. 705-706.
[2] . « Huit jours après la lecture » du second rapport, consacré au développement de camps agricoles souhaité par Bugeaud et soutenu par Guizot, le gouvernement retirait en effet « le projet de loi » qui venait d’être critiqué par Tocqueville. Fr. Guizot. Mémoires pour servir à l’histoire de mon temps, Paris, M. Lévy Frères, 1865, t. VII, p. 234.
[3] . A. de Tocqueville. Le Moniteur universel, Assemblée nationale, 10 juin 1846, p. 1723.
[4] . E. Buret. ( 1810-1842 ) Question d’Afrique. De la double conquête de l’Algérie par la guerre et la colonisation, Paris, 1842, p. 5, 2 et 31. Economiste et sociologue, dirait-on aujourd’hui, il s’est rendu célèbre par son ouvrage De la misère des classes laborieuses en Angleterre et en France publié en 1840 et couronné par l’Académie des sciences morales et politiques.
[5] . A. Prévost-Paradol. « Carte future du monde. Empire colonial anglo-saxon » (10 décembre 1865), La France nouvelle suivie de Pages choisies, Paris, Editions Garnier, 1981, p. 128. « L’abandon » de l’Algérie par la France « serait aux yeux du monde l’annonce certaine de sa décadence » écrit Tocqueville. « Travail sur l’Algérie », Œuvres, op. cit., p. 691. En 1880, P. Gaffarel soutient encore que la « décadence » de la métropole « tient pour beaucoup à la ruine de notre empire colonial. » Les colonies françaises, Paris, Baillière & Cie, 1880, p. 5. Professeur d’histoire à la Faculté des Lettres de Dijon et membre actif de la Société de Géographie de Paris, Gaffarel a publié plusieurs ouvrages de référence sur les colonies. Lors d’un débat sur la colonisation, J. Ferry déclare à l’Assemblée : « La politique de recueillement ou d’abstention, c’est simplement le chemin de la décadence. » (28 juillet 1885). Cité par J-M. Mayeur. Les débuts de la IIIe République 1871-1898, Paris, Seuil, 2004, p. 132.
[6] . Article « Colonie », Grand dictionnaire universel du XIXe siècle, P. Larousse, Paris, 1866, t. IV, p. 652. « De toutes les races actuelles, la plus propre à la colonisation, c’est la race anglo-saxonne. On dirait que les trois quarts du globe lui ont été légués par testament divin » lit-on aussi. De son côté, G. Flaubert note avec ironie : « Colonies (nos) – S’attrister quand on en parle. » Dictionnaire des idées reçues, (1847), Paris, Mille et une nuits, 1995, p. 23.
[7] . A. de Tocqueville. « Travail sur l’Algérie », Œuvres, op. cit. , p. 692.
[8] . A. de Tocqueville. « Lettre à Henry Reeve. » 12 avril 1840, Œuvres complètes. Correspondance anglaise, Paris, Gallimard, 1954, t. VI, 1, p. 58.
[9] . A. de Tocqueville. Souvenirs, Paris, Gallimard, 1999, p. 23 et 24.
[10] . A. de Lamartine. « Sur Alger », 2 mai 1834, Œuvres oratoires et écrits politiques, Paris, Librairie internationale, 1864, t. 1, p. 64. De son côté, G. de Beaumont soutient que « l’abaissement » de la France raviverait « des partis violents, habiles à s’emparer du sentiment national » ce qui pourrait conduire le pays « à la guerre par l’anarchie. » De la politique extérieure de la France, Paris, Ch. Gosselin, 1840, p. 38.
[11] . Texte cité par J-P. Bois. Bugeaud, Paris, Fayard, 1997, p. 206.
[12] . « Plus de douze millions de sujets britanniques quittèrent l’île pour conquérir et peupler de nouveaux mondes » entre 1815 et 1890. H. Wesseling. Le partage de l’Afrique, Paris, Gallimard folio/histoire, 2002, p. 68.
[13] . P. Gaffarel. Les colonies françaises, op. cit. , p. 563. « Ma pensée, c’est qu’Alger doit être un appendice du territoire français » déclarait déjà Lamartine en 1836. « Sur la colonisation d’Alger », 11 juin 1836, Œuvres oratoires et écrits politiques, op. cit. , t. 1, p. 279.
[14] . E. Renan. « La réforme intellectuelle et morale de la France », (1871), Œuvres complètes, Paris, Calmann-Lévy, 1947, t. 1, p. 390. (Souligné par nous)
[15] . E. Buret. Question d’Afrique, op. cit. , p. 9. Sur l’ensemble de ces questions, cf. chapitre V de cet ouvrage : La « Coloniale » contre la « Sociale », pp.
[16] . L’article 109 de la Constitution de la Seconde République est ainsi rédigé : « Le territoire de l’Algérie et des colonies est déclaré territoire français. »
[17] . A. de Lamartine. « Sur Alger », 2 mai 1834, Œuvres oratoires et écrits politiques, op. cit. , t. 1, p. 66 et 67.
[18] . A. de Tocqueville. « Sur un crédit pour les camps agricoles », 2 juin 1847, Œuvres, op. cit. , p. 900.
[19] . Th. Gautier. « Salon de 1849 » (7 août 1849), in Voyage en Algérie, Paris, La Boîte à Documents, 1997, p. 176. L’écrivain rapporte que le « tout Paris » a visité, aux Tuileries, la tente dans laquelle le général Bugeaud reçut, après la célèbre bataille d’Isly, les trophées de sa victoire. Idem, p. 172. Après avoir exposé la Smala en 1845, Horace Vernet, le peintre quasi officiel de la conquête de l’Algérie, immortalisa cet événement pour le Salon de 1846. De lui, Baudelaire écrivait : « Je hais cet art improvisé au roulement du tambour, ces toiles badigeonnées au galop, cette peinture fabriquée à coups de pistolet, comme je hais l’armée (…) et tout ce qui traîne des armes bruyantes dans un lieu pacifique. » Ch. Baudelaire. Critique d’art suivi de Critique musicale, Paris, Gallimard, folio essais, 1996, p. 131.
[20] . Etudes sur l’Algérie et l’Afrique publiées en 1847 et De l’humanité parue en 1866. E. Bodichon (1810-1885) est une personnalité connue à laquelle le Grand dictionnaire universel du XIXe siècle de P. Larousse a consacré une notice ; ses ouvrages y sont qualifiés « d’intéressants. » t. II, p. 851. En 1932, dans son livre Sociologie coloniale destinée aux « étudiants en sciences coloniales », R. Maunier, professeur à l’Université de Paris, cite, en les condamnant, les thèses exterminatrices de Bodichon ce qui prouve que les spécialistes de la première moitié du XXe siècle les connaissaient.
[21] . « L’extermination est le procédé le plus élémentaire de la colonisation » note, par exemple, A. de Gasparin. La France doit-elle conserver Alger ?, Paris, Imprimerie Béthune et Plon, 1835, p. 44. Maître des requêtes au Conseil d’Etat, Gasparin (1810-1871) fut aussi député de Bastia. De son côté, J. Michelet constate : « le travail d’extermination se poursuit rapidement. En moins d’un demi-siècle, que de nations j’ai vu disparaître » ajoute-t-il en citant les « Indiens de l’Amérique du Nord. » Le peuple (1846), Paris, GF-Flammarion, 1998, p. 193.
[22] . Le dictionnaire Le Robert indique, qu’au XVIIIe, exterminer s’emploie « en parlant d’une seule personne » lorsque celle-ci est entièrement anéantie. Dictionnaire alphabétique et analogique de la Langue française, Paris, Le Robert, 1980, t. II, p. 782. Voltaire use du terme exterminer pour désigner des conflits particulièrement meurtriers. Cf. article « guerre », Dictionnaire philosophique, (1764), Paris, GF-Flammarion, 1990, p 218. Relatant les journées insurrectionnelles de 1832 qui se sont déroulées à Paris et les exactions commises par des gardes nationaux contre les insurgés, Victor Hugo écrit : « le zèle allait parfois jusqu’à l’extermination. » Les Misérables, présentation de R. Journet, Paris, GF-Flammarion, 2000, t. 3, Cinquième partie, Livre premier, XII, p. 236. A propos des massacres perpétrés au cours de certains soulèvements paysans, Emile Zola utilise lui aussi le terme d’extermination. Cf. La Terre, (1887), Paris, Gallimard, 2002, p. 104. Enfin, lorsqu’il traite de la Semaine sanglante, qu’il appelle « l’exécrable semaine » de la Commune de Paris, il dénonce « la férocité » des « bourgeois » et les journaux qui « poussaient à l’extermination. » La Débâcle, (1892), Paris, Gallimard, 2003, p. 573.
[23] . Néologisme emprunté à G. L. Mosse qui l’a forgé pour rendre compte du processus qui s’est développé pendant et après la Première Guerre mondiale au sein des sociétés européennes. Selon lui, ce processus a favorisé l’avènement des régimes totalitaires. Cf. De la Grande Guerre au totalitarisme, Paris, Hachette, 1999, p. 181 et suivantes.
[24] . F. Engels. « Les journées de juin 1848. » in K. Marx. Les luttes de classes en France 1848-1850, Paris, Les éditions sociales, 1981, p. 195.
[25] . G. de Beaumont. Etat de la question d’Afrique. Réponse à la brochure de M. le général Bugeaud intitulée : L’Algérie, Paris, Paulin, 1843, p. 21.
[26] . Ainsi s’expriment E. Larcher et G. Rectenwald, deux juristes rendus célèbres par leur ouvrage fameux consacré au droit colonial algérien. Cf. Traité élémentaire de législation algérienne, Paris, Rousseau & Cie Editeurs, 1923, 3eme édition, t. 2, p. 363.
[27] . Cf. G. Noiriel. Les origines républicaines de Vichy, Paris, Hachette, 1999.
[28] . Cf. R. Koselleck. « Champ d’expériences et horizon d’attente : deux catégories historiques » in Le futur passé, Paris, Editions de l’EHESS, 1990, pp. 307-329.
[29] . Bugeaud, écrit le général Azan en 1948, « a accompli une œuvre admirable, d’où se sont dégagés des principes (…) qui peuvent encore être aujourd’hui médités avec profit. » Il a été « le prédécesseur et le maître des Gallieni et des Lyautey ; il a été le père de cette armée d’Afrique qui a maintenu au XIXe siècle les glorieuses traditions militaires de la France, et qui, au XXe, a si largement contribué à sauver son honneur et sa liberté. » P. Azan. Introduction à Par l’épée et par la charrue, écrits et discours de Bugeaud, Paris, PUF, 1948, p. IX et XXXI. Spécialiste d’histoire militaire, Azan (1874-1951) fut directeur du service historique de l’armée. Il a reçu le Grand prix de l’empire français. Ailleurs, il écrit que « la lecture attentive » de son ouvrage, consacré aux opérations militaires conduites dans l’ancienne Régence, comporte « des enseignements qui s’appliquent à toute entreprise coloniale. » « Le débutant inexpérimenté comme le chef averti peuvent l’un et l’autre trouver d’utiles sujets de méditations dans les projets ou les décisions de chefs tels que Clauzel, Bugeaud ou Randon, et dans les actes glorieux ou pacifiques de l’armée d’Afrique. » Conquête et pacification de l’Algérie, Paris, Librairie de France, 1931, p. V. (Souligné par nous.)
[30] . M. Bloch. Apologie pour l’histoire ou Métier d’historien, Paris, A. Colin, 2002, p. 131.
[31] . « Rapport sur le moral des tirailleurs pour 1956 », source : SHAT 1H2423, cité par M. Harbi et G. Meynier. Le FLN. Documents et histoire 1954-1962, Paris, Fayard, 2004, p. 60.
[32] . M. Bloch. Apologie pour l’histoire, op. cit. , p. 63.
[33] . Pour étude des débats relatifs à ces questions anciennes, cf. A. Grafton. Les origines tragiques de l’érudition. Une histoire de la note en bas de page, Paris, Seuil, 1998.
[34] . M. Foucault. Dits et écrits, 1980-1988, Paris, Gallimard, 1994, t. IV, p. 414.
 Fil des publications
Fil des publications
 liste des ouvrages
liste des ouvrages