
octobre 2006
Michel AgierLe gouvernement humanitaire et la politique des réfugiés
auteur
résumé
Pour préciser ce que j’entends par « gouvernement humanitaire » et pourquoi cette notion m’est nécessaire pour pouvoir aborder la question de l’action politique au sein des espaces humanitaires, il me faut d’abord décrire l’intervention humanitaire dans les différents contextes qui l’instituent.Monde flexible et dispositif multilocalisé, déploiements matériels et humains « à la demande » et espaces des camps. C’est dans l’enchevêtrement de différentes « instances » que prend forme le gouvernement humanitaire. L’ensemble du dispositif n’a pas de véritable coordination mondiale organisée, encore que celle-ci soit imaginable, voire déjà en partie imaginée : certains organismes inter-États ou onusiens, mais aussi quelques très grandes ONG , ont des velléités coordinatrices planétaires. Le HCR joue, dans ce secteur, un rôle dominant sur le plan politique et économique. Dans le même sens, mais au niveau européen, ECHO occupe une place centrale dans le financement et donc le pilotage de l’intervention des ONG des pays européens, en particulier de la vaste nébuleuse des petites ONG sans indépendance financière. Enfin des ONG de surface internationale, telles que MS, ACF, CARE ou IRC, tentent de coordonner l’intervention sur le terrain de leurs différentes sections nationales, plus rarement de définir des campagnes ou des positions communes à l’échelle internationale. |
Mots clefs
à propos
Cet article a été publié dans l’ouvrage collectif de Laurence Cornu et Patrice Vermeren (dir.), La philosophie déplacée : Autour de Jacques Rancière, Colloque de Cerisy, Paris : Horlieu Editions, oct. 2006.
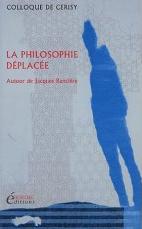
Lors d’une des réunions hebdomadaires des représentants d’organisations non gouvernementales, d’institutions nationales et onusiennes intervenant dans le camp de réfugiés de Tobanda, en Sierra Leone, en novembre 2003, je me trouvais aux côtés de la coordonnatrice de terrain de l’organisation Médecins sans frontières (MSF). Étant alors en train de mener des enquêtes dans ce camp, je lui avais fait part du fait que les gérants du camp [1] avaient démis de sa charge un réfugié mandaté par une partie de ses pairs pour les représenter auprès de l’administration, et l’avaient remplacé d’autorité par un autre, plus jeune, sans charisme auprès de la population mais connu pour être particulièrement « docile » avec les administrateurs. La coordonnatrice de MSF exposa ces faits devant la quinzaine de participants et demanda au chef de camp de s’expliquer. La réponse de ce dernier fut d’une évidence parfaite : « Le camp n’a pas besoin de démocratie pour fonctionner », dit-il sur un ton moqueur et un peu agacé. C’était en quelque sorte la parole d’un chef de gouvernement, qui jugeait directement du sens politique de la situation et disait la Loi. Mais derrière l’évidence, il nous soufflait au contraire la question provocatrice la plus essentielle qu’on puisse adresser à cette situation ; il redisait à sa façon ce qui me semblait être – et plus encore après cet incident – un des résultats les plus importants de mes enquêtes : la démocratie peut renverser l’ordre du camp, comme une émeute peut renverser un gouvernement.
Le monde humanitaire comme fiction totalitaire
Pour préciser ce que j’entends par « gouvernement humanitaire » et pourquoi cette notion m’est nécessaire pour pouvoir aborder la question de l’action politique au sein des espaces humanitaires, il me faut d’abord décrire l’intervention humanitaire dans les différents contextes qui l’instituent.
Dire ce qu’est et ce que devrait être l’humanitaire est devenu depuis quelques années un exercice éditorial et politique courant, avec son lot d’éloges pour les fins dont les images d’humanité perdue attestent sans cesse l’urgente nécessité, et de dénonciations face aux dérives et abus qui entachent l’entreprise tout en la laissant moralement indiscutable. Le substantif, désormais consensuel (« L’humanitaire »), attaché à ce qui relèverait pourtant en principe de la seule action de secours ponctuelle, de l’intervention d’urgence, dit bien comment cette activité s’est installée dans notre environnement. Sans être une organisation unique ou une institution homogène sur le plan social et spatial , le monde humanitaire existe bien à l’échelle de nos représentations et actions « planétarisées ». Je parlerai d’un monde plutôt que d’un système, car il nous faut en premier lieu une notion assez large pour dire à la fois le caractère diffus et « flexible » de ses modes d’organisation concrète et la présence tout aussi diffuse de valeurs propres qui lui donne sont style, son langage, et le font reconnaître sans hésiter. Ce monde se déploie selon le principe du dispositif : ses formes réticulaires mènent vers des espaces nombreux, diversifiés et dispersés sur la planète avec plus ou moins de densité selon les continents – ainsi, l’Afrique, le Proche-Orient et l’Asie sont aujourd’hui les régions les plus « investies » par l’humanitaire. En évoquant le dispositif (et singulièrement le dispositif des camps comme un de ses aspects le plus significatif aujourd’hui), nous retrouvons la lisibilité du monde humanitaire, qu’on perd souvent de vue quand on traite de phénomènes planétarisés : aussi global soit-il, ce monde n’existe toujours que sous des formes locales qu’on peut parcourir, décrire et analyser, même si aucun de ces espaces ne se trouve hors d’atteinte du réseau. Je voudrais d’abord explorer ces différentes échelles, ces différents « lieux » et points de vue qui constituent de proche en proche le monde humanitaire.
J’ai désigné comme main gauche de l’empire [2] la fonction qu’occupe l’intervention humanitaire à l’échelle mondiale [3]. Elle acquiert un sens à ce niveau-là, très général, en tant qu’elle suit au plus près et atténue les dégâts de l’intervention militaire, celle-ci étant conçue comme une opération de police qui agit simultanément en différents points de la planète. Une main qui frappe, l’autre qui soigne. On l’a vu de manière grossière dans les deux interventions militaires dirigées par l’armée américaine en Afghanistan en 2001 et en Irak en 2003 : les distributions aériennes de vivres et médicaments ont accompagné les largages de bombes ; l’évaluation du nombre de survivants et orphelins potentiels à nourrir, la localisation précise et cartographiée des futurs camps pour un nombre annoncé de déplacés, l’installation des tentes et la livraison de milliers de couvertures, ont anticipé les effets programmés des opérations militaires.
D’un côté, la police mondiale exerce le contrôle et, si nécessaire, l’intervention armée sur les crises extrêmes qui ébranlent régulièrement certaines parties du monde considérées comme misérables et « vulnérables », ou sur les conflits dits de faible intensité répartis sur la planète. D’un autre côté, comme cela représente une activité normale et permanente du quotidien planétaire, la main qui soigne nécessite tout un dispositif durable – une organisation, des budgets, des personnels – dont la surface s’est considérablement élargie au cours des dernières décennies et qui a intégré le discours du sauvetage et de l’urgence dans un ensemble durable et puissant. D’un côté, un système mondial consensuel qui a la forme « impériale » au sens où tout adversaire politique est nié et où il ne resterait pour penser le monde que la distinction entre un seul ordre et des « voyous ». D’un autre côté, des actions de soin fondées sur une représentation de l’humanité unique et uniquement mise à l’épreuve dans la figure de la victime absolue, qui est aussi la raison d’être du monde humanitaire. Celui-ci est ainsi pris dans les mailles de fer d’une « solidarité secrète » [4] avec la police armée, sa tâche est donc sans fin. A contrario, elle correspond à la fin de la politique qu’institue le règne sans partage de la police mondiale.
Jacques Rancière qualifie le moment qui correspond à l’objet de nos recherches d’âge nihiliste de la politique [5]. La non-politique est en premier lieu ce moment où il y a une identité entre le tout (représenté dans notre contemporanéité par l’État mais aussi, de proche en proche, par les institutions de la « communauté internationale ») et la somme des parties ; quand, indifféremment, le consensus, la soumission du faible ou la « tolérance » du dominant annihilent, étouffent ou écartent le dissensus qui dit la « mésentente ». Les modes possibles de la non-politique sont, pour le dire de forme synthétique, le tout comme société des individus « exploitant intensément leur propre liberté de désirer, d’entreprendre et de jouir » [6], le tout formé par l’entente parfaite entre des « partenaires sociaux responsables », le tout comme somme d’identités culturelles tolérées. Individualisme, ingénierie politique et communautarisme [7] : quel que soit le mode, il n’y a plus de « partie surnuméraire » dont la voix vienne fausser le compte et donc l’entente. En l’absence de « parasite » entre le tout et la somme des parties, chaque partie du tout se pense dans l’immédiateté au sein du tout, partageant le même destin et intégrant le même logos. C’est un système consensuel dans lequel le tout est tout et où il n’y a pas de reste. Cette identité, ou transparence, s’appelle selon Rancière l’humanité. Associée à son double, la victime absolue (qui n’est rien d’autre que l’humanité souffrante), elle domine le présent : nous vivons à l’âge de l’humanitaire, un âge sans représentation du différend.
Avant de poursuivre, arrêtons-nous un instant sur un point de comparaison possible. Pour l’anthropologue, depuis les différentes théories de la persona (dont le sens va progressivement du masque au statut) [8], l’identité ou la transparence entre la partie que j’observe (l’observation ethnographique) et le tout que je ne vois jamais mais qu’on peut appeler « société » ou « culture » se dit individuation. Je voudrais en quelque mots mettre en relation ces deux idées, l’immédiateté et l’unicité de l’humain d’une part, et la notion de personne que l’anthropologie a construite d’autre part. Il y a d’abord un point de méthode qui est aussi une question de représentation de l’individu dans le monde : dans la tradition holiste de l’anthropologie, « l’informateur privilégié » de l’ethnologue est celui qui n’a d’autre réalité que de dire et incarner le tout de la société ou de la culture dont l’ethnologue pourra présenter, à partir d’un regard externe, la fiction d’une totalité cohérente, oubliant les conflits, les brèches et les formes hétérogènes. De même, on sait qu’il existe une image humanitaire de l’humain, idéalement la femme et l’enfant souffrant, c’est-à-dire une représentation qui force le consentement en montrant la vie doublement nue : pure dans la relation biologique essentielle d’une part, mise à nu dans la souffrance d’autre part.
Mais il y a aussi une interrogation politique possible à partir de l’individuation. C’est parce que l’individu est pris dans les contraintes de pouvoirs et de sens de la société qui l’inclut et où se résume toute son existence, parce qu’il est né et reste sans issue dans la toile terrorisante formée par la puissance des chefs et l’interprétation des sorciers, qu’on peut parler, comme l’a fait Marc Augé, de « totalitarisme lignager » [9], celui au sein duquel la révolte n’a pas de place et dont la seule réponse a été historiquement la fuite : dans l’Afrique des années de la décolonisation 1950-1970, le départ vers les villes et les périphéries urbaines a été synonyme d’émancipation avant d’être pour beaucoup la découverte des lieux de l’abandon.
La question la plus politique que pose l’individuation lignagère poussée jusqu’à son comble totalitaire ne porte pas tant, in fine, sur l’impossibilité de la politique au sein du lignage, du clan ou du monde domestique, mais sur l’absence de dehors, de définition alternative de l’individu dans le monde. C’est ce manque que je retiens ici. Il correspond à l’absence d’alternative dans le « tout » de l’humanitaire.
Le monde humanitaire, lui, est fondé sur la fiction d’une équivalence entre un régime de pensée universaliste (l’humain et son incarnation extrême dans le problème posé par la victime sans nom et sans médiation) et un dispositif mondialisé : un ensemble d’organisations, de réseaux, d’agents et de moyens financiers répartis dans différents pays et parcourant le monde en tant qu’ils sont les hérauts d’une cause universelle comme seule et exclusive raison d’être déclarée. La fiction se réalise, ici et là, pour un temps donné, dans la mise en œuvre d’une « souveraineté mouvante » par des organisations et des agents – des personnes souvent « engagées » et formées aux disciplines des droits de l’homme, des sciences sociales et politiques, des métiers de la santé et de la logistique [10]. Une mondialité organisationnelle est ainsi la réplique du message universel de l’égalité en tant qu’humanité dont le contraire n’est pas l’inégalité mais la souffrance des victimes que le monde humanitaire désigne comme ses ayants-droits.
À l’individuation anthropologique de la personne (la soumission des « cadets » ou la « circulation des femmes » en sont des figures classiques) répond l’assujettissement de la victime absolue, sans phrase : « L’ayant-droit pur et simple n’est alors pas autre chose que la victime sans phrase, figure dernière de celui qui est exclu du logos, muni seulement de la voix exprimant la plainte monotone, la plainte de la souffrance nue, que la saturation a rendue inaudible » [11]. Dans les deux cas, le lignage et l’humanitaire, il n’est pas prévu de reste. Et dans les deux cas, la dualité de la ressource et de la contrainte conditionne la possibilité d’un assujettissement sans violence apparente : ainsi la figure de la personne est-elle le signe d’une reconnaissance sociale de l’individu dans la proximité (famille, voisinage) avant de basculer dans l’oppression extrême du collectif ; ainsi la victime humanitaire trouve-t-elle un secours vital dans le camp de réfugiés avant d’observer que sa voix n’a pas de sens : indésirable autant que vulnérable, elle peut être forcée de rester ou de partir du jour au lendemain et voir « son » camp disparaître, selon l’incompréhensible bon vouloir des organisations internationales qui l’ont ouvert. Dans ce basculement vers la limite du pouvoir sur la vie qu’il institue, le monde humanitaire est un totalitarisme, qui a pouvoir de vie (faire vivre) et pouvoir de mort (laisser mourir) sur l’individu qu’il regarde comme la victime absolue, tout comme le monde lignager exerce son totalitarisme sur la personne à laquelle il dicte absolument son identité et ses devoirs.
Finalement, l’humanitaire en tant que monde social et régime de pensée relève d’une fiction totalitaire. Traverser « pour de vrai » la fiction réalisée peut être une expérience douloureuse. Le retour non voulu des réfugiés « chez eux » (un surdéplacement) ou les problèmes humains ou économiques que pose la fermeture d’un camp vieux de dix ou quinze ans sont vécus comme une violence qui n’a d’équivalent que celle avec laquelle les humanitaires, bien malgré eux, arrivent dans la vie de leurs ayants-droit. C’est par exemple l’obligation faite en juin 2003 aux Libériens et Sierra-Léonais de Conakry de s’inscrire auprès du HCR s’ils veulent avoir une reconnaissance (qu’ils ont demandée par des manifestations dans la capitale guinéenne) puis, quelques jours plus tard, l’annonce du gouvernement guinéen immédiatement relayé par le HCR selon laquelle les réfugiés doivent aller dans les camps de la région forestière, à 600 km de là, faute de quoi ils seront considérés comme illégaux et, « après la date du transfert [vers les camps], les réfugiés qui resteront à Conakry courent le risque d’être pris de force » [12]. À l’obligation d’aller en camp, peut suivre celle d’en partir, comme pour d’autres Sierra-Léonais installés depuis des années dans les mêmes camps guinéens au même moment, et rapatriés non volontaires vers leurs régions d’origine dévastées par les années de guerre et encore fréquentées par des miliciens sans armée deux ans après la fin officielle de la guerre. Dans toutes les étapes de ces parcours, les réfugiés et déplacés découvrent, côte à côte, les personnels et les véhicules blancs des agences onusiennes, des casques bleus et des organisations non gouvernementales humanitaires.
Réfugiés : le Camp, les camps
Environ cinquante millions de personnes sont qualifiées par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR) de « victimes de déplacements forcés » [13]. Parmi celles-ci, entre treize et dix-huit millions, selon les années, sont des réfugiés stricto sensu, c’est-à-dire vivant hors de leur pays. Massivement concentrés en Asie (plus de six millions) et en Afrique (sept à huit millions), ces réfugiés s’ajoutent aux trois millions de Palestiniens réfugiés depuis les années 1940 et 1960 dans divers pays du Proche-Orient. Par ailleurs, un peu plus de trois millions de personnes sont considérées par le HCR comme des returnees, des personnes « en cours de rapatriement ». Enfin, de vingt-cinq à trente millions, selon les estimations, sont des IDPs [14].
Tous ces chiffres sont approximatifs et contestables. Ils n’incluent pas un nombre considérable (mais précisément non recensable) d’exilés non déclarés comme réfugiés et considérés comme des clandestins. Ce sont, par exemple, les 130.000 réfugiés afghans dits « invisibles » suite à l’attaque américaine d’octobre-novembre 2001 en Afghanistan et que le HCR a fait reconnaître in extremis comme « réfugiés » par le gouvernement pakistanais pour pouvoir les placer dans les camps qu’il venait d’édifier en urgence le long de la frontière afghane. Ce sont aussi des réfugiés somaliens, éthiopiens ou rwandais qu’on dit « auto-installés », dans les pays limitrophes, les uns parce qu’ils préfèrent tenter leur chance dans la clandestinité et l’économie informelle plutôt que d’être enfermés dans des camps, les autres errant faute d’avoir eu une reconnaissance officielle de leur statut de réfugié.
La diminution généralement constatée du nombre de réfugiés stricto sensu dans les années 2000 correspond à une augmentation régulière des autres catégories : IDPs, asile territorial, asile humanitaire, etc. [15]. Au fil des décennies, l’image dominante de l’exil se transforme, elle prend successivement l’apparence du réfugié, du déplacé interne puis du demandeur d’asile débouté, et donc du clandestin. Trois identités historiques que peut revêtir aussi, en quelques années ou quelques mois, la même personne dans sa biographie de déplacement. Les biographies parcourent ces identités assignées selon le principe des vases communicants entre catégories et entre régions du monde.
En effet, la réponse couplée humanitaire-policière à la gestion des indésirables s’étend et devient de plus en plus précise sur le plan de la production des catégories et des espaces adéquats. Ainsi, le concept d’« asile interne », introduit dans les discussions entre les États européens dans le cadre des stratégies d’externalisation de la procédure de l’asile, semble faire parfaitement écho à l’expérience des camps de déplacés internes dans les pays du Sud. Il représente l’idéal d’une double mise à l’écart : en camp et dans les pays africains. La stratégie visant à privilégier des pays « tampons », notamment en Afrique du nord, pour cantonner et filtrer les « étrangers », s’appuie sur le même principe d’éloignement-enfermement des indésirables [16]. Le retour actuel de la « solution des camps » qu’on trouve dans les propos et les politiques de certains gouvernements européens pour les demandeurs d’asile, prolonge une stratégie ancienne de mise à distance des indésirables et préfigure la suite de l’usage de la forme-camp.
Les statistiques officielles ne donnent que des images très partielles de la concentration des réfugiés, déplacés ou demandeurs d’asile dans des camps. En 2002, sur quatre millions et demi de réfugiés effectivement recensés dans des camps du HCR, près de la moitié se trouvaient en Afrique (47%), 38% en Asie et 14% en Europe [17]. Et la moitié des trois millions de Palestiniens recensés par l’UNWRA [18] vit dans des camps ouverts entre la fin des années 1940 et les années 1960, principalement au Liban, en Syrie, en Jordanie et en Cisjordanie. En Afrique, la grande majorité des réfugiés pris en charge par le HCR vit dans des camps. A cela s’ajoutent encore les camps de déplacés internes, notamment ceux du Soudan (camps des alentours de Khartoum, dans lesquels vivent environ un million et demi de personnes), du Libéria (500.000 IDPs en camp pendant la guerre, 240.000 y vivent encore fin 2004), ou encore ceux qui ont existé en Angola entre les années 1970 et 2002 et ont reçu plus d’un million de déplacés.
Le regroupement des réfugiés dans les camps est une mesure de police autant que de secours. Les camps sont des niches de formes et tailles diverses cachées à l’intérieur des espaces nationaux. Si les réfugiés sont, selon l’expression qu’usa Michel Foucault au début des années 1980, les premiers êtres « enfermés dehors », ils sont aussi, pour chaque État qui représente le dehors de celui qui exclut, des êtres « mis à l’écart dedans ». La problématique est mondiale mais la responsabilité politique est celle des États : la demande d’asile des réfugiés appelle une réflexion sur l’autorité capable de donner la réponse – le secours, l’hospitalité : le refuge. Or, face à une arrivée plus ou moins importante, à un moment donné, de personnes déplacées ou exilées de force par des guerres ou des violences, le camp est la réponse policière des États-nations (chacun séparément ou tous ensemble en en déléguant la gestion au HCR). Là encore, il n’y a pas de « dehors », c’est-à-dire dans ce cas pas d’espace physique entre le mondial et la somme de tous les États-nations. Pourtant, la tentative de tenir les populations réfugiées à l’écart de l’ordre politique, juridique et social de la nation est constante. Ces deux poussées de sens contraires résultent en une création artificielle et jamais stabilisée d’espaces vides, de déserts interstitiels, de situations fluctuantes synonymes de liminarités, d’indéfinitions, d’extraterritorialité ou d’exception : les camps.
En présentant et commentant le Rapport sur Auschwitz de Primo Levi [19], Philippe Mesnard observe que les auteurs ont utilisé le mot Camp avec une majuscule, voyant là une volonté de construire « comme un Camp générique » à partir de leur connaissance directe du camp d’Auschwitz-Monowitz. La conviction qu’il existe une forme-camp en tant qu’organisation sociale et politique durable ne peut qu’être confirmée par l’important développement des camps de réfugiés dans les années 1980-1990, notamment en Asie et en Afrique, et des camps de rétention d’étrangers et demandeurs d’asile aux frontières de l’Europe dans les années 2000.
Prendre en compte la majuscule du Camp a donc valeur de paradigme et n’implique pas une assimilation des camps de réfugiés actuels aux camps nazis de concentration. Les fins et les moyens divergent profondément, bien sûr, des uns aux autres. Par contre, l’écart est moins absolu du point de vue des formes, et le parallèle permet de mettre l’accent sur une continuité de ce qu’on peut appeler la « solution des camps ». La continuité de la forme-camp – qui dit tout à la fois son caractère multi-usages et son avenir – est bien illustrée, par exemple, par la permanence de certains lieux, de leurs organisations sociales et spatiales, utilisant parfois les mêmes infrastructures d’une période à l’autre, en France depuis les années 1930 jusqu’aujourd’hui : une histoire longue de camps existe incluant sans rupture les camps d’hébergement des réfugiés espagnols, les camps d’internement des juifs français avant leur déportation dans l’Allemagne nazie, les centres de séjours surveillés des collaborateurs de la période d’« épuration » post-guerre, les centres d’assignation à résidence de militants de l’indépendance algérienne, les centres d’accueil des familles de Harkis, et les centres d’accueil ou zones d’attente de demandeurs d’asile depuis les années 1990 [20].
De même, le parallèle entre les camps de réfugiés et les prisons peut être choquant du point de vue des fins, mais il est empiriquement fondé : dans le désert australien, à Woomera en particulier, les camps de détention des réfugiés afghans en attente de réponse à leur demande d’asile ont été reconnus comme des espaces militaro-humanitaires disposant de tout l’appareil d’enfermement mortifère [21]. Il convient aussi de garder à l’esprit et de donner un sens aux propos répétés des réfugiés qui, parlant des installations humanitaires au moment même où ils s’y trouvent, parlent de prison, sans qu’il soit nécessaire pour cela que leur camp soit entouré de murs ou de barbelés. Le confinement et, en général, l’isolement dans des espaces peu ou difficilement accessible « suffisent » à produire l’effet d’enfermement, principal composante, avec l’éloignement, du Camp générique.
Pourtant, la représentation unifiée du Camp, aussi fondée soit-elle en tant qu’institution du biopouvoir, se heurte, hier comme aujourd’hui, non seulement à la multiplicité des formes réelles, mais aussi, et surtout me semble-t-il, à la rapide apparition de désordres dans les espaces des camps. Ces désordres sont de deux types. D’une part, c’est la très grande marge de manœuvre que l’extraterritorialité des camps donne aux « employés du gouvernement » des espaces d’exception. On se trouve, de fait, dans certains camps actuels, non pas dans un cadre moral et social ordonné et régi selon les principes humanistes transmis par les messages onusiens et humanitaires, mais dans une situation proche du « chaos concentrationnaire où la pègre gouverne » [22] comme dans les camps d’autrefois. Abus de pouvoir, sexuels et autres, détournements de ration alimentaire, mise en place de réseaux de travail clandestins, sont le lot habituel du quotidien des camps de réfugiés et de déplacés internes en Afrique, et mobilisent les employés du gouvernement des camps, détenteurs de parcelles de pouvoir sur la vie des réfugiés. D’autre part, et sans y voir nécessairement une contestation de ce qui précède, un autre type de désordre correspond à l’émergence de diverses « résistances » à l’enfermement, qu’elles soient celles de la survie quotidienne (petits arrangements avec les contraintes, trafics de cartes de réfugiés, corruption des policiers, etc.), ou qu’elles soient celles de l’action politique. Ces deux sortes de désordre sont présents dans les écrits sur les camps nazis comme ils apparaissent dans les descriptions actuelles des camps de réfugiés.
Aujourd’hui encore, les deux usages du mot camp me semblent nécessaires, et il convient de les considérer en tension : le Camp en tant qu’institution du biopouvoir pour comprendre que le traitement humanitaire des vulnérables est simultanément la continuation en d’autres temps et sous d’autres cieux d’une mise à l’écart des indésirables ; les camps pour être attentif aux riots dont le fantôme inquiète chaque matin les chefs de gouvernement des camps, pour être attentif à la rupture des règles du pouvoir sur la vie nue, et attentif aux situations dans lesquelles l’action politique vient déranger la scène humanitaire.
Il y a assurément une décision politique de recherche – ou, pour être précis, de « construction de l’objet » – à prendre dans le fait de savoir si l’attention doit être portée sur « le » ou « la » politique, sur le tout comme système toujours inclusif, ou sur le moment politique en tant qu’écart vis-à-vis d’un ordre donné et en tant que voix dissonante, grinçante. La fausse note du réfugié qui ne joue plus son rôle, qui ne tient plus à sa place ou qui ne reste pas silencieux. Cette option-ci permet de ne pas stopper l’enquête, de la poursuivre en introduisant une question imprévue et dérangeante – qu’est-ce que la politique dans les camps d’aujourd’hui ? – qui invite à y aller voir de plus près : comment ça marche ? que se passe-t-il ? qu’est-ce que ça signifie ?
Le gouvernement humanitaire
Monde flexible et dispositif multilocalisé, déploiements matériels et humains « à la demande » et espaces des camps. C’est dans l’enchevêtrement de ces différentes « instances » que prend forme le gouvernement humanitaire. L’ensemble du dispositif n’a pas de véritable coordination mondiale organisée, encore que celle-ci soit imaginable, voire déjà en partie imaginée : certains organismes inter-États ou onusiens, mais aussi quelques très grandes ONG [23], ont des velléités coordinatrices planétaires. Le HCR joue, dans ce secteur, un rôle dominant sur le plan politique et économique – au cours de la seule année 2000 le HRC a contracté plus de 500 ONG pour intervenir auprès des réfugiés qu’il avait en charge. Depuis quelques années, la formation d’OCHA [24] au sein de l’ONU représente une tentative de coordonner l’action humanitaire dans les différents rameaux du dispositif [25]. Dans le même sens, mais au niveau européen, ECHO [26] occupe une place centrale dans le financement et donc le pilotage de l’intervention des ONG des pays européens, en particulier de la vaste nébuleuse des petites ONG sans indépendance financière. Enfin des ONG de surface internationale, telles que MSF (Médecins sans frontières, créé en France), ACF (Action contre la faim, France), CARE (Cooperative for Assistance and Relief Everywhere, USA) ou IRC (International Rescue Committee, USA), tentent de coordonner l’intervention sur le terrain de leurs différentes sections nationales, plus rarement de définir des campagnes ou des positions communes à l’échelle internationale.
La diversité des exemples possibles de mise en réseau à l’échelle mondiale, conjuguée à une absence, voire à une inutilité, d’un grand ordonnateur unique, laisse penser que le gouvernement humanitaire prend une forme comparable à celle du « gouvernement du monde » que Jean-François Bayart décrit [27]. Celui-ci se construit de forme inductive, comme une émanation progressive des relations économiques et politiques entre les États, et non pas comme une imposition ex-maquina qui s’abattrait d’un coup sur l’ensemble planétaire et contre les États. De ce point de vue, on peut dire que le gouvernement humanitaire serait comme en charge d’un « secteur d’activité » du gouvernement du monde, secteur émergent mais plein d’avenir, qui s’occupe des « restes » [28], empêchant ainsi ces restes de trouver la scène politique où s’exprimerait le refus de leur mise à l’écart. Ils équivalent alors à un « rien » sans voix et sans lieu.
C’est dans la gestion de ces espaces du néant et de ces populations en reste que le gouvernement humanitaire exerce pleinement sa tâche et qu’il est le plus visible, localement, alors que sa visibilité mondiale est le plus souvent nulle. Inversement, si la question des camps a une histoire longue et diversifiée sur le plan des fonctions, rapidement évoquée plus haut, on constate qu’elle est aujourd’hui indissociable de son inscription systématique dans le dispositif humanitaire. Deux histoires qui ont été parallèles et se sont parfois juste croisées, celle des camps et celle de l’humanitaire, se sont rejoint et aujourd’hui se superposent.
De manière très palpable dans le cas des réfugiés et déplacés des pays du Sud [29], le gouvernement humanitaire est l’entité qui construit, gère et contrôle, partout où c’est nécessaire, le camp pour y garder des « populations » considérées simultanément ou alternativement vulnérables et indésirables, victimes et dangereuses. Cela demande des aménagements d’espaces vierges, de voies d’accès et de circulation, des installations de tentes et baraques, de la tuyauterie, des puits et canalisations d’eau, des cliniques et écoles de brousse, etc. A cette matérialité correspond une répartition des tâches et une coordination entre les travailleurs (étrangers et locaux) des différentes ONG et agences onusiennes qui sont autant de « branches » du gouvernement humanitaire opérant localement, par délégation, sous le contrôle du chef de camp. Alimentation, santé, voirie, jeunesse, abris, sécurité, environnement : à chacun son « porte-feuille ».
La politique est le désordre du Camp
Comment l’action politique advient-elle sur la « scène humanitaire » [30] qui en exclut par principe toute utilité et toute efficacité ?
Ce que l’observation des camps permet de décrire est une tension. Certes, un dispositif de pouvoir, de catégorisation, fichage, contrôle et enfermement se réalise dans un cadre local de gouvernement qui « n’a pas besoin de la démocratie pour fonctionner ». Le camp est alors tout à la fois la métaphore et la réalisation concrète du traitement à part des restes humains sans voix et sans place dans le monde. Cependant, en même temps qu’ils se consolident un peu sur le plan matériel, les camps se transforment en quelques mois, en deux années tout au plus, en des milieux sociaux relativement stables, des mondes de relations traversées d’injustices, de violences et de frustrations, autant que de rencontres, de débrouilles et de certaines formes de prise de parole. Les camps comme milieux sociaux sont en tension avec le Camp comme modèle, et d’abord en tension avec le gouvernement humanitaire qui exerce le commandement et peut devenir leur cible. Il est alors possible de reconsidérer la proposition selon laquelle l’humanitaire exclut la politique en faisant porter le regard, au sein des espaces humanitaires, sur les situations de mobilisations collectives, de prises de parole et d’émergence de meneurs, aussi infimes et minoritaires soient-elles.
C’est dans les failles du système, les ratés de l’œuvre humanitaire, que se voit, pour ainsi dire, la « matière brute » de l’injustice, contredisant la fiction annoncée de l’égalité de traitement pour toute l’humanité souffrante. Inégale distribution de couvertures, quantité ou qualité désastreuses de la ration alimentaire, insultes et violences physiques sur les « foules » demandant de l’aide. La question politique qui se pose alors, sur le terrain, renvoie à une énigme partagée par tous les sans voix : comment passe-ton de la plainte au cri, comment naît la prise de parole ? Pour que l’injustice existe, elle doit pouvoir être dite. Dans l’espace du camp, pour être entendue elle doit prendre place dans le langage de la vulgate humanitaire, qui est la seule convention de parole localement audible. La politique prend donc, dans ce contexte, des voies inexplorées.
Si le droit de vivre est attribué dans la fiction humanitaire à un humain générique en tant qu’il est reconnu dans la victime universelle, en pratique ce droit est donné selon l’appartenance à des catégories assignées. Ainsi, le réfugié, le « déplacé », la femme réfugiée, l’enfant réfugié, reçoivent leur kit de survie pour autant qu’ils sont reconnus comme appartenant à ces catégories. Au sein des camps, la catégorie « réfugié » est elle-même découpée en catégories distinctes de « vulnérabilité », qui finissent par créer une hiérarchie du malheur [31]. Cet exercice de partage qui est la mise en œuvre du biopouvoir, est aussi une brèche à partir de laquelle peut s’exprimer un refus. J’en donnerai deux brefs exemples : l’action des femmes veuves du camp d’Albadaria en Guinée forestière en juillet-août 2003 d’une part, la formation de leaders dans le camp de Tobanda en Sierra-Leone d’autre part [32].
Dans le premier cas, une cinquantaine de femmes réclament la reconnaissance d’une « vulnérabilité » particulière bien que la catégorie n’existe pas comme telle (« femmes veuves avec enfants » pouvant entrer dans la catégorie « parent seul »). Elles demandent des bâches plastifiées afin de protéger des pluies diluviennes leurs cases en terre battue. Devant l’absence de réponse des administrateurs du camp, elles occupent la voie principale du camp en scandant « Nous voulons des bâches ! », elles arrêtent des volontaires européens d’une ONG pendant plusieurs heures en les maintenant sous la pluie, puis elles bloquent un véhicule de la Croix Rouge. Elles établissent ainsi un face-à-face entre le monde globalement perçu des « U.N. » [33] et celui de leurs ayants-droits. Les représentants des ONG ne seront relâchés que lorsque les femmes auront obtenu un rendez-vous avec les responsables de l’administration guinéenne chargée des réfugiés. Une délégation de quatre femmes sera reçue par cette autorité, et quelques jours plus tard les femmes veuves recevront les bâches.
Ce mouvement montre une politisation de la catégorie de « vulnérable ». Alors que celle-ci est associée à la figure de la victime dans le langage humanitaire, elle devient un mot du langage « égalitaire » par lequel un sujet politique agit contre l’identité assignée de victime silencieuse. Des boycotts de la ration alimentaire du Programme Alimentaire Mondial, des manifestations devant les portes des « compound » humanitaires [34] pour demander plus de nourriture ou un retour au pays de provenance ou au contraire une permanence dans le camp, des protestations publiques contre les mauvaises conditions de vie des réfugiés [35]… tout conflit social dans le camp est aussi un conflit sur le sens des mots du langage humanitaire. Non pas parce que les ayants-droits opposeraient leurs « propres » mots (ethniques par exemple) à ceux des « internationaux » ou « occidentaux » qui dirigent le camp. Mais parce que les actions mettent en scène une interprétation dissonante des mots disponibles – « réfugié », « vulnérable », « U.N. », etc.– et dans ce geste, les repolitisent.
Quelques jours avant la manifestation dans le camp d’Albadaria qui vient d’être évoquée, la femme qui fut à la tête du mouvement avait reçu personnellement une bâche plastifiée. Sans la refuser, elle ne l’avait cependant pas installée, par solidarité avec les autres femmes et soupçonnant le HCR d’avoir tenté ainsi une démobilisation du mouvement dont elle était la leader. Elle était ainsi elle-même dans un écart au rôle assigné de « vulnérable » qu’elle était supposée jouer sur la « scène humanitaire », et prenait une distance liée à son rôle de représentante du mouvement.
Dans le camp de Tobanda en Sierra Léone [36], une vingtaine de personnes sont apparues en moins d’un an comme parlant « au nom » des réfugiés de leur secteur. Certains furent d’abord des « chefs de tente » (désignés pour représenter les personnes installées à leur arrivée dans une tente collective), d’autres pasteurs et prêcheurs d’églises pentecôtistes, travailleurs des ONG du camp ou commerçants. Cela déplaît aux volontaires expatriés des organisations humanitaires, mais ces représentants sont généralement les moins « vulnérables » des réfugiés.
Dans un des secteurs du camp où je cherchais à rencontrer et m’entretenir avec des réfugiés, un commerçant de diamants, bien portant et responsable de son « quartier », fut celui qui porta la phrase égalitaire : « Tous les réfugiés sont vulnérables », dit-il, avant d’énumérer une longue liste de revendications : la nourriture n’était pas suffisante, trop peu de gens recevaient les couvertures promises, il y avait des trafics de couvertures, il n’y avait pas assez de toilettes, des problèmes en permanence avec les bâches plastifiées. Il dit : « Tu es blanc, tu connais les organisations, les U.N., donc tu dois répondre ».
L’approbation du groupe des résidents qui grossissait alors que les personnes s’approchaient de sa maison devant laquelle avait lieu notre entretien… me fit penser que, pour un instant, une scène démocratique venait de s’introduire dans l’espace humanitaire.
NOTES
[1] Appartenant à l’organisation non gouvernementale Luhterian World Federation (LWF) qui gérait le camp au titre d’un contrat passé avec le Haut commissariat des nations unies pour les réfugiés (HCR).
[2] M. Agier, « La main gauche de l’Empire. Ordre et désordres de l’humanitaire », Multitudes, n°11, 2003.
[3] La métaphore est empruntée à Pierre Bourdieu qui a désigné comme « main gauche de l’État » les travailleurs sociaux de la nation dont le malaise vient du caractère désespéré de leur travail consistant à réparer sans cesse les dégâts sociaux et culturels d’une « main droite » de l’État formée par des gestionnaires appliquant les principes économiques de rentabilité et retour sur investissement à la gestion publique (voir P. Bourdieu, « La démission de l’État » in La misère du monde, Paris, Seuil, 1993, p. 219-228). Même position relative, même malaise chez les volontaires de l’action humanitaire qui partent soigner des plaies à l’autre bout de la planète.
[4] Giorgio Agamben, Homo sacer I. Le pouvoir souverain et la vie nue, Paris, Seuil, 1997, p. 144.
[5] J. Rancière, La Mésentente, Politique et philosophie, Paris, Galilée, 1995, p. 167-188.
[6] La Mésentente, op. cit., p. 169.
[7] Je ne parle pas des formes sociales et culturelles de ces réalités, dont l’évidence ou la nécessité ne sont pas discutées ici, mais bien de la forme politique de leur existence.
[8] Voir en particulier, Marcel Mauss, « Une catégorie de l’esprit humain : la notion de personne, celle de ‘moi’ » (1938), in id., Sociologie et anthropologie, Paris, PUF, 1950, p. 331-362 ; Louis Dumont, Essais sur l’individualisme. Une perspective anthropologique sur l’idéologie moderne ; Paris, Seuil, 1983 ; l’ouvrage collectif La notion de personne en Afrique noire, éditons. du CNRS, 1973 ; Marc Augé, Le sens des autres, Paris, Fayard, 1994 ; Alain Marie (éd.), L’Afrique des individus, Paris, Karthala, 1997.
[9] M. Augé, Pouvoirs de vie, pouvoirs de mort. Introduction à une anthropologie de la répression, Paris, Flammarion, 1977.
[10] Voir Mariella Pandolfi, « Une souveraineté mouvante et supracoloniale », Multitudes, n°3, 2000, p. 97-105 ; également « Contract of Mutual (in)Difference : Governance and the Humanitarian Apparatus in Contemporary Albania and Kosovo » (Indiana Journal of Global Legal Studies, vol. 10, 2003, p. 369-381) où sont décrites et analysées l’action et les valeurs morales mises en œuvre par des organisations et des individus participant à l’intervention humanitaire au Kosovo et en Albanie dans les années 1990.
[11] J. Rancière, La Mésentente, op. cit., p. 172.
[12] Note officielle du Représentant du HCR en Guinée, Conakry, 7 juillet 2003.
[13] Voir notamment les deux dernières publications du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR 1997, 2000).
[14] « IDPs » : Internally Displaced Persons selon la définition onusienne, catégorie d’ayants-droits désignant des personnes qui ont quitté leur région d’origine pour cause de violences ou de guerres internes, mais sont restées à l’intérieur des frontières de leur pays.
[15] En 1999 dans l’Union européenne, un quart seulement des réfugiés étaient « statutaires », c’est-à-dire relevant de la convention de Genève de 1951 sur les réfugiés, les autres accédant à un asile temporaire ; en France la part d’acceptation des demandes d’asile dite « conventionnelle » est passée de 80% à 20% entre 1981 et 1999 (voir Daphné Bouteillet-Paquet, « Quelle protection subsidiaire dans l’Union européenne ? », Hommes et Migrations, n° 1238, 2002, p. 75-87).
[16] Sur ces questions, je renvoie à diverses publications récentes : le dossier « L’Europe des camps. La mise à l’écart des étrangers », Culture et conflits, n°57, 2005, le dossier « Migrations en Europe : les frontières de la liberté », Multitudes, n°19, 2005, ainsi que la « Carte des camps d’étrangers en Europe et dans les pays méditerranéens » de Migreurop (régulièrement mise à jour sur le site http://www.migreurop.org).
[17] Voir UNHCR 2002 Statistical Yearbook (http://www.unhcr.ch).
[18] Organisation de l’ONU chargée depuis 1948 de la prise en charge internationale des réfugiés palestiniens, en particulier de la gestion des camps.
[19] Voir Primo Levi, Rapport sur Auschwitz, Présentation et appareil critique de Philippe Mesnard, Paris, Kimé, 2005. Le « Rapport sur l’organisation hygiénico-sanitaire du camp de concentration de Monowitz pour Juifs (Auschwitz, Haute Silésie) » a été écrit en 1945 et 1946 par Primo Levi en collaboration avec Leonardo Debenedetti.
[20] Les camps d’Argeles, Rivesaltes ou Saint-Mître ont incarné cette solution bien avant Sangatte ou les ZAPI de Roissy. Voir Marc Bernardot, « Le pays aux mille et un camps. Approche socio-historique des espaces d’internement en France au XXe siècle », Les Cahiers du Cériem, n° 10, décembre 2002, pp. 57-76.
[21] Voir Philippe Rivière, « L’asile aux antipodes », in Le Monde diplomatique, Manières de voir, n° 62, 2002.
[22] Selon les termes de Philippe Mesnard commentant les descriptions du Rapport sur Auschwitz de Primo Levi (cf. Ph. Mesnard, « Un texte sans importance », in P. Levi, Rapport sur Auschwitz, op. cit., p. 9-47, citation p. 40).
[23] Organisations non gouvernementales.
[24] UNOCHA : Bureau de l’ONU pour la coordination des affaires humanitaires.
[25] Il est de ce point de vue très révélateur que des conflits de compétence se manifestent entre le HCR et OCHA sur le terrain, dans les régions où interviennent massivement les ONG internationales et les organisations de l’ONU. C’est le cas par exemple à Monrovia, la capitale du Libéria, durant la guerre et depuis la sortie de la guerre en 2003, où des tensions fortes existent entre les directions des deux organismes pour déterminer lequel des deux doit avoir la responsabilité (et les financements) du contrôle des IDPs dans le pays.
[26] ECHO : Bureau de l’union européenne pour l’aide humanitaire.
[27] J.-F. Bayart, Le gouvernement du monde. Une critique politique de la globalisation, Paris, Fayard, 2004.
[28] On pense aux « vies gâchées » de Zygmunt Bauman (Wasted Lifes. Modernity and its outcasts, Cambridge, Polity, 2004).
[29] Alors que la prise en charge par l’humanitaire des camps pour clandestins, demandeurs d’asile et déboutés en Europe n’en est probablement qu’à ses débuts.
[30] La Mésentente, op. cit., p. 172.
[31] Le HCR distingue quinze catégories de « vulnérables » qui incluent, par exemple, l’« enfant non accompagné », le « survivant de violence », le « parent seul » ou la « femme seule ».
[32] Ces cas sont présentés plus longuement dans un autre texte, je me permets d’y renvoyer : « Le camp des vulnérables. Les réfugiés face à leur citoyenneté niée », Les Temps modernes, n° 627 (L’humanitaire), mai-juin 2004, p. 120-137.
[33] Représentants, en général blancs, de la communauté internationale.
[34] Espaces protégés au sein ou à proximité des camps où se trouvent les bâtiments de l’administration, et dans certains cas les logements des agents des organisations internationales.
[35] Qui peuvent se faire devant des assemblées religieuses, ou dans tel ou tel « secteur » ou « block » des camps.
[36] Il s’agit du camp où se situe l’incident présenté au tout début de ce texte.
 Fil des publications
Fil des publications

