Chacun doit être compté, mais seulement s’il/elle compte. Les migrants morts ne comptent pas. La femme qui s’est noyée en donnant naissance n’était pas un sujet biométrique, elle n’était qu’un sujet biodégradable.
Frances Stonor Saunders [1]
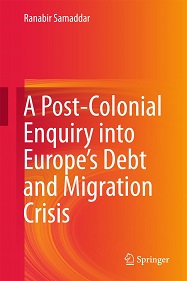 Voici, de la plume du politologue Ranabir Samaddar, un livre nécessaire et salutaire pour les lecteurs européens, qu’ils ont intérêt à lire. L’idée d’étudier et de relier par un biais postcolonial stratégique et non-idéologique la relation entre la crise dite migratoire en Europe et la crise financière presque contemporaine (véritablement, le destin de la Grèce) est une idée brillante. Il faut croire qu’il aura fallu un regard décentré, un regard de biais et de l’extérieur pour nous ouvrir les yeux. Ce qui saute aux yeux n’est en effet pas toujours visible vu de trop près. Ranabir Samaddar est professeur émérite de la Chaire sur les migrations et sur les études des migrations forcées [2] du Calcutta Research Group [3], important institut d’études sociales, historiques et politiques de Calcutta qu’il a cofondé. Il a en effet beaucoup travaillé sur les réfugiés par le passé. Invité régulièrement pour des conférences, séminaires et recherche en Europe, il connaît très bien cette dernière également [4].
Voici, de la plume du politologue Ranabir Samaddar, un livre nécessaire et salutaire pour les lecteurs européens, qu’ils ont intérêt à lire. L’idée d’étudier et de relier par un biais postcolonial stratégique et non-idéologique la relation entre la crise dite migratoire en Europe et la crise financière presque contemporaine (véritablement, le destin de la Grèce) est une idée brillante. Il faut croire qu’il aura fallu un regard décentré, un regard de biais et de l’extérieur pour nous ouvrir les yeux. Ce qui saute aux yeux n’est en effet pas toujours visible vu de trop près. Ranabir Samaddar est professeur émérite de la Chaire sur les migrations et sur les études des migrations forcées [2] du Calcutta Research Group [3], important institut d’études sociales, historiques et politiques de Calcutta qu’il a cofondé. Il a en effet beaucoup travaillé sur les réfugiés par le passé. Invité régulièrement pour des conférences, séminaires et recherche en Europe, il connaît très bien cette dernière également [4].
Ce livre aborde ses sujet par plusieurs biais : l’économie, la politique, la sociologie, l’histoire (aussi bien de l’Europe que des migrations). Il pourra en surprendre certains, en en particulier ceux qui, baignant dans l’hypocrisie européenne actuelle à propos des migrants et refugiés (il s’agit justement de ne pas séparer ces catégories), refusent encore de voir un tableau plus large. Car nos horizons sont souvent bouchés par les frontières nationales, même pas celles de l’Europe élargie qui, d’ailleurs, ces dernières, ne sont pas très claires (jusqu’où ira, irait l’Europe ?), alors que l’Europe a déjà bafoué la possibilité de passage de ses frontières internes, celles dites de Schengen. On peut dire que l’Europe de l’ouverture intérieure, mais aussi celle d’une ouverture possible vers l’extérieur et vers son voisinage a capitule l’été de 2015 au moment de la première nouvelle « vague » de migrants par la Grèce, le maillon le plus faible. Jusque là, les migrants arrivaient ou mourraient régulièrement sur nos frontières sans que cela fasse une nouvelle [5]. Le spectacle d’un petit garçon mort sur une plage a changé le regard des médias et des Européens. Certains se sont scandalisés par ces morts à nos portes (ou essayaient déjà d’en avertir l’opinion publique), d’autres se sont formalisés plutôt par la « violation » de nos frontières. Tout ce qui se passe depuis, les accords infâmes avec la Turquie sur les réfugié-e-s, le Brexit, les disputes internes sur Schengen ou pas (que d’ailleurs la France la première a honteusement fait capoter), le décompte des quelques (trop peu nombreux) migrants ou réfugié-e-s accepté-e-s pour une vie d’enfer dans le provisoire même pour pouvoir seulement demander l’asile, et puis le comptage approximatif des morts dont on ne saura jamais le nombre [6]. Le phénomène existe ailleurs, nous savons tous que Trump veut parachever un mur déjà construit envers le Mexique, que des murs existent de partout dans monde pour empêcher l’immigration, et qu’en 2015-16 il en fut construit une quantité sur les routes européennes de la migration (réussissant même à l’empêcher ou à la réduire pour un temps). Et quand ce ne sont pas des murs, ce sont des lois et règlementations ou des campagnes xénophobes, islamophobes et racistes par les réseaux sociaux ou dans les médias qui se chargent de l’arrêt de passages et arrivées. L’obligation du non-refoulement stipulée par la Convention de Genève de 1951 a été allègrement bafouée et désormais gouvernements de droite et de gauche s’emploient à endiguer ce qu’ils présentent comme une vague qui va nous engloutir.
Au moment où l’on célèbre dans le vide les soixante ans de l’accord de Rome établissant la Communauté économique européenne, qui promettait quand-même plus d’ouverture, l’Europe jette encore des gens en mer. Pourtant à l’époque de la fondation de l’Europe en devenir (1957 [7]), les promesses étaient autres. La France après une série d’échecs dans son parcours colonial (Dien Bien Phu, Suez, l’Algérie bientôt) avait bien besoin d’une Europe solide et solidaire. L’Allemagne, elle, avait besoin, après la deuxième guerre mondiale, de réintégrer la tête haute les relations internationales par un biais crédible, et les autres pays fondateurs y trouvaient tous leurs intérêts. C’était aussi un petit pas de côté par rapport à la surpuissance des Etats-Unis, grands gagnants de la guerre, et à l’OTAN. Cette nouvelle alliance européenne était aussi en face de l’Union soviétique, et confirmait la Guerre froide. Elle ne pouvait de toute évidence pas durer pour toujours sur ces principes-là. D’autant plus que, de l’autre côté et après la conférence de Bandung (1955) qui rassemblait des pays asiatiques et africains, les pays Non-alignés établirent leur alliance avec une plus grande ambition et se réunissaient à Belgrade en 1961. Ils allaient tenir tête, aux Nations unies, et pendant la durée de la Guerre froide, aux deux blocs.
Une grande partie du livre de Ranabir Samaddar et son premier chapitre en particulier sont consacrés à l’histoire et à l’analyse bien détaillée de la situation de la Grèce en Union européenne. C’est la clef de l’entrée dans le raisonnement de l’auteur. Nous nous souvenons encore tous de l’étonnant été 2015 et des dures, très dures négociations entre le gouvernement Syriza de Tsipras avec l’Union européenne et surtout avec l’Allemagne, sur sa dette. Des mesures et sanctions de plus en plus dures étaient infligées à une Grèce déjà exsangue, on la pressait pour qu’elle restitue sa dette ce qui, puisque impossible, ne faisait qu’entrainer le cumul de nouvelles dettes de plus en plus importantes. L’austérité imposée allait passer ou casser. Elle a cassé le gouvernement grec, qui a capitulé, ne pouvant plus tenir tête principalement à l’Allemagne, plus à son ministre des finances Schäuble qu’à la chancelière Merkel. La tension politique montait en Europe tout au long de cet été. Le jour de la capitulation de Tsipras, elle est soudain tombée. La Grèce avait perdu son pari, elle serait sacrifiée sur l’autel de l’euro fort (non pas qu’elle n’ait pas eu de responsabilité elle-même dans cette affaire). Les Allemand se disaient qu’ils n’allaient pas payer les dettes des Grecs, et les Grecs se disaient qu’ils ne pouvaient pas être menés par le bout du nez par une Europe riche au dessus de leurs moyens, incarnée dans l’Allemagne. Le jour-même où la tension est retombée car la Grèce avait perdu son pari, les médias qui n’arrivent pas à traiter plus d’une nouvelle signifiante à la fois, se sont tournés vers l’annonce de l’arrivée de nombreux réfugié-e-s en Grèce (depuis des années, des refugié-e-s arrivaient en Italie et ailleurs, et mourraient en mer, sans que cela fasse la une). Mais le lendemain de la capitulation de la Grèce face à l’Europe, les réfugié-e-s ont bien fait la une. C’est alors seulement que nos gouvernements se sont inquiétés (toujours sans aider l’Italie ou la Grèce à l’accueil), ont présenté le phénomène comme dangereux pour l’Europe et le flux comme modulable. On allait l’arrêter coûte que coûte, en nourrissant une xénophobie grandissante. Les citoyens et les associations en Europe, eux, ont souvent réagi en revanche en direction de’un accueil consenti.
Le livre parcourt en détail, de jour en jour, tout l’été chaud grec, avec toutes les négociations avec l’Europe et l’Allemagne en particulier. Il démonte les mécanismes à l’œuvre et l’hypocrisie d’une bureaucratie néolibérale blindée, celle d’une Europe bien néolibérale déjà établie trop profondément pour qu’on puisse encore la modifier dans la direction d’une politique de l’Etat-providence. Il accuse l’espoir investi des politiques mais aussi de certains intellectuels de gauche, alors qu’il n’est plus possible de faire un retour en arrière vers une Europe plus sociale (et il démontre pourquoi cela n’est pas possible). Les arguments sont impitoyables, les évènements bien documentés. Finalement, Samaddar construit et montre le destin « colonial » de la Grèce. Non seulement cette dernière est-elle réduite comme une colonie de l’Europe, mais encore, riche de son expérience de vie et de son analyse (post)coloniale, l’auteur jette un éclairage très convaincant sur ce pays. Il rejoint en cela un ouvrage comparable, Portugal de Boaventura de Sousa Santos, qui théorise également (et plus largement que Samaddar) le destin selon lui « semi-colonial », à divers degrés, des pays périphériques et du sud de l’Europe, tels que l’Islande, l’Irlande, le Portugal, en partie l’Italie, l’Espagne la Grèce [8]. Ces pays, mais particulièrement le Portugal aux yeux de De Sousa Santos, seraient des colonies en quelque sorte internes de l’Europe, traités comme subalternes ou de seconde zone, des pays avec moins de souveraineté et de marge de fonctionnement que les pays du nord dans le cadre de l’Europe.
Ranabir Samaddar poursuit, dans son deuxième chapitre, sur la théorie et le déroulement des négociations en général, et celles de la Grèce en particulier. Il parle ici en expert, ayant beaucoup travaillé sur ces thématiques [9], qu’il nomme simplement « dialogue ». Pour lui, il faut reconnaître aux négociations le caractère guerrier (négocier, c’est être en guerre), il faut avoir un plan alternatif (ce que Tsipras n’avait pas), il faut savoir prévoir les réactions de l’adversaire (Tsipras ne le pouvait pas), il faut comprendre qu’un « dialogue » se déroule toujours dans un contexte où il y a d’autres acteurs, et qu’il y a toujours beaucoup d’inconnues.
Le troisième chapitre parle de l’« idéologie européaniste » Il dégage en effet et met à nu cette thématique de manière crédible. L’idéologie européaniste, d’un « nationalisme » européen supranational, d’un projet désormais néolibéral, empêche la Communauté européenne d’arriver à des négociations conciliantes avec la Grèce, et est ce qui la rend intransigeante et dogmatique. A propos du concept d’idéologie européenne il est impossible de ne pas penser au livre du marxiste Perry Anderson The Indian Ideology [10], qui fut extrêmement mal reçu en Inde. Samaddar évoque une certaine « classe intellectuelle transnationale », confondue avec une « nouvelle gauche » pas mieux décrite, qui serait à l’origine du manque d’ouverture de l’Europe à la fois envers la Grèce et les réfugié-e-s, mais sans plus la théoriser.
Le quatrième chapitre parle en détail de ce que l’Europe décrit – et craint - comme crise migratoire, mais ce qui n’est que l’une des crises européennes. Il décrit avec des mots très forts l’histoire des migrations et la condition des migrants (non seulement en Europe, mais particulièrement en celle-ci), et remet ce phénomène dans son contexte mondial et celui du nouveau capitalisme néolibéral : les migrants ne disparaîtront pas, qu’on le veuille ou non. Il esquisse (à peine) une solution alternative, celle d’une Europe de gauche, consciente de son passé colonial et impérial [11], et l’ayant digéré, mais il ne la développé pas. Quels seraient les agents de cette révolution qu’il appelle de ses vœux ? A part ses différences ébauchées d’avec quelques théoriciens européens, on ne voit pas bien d’où l’initiative pourrait bien venir. Pourtant une solution de lecture et de compréhension de la nouvelle situation est bien proposée surtout dans ce chapitre et dans le dernier, et elle fait le lien entre la crise financière en Europe (en particulier sous la forme de la dette Grecque) et la crise dite de la migration. La dette européenne dont il parle, au delà des dettes financières, pourrait aussi être symbolique, celle que l’Europe doit à ses anciennes colonies.
C’est là l’idée aussi brillante que simple du livre, il fallait y penser : la condition postcoloniale assumée fait le lien entre les deux problématiques et peut nous aider à comprendre. Le dernier chapitre s’emploie à l’expliquer. Non seulement l’Europe a un passé colonial, mais nous nous trouvons tous, l’Europe aussi bien que les migrants, dans le contexte d’une histoire globale. Au sein de celle-ci, il s’agit de reconnaître toutes les connectivites et dépendances, et non pas d’en passer sous silence, au delà des histoires officielles. Avoir humilié la Grèce, lui avoir tout dicté sans qu’elle puisse avoir son mot à dire dans les négociations de l’été 2015 (sans doute était-il déjà trop tard) fait sens si on comprend à quel point elle fut réduite à une quasi colonie. Mais cela fait sens aussi dans le cadre du projet d’une Europe rigide, néolibérale et intransigeante, une Europe des finances qui a abdiqué son volet social, pourtant modéré. L’auteur nous dit qu’elle ne va pas revenir en arrière vers un Etat providence (même si certains pays, telle la France, en gardent encore des vestiges importants, mais pour combien de temps ?), et nous le savons bien. Alors, prendre à bras le corps notre passé colonial serait une bonne chose et nous ferait avancer au moins sur le plan des connaissances et de la culture politique.
Et puisque nous sommes en période préélectorale, disons qu’il nous semblerait très souhaitable que les candidats aux élections présidentielles en France (et ailleurs) puissent lire ce livre et en apprendre quelque chose.


 Fil des publications
Fil des publications