

citation
Patrick Bruneteaux,
"La révélation de la zone grise dans la dénégation du passé esclavagiste : Le cas de la muséographie martiniquaise ",
REVUE Asylon(s),
N°11, mai 2013
ISBN : 979-10-95908-15-9 9791095908159, Quel colonialisme dans la France d’outre-mer ? ,
url de référence: http://www.reseau-terra.eu/article1283.html
résumé
Pour montrer clairement l’espace symbolique entre le monde des « Mulâtres » et le monde des « Nègres », héritage de la structure plantationnaire, on se propose de donner à voir deux visions antagoniques du passé esclavagiste. Pour ce faire, nous avons constitué un corpus de photographies de deux sites muséographiques exemplaires de l’esclavage, tout en élargissant le propos sur la base d’un corpus d’une dizaine de musées locaux. Le premier exprime la dénégation des conditions de vie extrêmes sur l’habitation. Financés par une fraction des élus politiques martiniquais, notamment le courant majoritaire des « autonomistes » du Conseil général, mais aussi par le Conseil régional dit « indépendantiste » (notamment l’éco-musée de l’Anse figuier), ces musées s’alignent sur le même cadrage politique d’acteurs qui « persévèrent à voiler la perspective historique » et à renforcer « la dépendance vis-à-vis de la puissance coloniale » . On prendra comme base d’appui empirique majeure l’exposition temporaire de 2006 sur l’ancienne plantation du « père Labat » (tout en inventoriant d’autres sites). Le second, musée permanent, exprime un réalisme documentaire adoptant finalement le point de vue des historiens. Il a été inventé par un « nègre en bas feuille », un dominé djobeur de la campagne, ouvrier/paysan sans qualification autre que son savoir faire hérité des Anciens : la Savane des esclaves, musée permanent mis sur pied par Gilbert Larose.
Mots clefs
La propension à vouloir masquer les violences coloniales passées est liée à l’implication des dirigeants du « peuple noir » à la Martinique. Aussi paradoxale qu’elle puisse l’être, cette proposition constitue l’hypothèse dorsale de cette contribution permettant d’accéder à la compréhension de l’écriture ultra euphémisée des violences coloniales dans la muséographie antillaise. La dénégation du passé colonial [1], notamment les exactions menées sur les plantations békées contre les esclaves, ne peut être compris hors de l’approche structurale des liens historiques, toujours fortement présents, qui unissent les planteurs, les technocrates français et les élites noires [2]. Ces dernières sont les acteurs déterminants de l’occultation qui, depuis les trente dernières années, caractérise l’organisation de la mémoire muséale. De nombreux auteurs ont pointé cette oblitération du passé, d’autant plus incompréhensible que la vocation du musée, lieu de mémoire par excellence, rejoint toutes les thématiques possibles de l’expérience humaine, y compris les violences extrêmes [3]. On pourra disserter sur la violence symbolique qui entoure le décret d’abolition de l’esclavage en 1848 -la promotion de la liberté et de la citoyenneté moyennant une obligation de revenir sur les traumatismes du passé au nom de la réconciliation et de la construction du « Nouveau pays »- [4], cela ne permet pas de comprendre les silences qui entourent l’objet « esclavage » jusqu’à aujourd’hui. A moins de croire à une sorte de mémoire collective officielle figée qui perdurerait réifiée pendant des décennies sans aucun pouvoir des hommes sur le « marchandage » originel, il n’est pas tenable de s’en tenir à une polarisation entre intérêt à cacher (universalisme républicain) et intérêt à dire la vérité historiographique d’aujourd’hui. Ce dualisme masque en fait les luttes de sens qui ont traversé les Martiniquais eux-mêmes, pas seulement les Blancs envers les Noirs (Békés versus descendants d’esclaves) mais aussi les Noirs entre eux. Plutôt que de penser les « Martiniquais » comme les éternelles victimes collectives d’un renoncement qui fut imposé par le pouvoir, pas plus, non plus, que le musée ne saurait dire le réel esclavagiste sous prétexte qu’il est généralement une institution du pouvoir comme l’affirme C.A. Celius, il faut rendre compte du travail constant d’enfouissement de la vérité historique par certains groupes ou leurs représentants attitrés.
Cette élite noire a été identifiée au travers d’un de ses groupes support (les « Mulâtres »), notamment dans l’ébauche intellectuelle que fut l’unique numéro de la revue Légitime Défense [5], puis au travers de l’essai classique de F. Fanon Peau noire masques blancs, relayé trois ans après par la rigoureuse synthèse de Michel Leiris [6]. Aux USA, dans la mouvance de l’Ecole de Chicago, des chercheurs afro-américains avaient déjà disséqué les spécificités des familles descendant de l’univers plantationnaire, à commencer par F.E. Frazier, connu pour sa contribution rare La bourgeoisie noire, modèle qui a été par la suite affiné mais non invalidé [7]. Une synthèse utile des recherches sur les dérivations américaines ou caribéennes de ces groupes mulâtres a été récemment rédigée par P. Ndiaye [8]. Le constat dressé par ces auteurs est celui d’une forte perturbation identitaire des élites censées représenter le peuple. Car cette « ambivalence de l’élite » [9], prise entre l’adhésion au système (blanchitude, imitation des manières de faire des maîtres, légitimation du système colonial, dépendance politique) et son rejet (indépendance politique, marronnage, défense de l’identité créole populaire, haine du Métropolitain, plus forte semble t’il aujourd’hui que celle du Béké [10]), semble d’autant plus présente que les territoires étudiés demeurent sous l’emprise souveraine de l’ancien colon [11].
Pour rendre raison de cette ambivalence et, à terme, proposer une étiologie de la neutralisation mémorielle des violences passées, le concept de zone grise, inventée par Primo Lévi (notamment dans Si c’est un homme et Les naufragés et les rescapés) pour les camps, s’avère particulièrement féconde. Monde concentrationnaire, les bourreaux de la plantation esclavagiste ont rigoureusement implémenté les mêmes recettes que les nazis dans les camps. Par le haut, les gestionnaires s’attachent un corps de serviteurs qui exercent des fonctions de contrôle (hiérarchie professionnelle dans l’exploitation agricole, délateurs) et de domesticité (métissage avec le sang du maître qui les blanchit, aspiration forcenée à ne pas retomber « nègre de jardin » c’est-à-dire esclave agricole). Par le bas, les Kapos, détenus reconvertis en gardes auxiliaires, tentent continuellement de se concilier les SS afin de ne pas quitter leur poste, ce qui signifie mourir le plus souvent, et pour cela, ils doivent montrer incessamment qu’ils sont des bourreaux compétents. Autrement dit, ils veillent à ne plus apparaître comme des anciennes victimes susceptibles de se rebeller. Ainsi, loin de s’ancrer dans l’unique compréhension des camps, ce modèle de la zone grise aide aussi à appréhender l’univers plantationnaire et de manière générale, la gestion des dominés en situation totalitaire où un tout petit nombre de bourreaux travaille à mettre en place un mode de domination qui puisse contenir la masse des « esclaves ». Ce déterminant structural à la création d’un corps tiers entre les maîtres et les humains réduits à l’état d’objets est fondamental pour le maintien d’un ordre reposant sur une contrainte externe dotée d’une quasi absence de légitimité. La zone grise, dotée de statuts particuliers et apprivoisée par toutes sortes de privilèges et de gratifications, va aider à contenir la masse soumise par ce contrôle incessant ; masse pour qui la disposition au soulèvement est permanente et d’ailleurs attestée par les dizaines de révoltes qui émailleront l’histoire coloniale en Caraïbe. Les dominés, dans un mélange d’adhésion/résignation et de dissidence plus ou moins marquée (du marronnage jusqu’à la rébellion armée), savent qu’ils peuvent tuer le maître. Cette zone grise n’a jusqu’à présent été que peu travaillée, encore moins les groupes économiques ou politiques qui en sont issues. Or, après l’abolition de l’esclavage, cette sorte de caste ethno-raciale s’est maintenue sous des formats variés et avec une complexité à rapporter au processus de différenciation sociale dans un espace économique et politique plus ouvert. Depuis les « Libres de couleurs » du temps de l’esclavage qui mimaient les Békés jusque dans le carnaval, jusqu’aux « Mulâtres » -désignation du groupe créole noir dominant qui, historiquement, demeure une expression usuelle du XVIIIe siècle à 1940- lesquels, pour l’essentiel, se projettent jusqu’à aujourd’hui dans le spectre politique qui court de l’assimilationnisme UMP jusqu’aux autonomistes (aussi républicains que les premiers en fait, d’où le clivage radical entre le Césaire autonomiste et F. Fanon sur cette question politique de la souverainteté), une ligne de continuité apparaît. Ce clivage social entre les dominants et les dominés noirs s’adosse à des positions sociales et des représentations socio-raciales sans lesquelles il n’est pas possible de comprendre l’intensité avec laquelle la construction d’une mémoire aseptisée des « Temps anciens » opère à la Martinique. C’est dans la mesure où le passé est de part traversé par des liens sociaux forts entre les Blancs (colons ou Békés) et les « Mulâtres » que, dans le contexte de l’affirmation politique de l’identité du peuple « martiniquais » depuis une quarantaine d’années, il est quasiment impossible de présenter une identité mémorielle qui se superpose à l’identité historique. Autrement dit, pour une classe politique largement issue de ces groupes dominants noirs proches historiquement des colons mais qui, par ailleurs, prétend représenter le peuple noir, une double obligation définit le format des musées : celle consistant à parler du passé au nom de l’affirmation de la nation martiniquaise (d’où la création d’un espace muséal qui se développe fortement depuis une vingtaine d’années), et celle visant à l’euphémiser en vue de masquer le rôle structural d’une élite ne pouvant affirmer les allégeances passées et présentes.
Aimé Césaire prolonge la thématique humaniste réformatrice des mulâtres les plus engagés tout en dissolvant toute référence possible au sens de la segmentation socio-raciale qui prévaut. La négritude ancre la thématique identitaire dans le champ politique, imposant un cadrage nouveau qui ressemble à une chape idéologique bloquant le réfléchissement de la tripartition sociale sur la scène politique. D’un côté il est « papa Césaire », le bienfaiteur du peuple noir offrant des postes dans sa mairie clientélisée ; de l’autre il se contente de proposer « l’autonomie politique » bien faite pour consacrer le pouvoir local des élites ternaires. D’un côté il défendra fortement toute entreprise culturelle (le CERMAC) visant à rétablir la dignité du Nègre colonisé, contre les agences culturelles de l’Etat français ; de l’autre il recevra tous les ministres et plénipotentionnaires métropolitains sans jamais s’opposer frontalement à eux, allant même, en 1981, jusqu’à imposer un moratoire en faveur de François Mitterrand. Les politiques sociales et culturelles initiées durant cette décennie sont qualifiées par l’anthropologue britannique D. Murray de « renforcement des fondations centralistes du pouvoir de l’Etat français » [12]. Dénonciation créolisée d’un côté, soumission symbolique et pratique, de l’autre, à l’ordre républicain.
Penser la zone grise coloniale, ce n’est pas donc adopter une vision verticale et univoque de la domination. C’est tout au contraire insister sur l’ambivalence de ce corps intermédiaire pris entre « les frères de misère » et les groupes de référence, le Blanc créole et les Métropolitains. Dérivé de la zone grise plantationnaire où l’ancien collaborateur issu de l’esclavage devient un être dédoublé, le schème ternaire opère dans l’ambivalence. Il peut se définir comme « le mal-être mulâtre. Il tient des deux univers. Cette ambiguïté fondamentale, cette ambivalence constitutive (font que) le mulâtre antillais serait destiné à jalouser et haïr son géniteur blanc (son père) et mépriser ou renier sa génitrice noire (sa mère) » [13]. Les siècles de segmentation entre Noirs affranchis et/ou gagnés au monde des Blancs et Noirs dominés maintenus dans les fers jusqu’à l’abolition de l’esclavage ont structuré une ambivalence culturelle systématique, ce que J. Daniel appelle « le dilemne des allégeances multiples » [14]. Qu’on la retrouve dans la structure de la polarisation partisane autour de la question du « statut », des « institutions » et de la « départementalisation » [15], dans une littérature créolisante écrite en français et qui reconnaît les « prix » littéraires français dans la dérive essentialiste d’une culture créole, dans les choix migratoires invalidés par ceux qui, comme dans le personnel indépendantiste, envoient tout de même leurs enfants dans les écoles supérieures métropolitaines ou développent leurs politiques financières en se tournant vers les aides européennes ; qu’on la retrouve encore dans les actions multiples qui entérinent le blanchiment de la « race » ou consacrent les divisions socio-raciales des « Martiniquais » entre eux [16] tout en s’entourant d’un autre discours célébrant la négritude ou les savoir-faire des anciens, elle est consubstantielle à une mémoire collective de part en part traversée par le schème ternaire issu de la domination esclavagiste et ses effets endogènes contradictoires.
Pour montrer clairement l’espace symbolique entre le monde des « Mulâtres » et le monde des « Nègres », héritage de la structure plantationnaire, on se propose de donner à voir deux visions antagoniques du passé esclavagiste. Pour ce faire, nous avons constitué un corpus de photographies de deux sites muséographiques exemplaires de l’esclavage, tout en élargissant le propos sur la base d’un corpus d’une dizaine de musées locaux. Le premier exprime la dénégation des conditions de vie extrêmes sur l’habitation. Financés par une fraction des élus politiques martiniquais, notamment le courant majoritaire des « autonomistes » du Conseil général, mais aussi par le Conseil régional dit « indépendantiste » (notamment l’éco-musée de l’Anse figuier), ces musées s’alignent sur le même cadrage politique d’acteurs qui « persévèrent à voiler la perspective historique » et à renforcer « la dépendance vis-à-vis de la puissance coloniale » [17]. On prendra comme base d’appui empirique majeure l’exposition temporaire de 2006 sur l’ancienne plantation du « père Labat » (tout en inventoriant d’autres sites). Le second, musée permanent, exprime un réalisme documentaire adoptant finalement le point de vue des historiens. Il a été inventé par un « nègre en bas feuille », un dominé djobeur de la campagne, ouvrier/paysan sans qualification autre que son savoir faire hérité des Anciens : la Savane des esclaves, musée permanent mis sur pied par Gilbert Larose.
L’exposition temporaire a été réalisée par le Conseil général aidé par une chercheuse spécialiste de l’esclavage : Myriam Cottias. Elle est située sur une ancienne habitation hébergeant désormais une association « culturelle » subventionnée par le département. Assumée par une « association de gestion chargée d’animer, de développer des activités culturelles et de mettre en valeur le patrimoine archéologique du domaine », cette manifestation est située dans une salle rénovée de l’habitation du Père Labat à propos duquel Christine Chivallon a détaillé ses faits de cruauté, largement déniés en Caraïbe. L’exposition est composée exclusivement de panneaux agglomérés sur lesquels sont apposées des fiches cartonnées mobiles de deux mètres de haut sur une soixantaine de large. Ce type de répertoire, scolaire, a fait l’objet d’exposition pendant plusieurs années.
Le musée populaire quant à lui s’appelle « La savane des esclaves ». Il a été fabriqué à proximité des Trois-Ilets, sur le bord d’un petit sentier, sur un terrain privé, à côté d’une zone touristique. C’est un homme seul, chômeur et/ou djobeur ouvrier et paysan, aidé par sa femme, sans aucun soutien financier de collectivités publiques pourtant sollicitées, qui est parvenu à monter ce lieu de mémoire d’un réalisme intentionnel. Son expérience illustre une certaine représentation de ce qu’est son illégitimité technique et politique.
« Au départ les gens ils m’ont pris pour un fou direct parce que moi je sors vraiment de la campagne, parce que ici quelqu’un qui sort vraiment de la campagne hein….Lorsque que tu vas monter un projet, tu vas aller pour te faire aider par l’Etat lorsque tu vas monter dans les bureaux on va te demander un cv, mais moi j’ai aucun cv, je suis sorti en classe en CPPN (équivalent de la SEGPA aujourd’hui), alors pratiquement toutes les portes ont été fermées pour moi, j’ai jamais eu un tableau d’honneur alors voire un diplôme, une fois tu donnes un cv comme moi les portes sont fermées et les gens pendant que je faisais le village, les gens au lieu de m’aider parce que les gens croient comme j’ai pas du tout de diplômes, comme quoi les idées qu’on a elles sont pas bonnes du tout.
Est-ce que maintenant y a des élus qui viennent pour discuter avec vous ?
J’ai déjà rencontré le maire dans une réunion, il va parler 10, 15 mn avec moi mais ici même, j’ai jamais vu un élu dire M. Larose vous faites un bon travail ici, les gens ils vont parler de mon truc mais pas avec moi, ils vont féliciter mais jamais devant moi, si tu viens avec eux tu vas leur parler de moi ils vont te dire oui ce qu’il fait c’est super, on le suit, on le voit, mais sans jamais venir me voir, sans jamais me dire si tu as besoin d’un pal (aide sous forme de coup de main collectif), y a que des bâtons dans les roues. Le truc qui m’a déjà touché le plus c’est de faire tout ça de lettres tout ça d’invitations, puisque tu dis les gens vont venir tellement tu vois des gens de Métropole, des gens qui travaillent dans des plus gros bureaux que les gens d’ici te disent que c’est super, qui arrivent à te féliciter à te faire signer des autographes, mais ici, j’ai jamais vu un élu du conseil général, régional, ici, pour me dire c’est bien M. Larose, pour me dire on va essayer de vous suivre, et les gens qui font la visite me disent vous faites bien la promotion de la Martinique.
Et comment vous interprétez cette indifférence des élus ?
Ils ont confondu l’intelligence et l‘instruction, il faut qu’ils enlèvent pas dans leur tête on peut sortir de la campagne ça veut pas dire qu’on est un con, l’intelligence c’est un gros atout, peut être que je suis dans la campagne, et que j’ai pas de diplômes et ça veut pas dire que mes idées sont pas bons, moi ça fait 5 ans que je fais ça, je suis la seule personne à avoir trois étoiles sur le guide du routard.
Il y a deux ans vous me disiez qu’ à l’inauguration les gens n’étaient pas venus…Le conseil général, le conseil régional, tout ça…
Oui ils n’étaient pas venus, bon après t’es dégoûté des fois mais après ça, après Géo magazine, après Thalassa, après ça, ça a fait le grand boom, j’ai une école d’Atlanta qui va venir, l’école de Costa Rica, je viens de recevoir un lycée de métropole, et j’ai toutes les écoles de Martinique, les centres aérés, les comités d’entreprises, les personnes âgées. Là les gens n’ont plus dit que c’était un truc à la con, ça les a vraiment intéressés et là comme j’ai commencé à recevoir beaucoup de public, après c’est comme si ça révèle des trucs en moi parce que les gens avec les encouragements, avec le travail que j’ai fait, que j’ai porté, le fait de le sortir sur Thalassa et Géo magazine, donc là les antillais ils ont vu que c’est quelque chose de valeur qu’ils ont là maintenant là, et après les gens viennent, les écoles. Si on va taper sur wikipédia on va trouver une page sur moi mes statuts et tout. Avant c’était un endroit où venaient les touristes, mais maintenant les antillais viennent, même le gars du Sri Lanka, quand il est arrivé, il a un vu un morceau de son endroit, j’ai une copine à moi qui est philippine, elle adore venir ici parce que ça lui rappelle son pays, parce que partout d’où tu viens tu vas toujours trouver quelque chose de chez toi puisque nous ici, on est une nation universelle ».
Un homme, seul, sans l’aide d’aucune collectivité locale, va construire un musée local dont la configuration se situe à l’opposé des musées folkloristes locaux. Son musée ressemble à un village où les thèmes sont dispersés sur l’habitat, sur les plantes et sur des supports (photos, reproductions en pate à modeler de scènes de vie, documents juridiques de base, notamment du code noir). Cet ensemble de bâtisses est construit à partir des matériaux des Anciens et s’oppose aux bâtiments modernes en fibrociment avec des pièces séparées. Mixte de village africain (dans un morne martiniquais) et de cases en feuilles de banane et de lianes tressées comme au temps des habitations, le musée se veut aussi être un lieu de négritude, avec l’ajout de savoirs manuels des anciens (notamment la « halle » qui accueille les touristes à l’ombre d’un bâtiment traditionnel), de sentiers botaniques teintés de magico-religieux, et d’un restaurant (qui n’existe plus) créole où l’on mangeait les légumes pays. Son succès est d’autant plus méritant que tous les pouvoirs publics l’ont ignoré, tant lors de ses demandes financières que lors de l’inauguration et même encore aujourd’hui. Faut-il parler de mépris de caste, de mépris d’une bourgeoisie technocrate mulâtre face à un neg en ba feuil, un gars de la campagne, à cheval entre le métier de la terre et les djobs actuels ?
La comparaison va faire surgir ce mouvement croisé entre écrasement du sens (dénégation) des « musées dont l’objectif est clairement affiché de participer au recouvrement de la mémoire du passé esclavagiste et (des) lieux historiques de l’expérience esclavagiste – les plantations – dont l’intention reste liée à une mise en scène harmonieuse des héritages coloniaux » d’une part et, d’autre part, le « désenclavement de la mémoire, extirpation des lieux où on l’avait réduite au silence » [18].
La quinzaine de panneaux de l’exposition officielle du Conseil général, à Sainte-Marie, sont ramassés, d’entrée de jeu, dans un titre très évocateur, cadrant le monde plantationnaire comme un espace d’existence presque ordinaire et pour tout dire vivable : « Quatre siècles d’histoire, lieu de vie, lieu de mémoire ». J’ai rencontré les responsables de cette exposition et je leur ai demandé d’où leur venait le choix de l’expression « lieu de vie », vu que, a minima, « lieu de survie » aurait été plus approprié : « Si, l’habitation a bien été un lieu de vie puisque la population d’aujourd’hui en est issue. Ce n’est pas un camp de concentration (c’est la catégorie que j’avais utilisée dans ma question) puisque toute la société d’aujourd’hui en est sortie. C’est bien la preuve que les gens demeuraient en vie, qu’ils n’étaient pas exterminés. Et il y aurait même un certain mépris à croire que les esclaves n’essayaient pas de trouver les moyens aussi de se distraire et même de se cultiver ». Nous laisserons le lecteur apprécier ce commentaire oral obtenu lors d’un repas entourant un colloque (2007) sur le colonialisme et se déroulant au Prêcheur, bourg où s’achève la marche du 22 mai lors de la commémoration de l’esclavage [19]. Cette expression « lieu de vie » n’est sans doute pas formulée au hasard. On la retrouve sur les Habitations privées (Clément, Lamauny) dotées d’une intention muséographique explicite et où, selon le mot de C. Chivallon, règne « l’invisibilisation » de l’esclavage [20].
Une autre affiche (« Le Fonds Saint-Jacques : les débuts de l’habitation sucrière ») évoque la vie paisible sur la plantation qui offre un tableau général permettant de marginaliser ultérieurement les discours faisant mention de violences : « Jusqu’à l’abolition de l’esclavage en 1848, l’habitation est un lieu de travail, de vie et de culture ». On appréciera particulièrement l’absence totale de toute référence au terme « esclavage » pour qualifier les débuts du colonialisme. Par ailleurs, les auteurs se piquent d’érudition et détaillent la situation de quelques centaines de Juifs marranes débarqués du Brésil, thème sans doute bien plus central que l’installation forcée de plusieurs dizaines de milliers de Noirs venus d’Afrique.

Un autre panneau s’intitule « L’espace de vie ». Le père Labat, connu par les historiens pour avoir laissé des écrits nombreux (ses mémoires), avoir manifesté un zèle missionnaire très prononcé contre les « croyances païennes », est uniquement promu au rang d’ « homme d’exception », vanté pour ses innovations techniques destinées à améliorer le rendement, reconverti en « administrateur du domaine » doté de « qualités de concepteur…Il fit de Fonds Saint-Jacques un ensemble très harmonieux ».
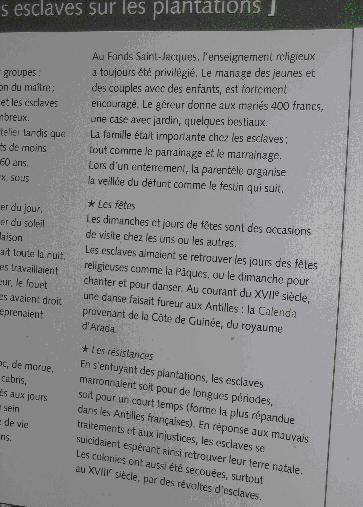
Alors qu’Aimé Césaire a proposé une comparaison entre le génocide des Noirs et celui des Juifs, cette exposition patronnée par les édilités locales déverse une idéologie radicalement opposée de la plantation comme univers non dominé par la violence du travail forcé et la marchandisation de l’humain. A l’opposé de la mort sociale, le premier cadrage vise à rapprocher ce monde totalitaire d’un univers presque familier, avec des êtres ordinaires qui travaillent, qui vivent et même se cultivent. Non seulement le Père Labat est vu sous l’angle de ses performances d’innovateur économique, mais il n’est vu que sous cet angle. Le travail de dénégation, sur le personnage, est exemplaire. On peut remarquer une affiche vantant le Père Labat, en insistant sur ses qualités de gestionnaire. L’exposition que j’ai visitée se tenait en 2006. La responsable du centre affirme que, sur cette plantation « dirigée par un Catholique », « les esclaves vivaient mieux sur cette plantation. Ils mangeaient à leur faim et n’étaient pas frappés ». L’anthropologue C. Chivallon fustige les organisateurs de cette exposition qu’elle a pour sa part visité en 2002 et qui littéralement célèbrent le Père Labat à qui est voué un « quasi-culte ». Elle s’indigne, non sans ironie : « N’y aurait-il qu’à la Martinique que l’on n’aurait pas pris conscience de la perversité et de la cruauté du personnage ? ». Ce qui n’est pas un cas unique puisqu’elle remarque que, lors d’un colloque sur Haïti à Fort de France en 2004, elle avait noté qu’un autre gestionnaire de plantation, idéologue de la race de surcroit, et ardent « théoricien de l’esclavage » dans le club Massiac en 1789, Moreau de Saint Méry, avait été encensé par les Martiniquais cultivés. On ne peut rêver meilleur indicateur de la pérennisation du sens commun des Mulâtres jusqu’à aujourd’hui.
Du fait de cette érosion du sens, l’ambition de l’exposition peut être de forcer la mémoire « collective ». L’affiche étale une perspective globalisante et consensuelle du « patrimoine historique » : « Le domaine de Fond Saint-Jacques, ancienne habitation, est cher au cœur des Martiniquais parce qu’il a été un carrefour (sic) de leur histoire ». Pour parvenir à cette fin, les relations entre les maîtres et les esclaves sont singulièrement « rabotées jusqu’au silence », selon la formule de P. Bourdieu. Il en est de même de la logique de participation des victimes à l’ordre des bourreaux. La description de la plantation élime toute référence aux divisions internes entre Noirs organisées de « main de maître » par le planteur en infériorité numérique : « Les esclaves étaient divisés en trois groupes : les domestiques attachés à la maison du maître, les ouvriers - ou nègres à talents et les esclaves agricole dits de jardin, les plus nombreux ». La position de zone grise est externalisée et évoquée sans spécification socioraciale : « Pour la coupe de la canne, les esclaves travaillaient en ligne, surveillés (sic) par un commandeur, le fouet à la main ». Le « commandeur », proche du kapo des camps, est la seule figure sociale ternaire à être évoquée. Le même ton pourrait être utilisé pour décrire un atelier d’ouvriers « surveillés » par un chef d’équipe ou un contremaître, si ce n’était l’évocation, passive, du fouet. La violence des brutalités relationnelles est aussi externalisée dans le constat froid des effets impersonnels de l’esclavage : « La mortalité était très forte ». A cause de la chaleur ? Bien sûr, les mauvais traitements ne sont nulle part dessinés, à l’opposé du travail muséal des Trois Ilets qui en fera un axe central de la démonstration relative à la « vie » plantationnaire.
Finalement, se dégage une vision d’ensemble panachée, nuancée et de ce fait subtilement construite pour euphémiser le sens de l’esclavage plantationnaire. Les conditions de vie étaient certes dures, mais tout le propos élime la question du régime punitif omniprésent tout en optant pour une approche contraire aux acquis historiographiques en matière de refus du mariage par les planteurs et de résistance d’une forte proportion des esclaves femmes à la procréation : « L’enseignement religieux a toujours été privilégié. Le mariage des jeunes et des couples avec enfants, est fortement encouragé. Le géreur donne aux mariés 400 francs, une case avec jardin, quelques bestiaux. La famille était importante chez les esclaves ». A la fin de l’affiche, en dernière position, apparaît alors la rubrique « résistances » qui, dans un tel contexte, deviennent presque difficile à comprendre. On y découvre, sans aucune explication étiologique, que « en s’enfuyant, les esclaves marronnaient soit pour de longues périodes, soit pour un temps court (forme la plus répandue dans les Antilles françaises) ». Alors qu’aucune analyse de la chasse aux marrons est proposée pour rendre compte de ce temps de « vie » « court » sur une île exiguë, les rédacteurs n’en disent pas plus sur les punitions qui attendent les survivants (ceux qui n’ont pas été tués) ramenés sur la plantation. Pour rendre justice au document, citons la seule phrase faisant état du régime concentrationnaire, là encore de manière impersonnelle et sans détails : « En réponse aux mauvais traitements et aux injustices (sic), les esclaves se suicidaient espérant retrouver leur terre natale ». Bien sûr, rien n’est dit sur la culture esclavagiste, la lutte anti-abolitionniste et le racisme des Békés comme des curés ou des Mulâtres jusqu’à la moitié du XIXe siècle, les concepteurs se contentant de renvoyer les « révoltes d’esclaves » dans une période ancienne, « surtout au XVIIIe siècle ». Une autre affiche expose un document d’époque, une proposition de récompense pour rattraper une fugitive. Aucune légende ne vient expliciter les conditions sociales de la chasse, de la capture et des punitions.
Enserrés dans un cadre général où prédomine l’évocation économique de la production de sucre et le « modèle » du Père Labat repris dans les autres habitations, les conditions de vie des esclaves sont rapportées à un « fonctionnement » qui a généré des bienfaits actuels, comme s’il était possible et banal, en Martinique, d’afficher la production et le développement économiques esclavagistes indépendamment du mode de production ; là où évoquer les performances économiques des camps de concentration serait perçu comme une apologie « révisionniste » du régime nazi, lui aussi traversé à partir de 1943 par une problématique de l’exploitation économique des objets humains, ici, l’habitation est réduite, sur plusieurs panneaux, à une entreprise économique prospère : Sous le titre « Le Fonds Saint-Jacques : Les débuts de l’habitation sucrerie aux Antilles », il est précisé : « L’industrie sucrière antillaise se développe très rapidement dans les années 1670 et dès 1717 les livraisons de sucre dépassent même les besoins de la métropole ! » Entreprise prospère dont la seule préoccupation serait l’amélioration économique du rendement, positionnant le site en « modèle » de l’exploitation plantationnaire : « C’est à Fonds Saint-Jacques que le Père Labat élabore dès la fin du XVIIe siècle, un modèle d’habitation sucrerie qui a été repris par la suite dans l’ensemble des Antilles. Sur ce domaine qui couvrait 230 hectares, il a rationalisé la production de sucre » [21]. Du fait de ces performances, dont le seul objectif est de sustenter les Européens de la Métropole ainsi complices objectifs du fait qu’ils sont in fine les consommateurs effrénés de sucre et de ce fait responsables de cette production, l’Habitation est définie comme une entreprise économique salutaire pour le bien de tous. Un panneau généraliste « De la traite aux abolitions », prend bien soin d’externaliser la structure esclavagiste en rappelant politiquement que « Louis XIII » a donné « l’autorisation » et qu’économiquement « par ce système d’échange de marchandises et d’humains, l’Europe s’enrichit ».
Dès lors, il devient pertinent de s’en tenir aux chiffres abstraits de la performance industrielle, les conditions d’extraction de la richesse devenant plus que secondaires. La canne à sucre a laissé son empreinte dans le paysage samaritain. En 1691, il y a déjà 21 sucreries. En 1732, il y en a 30. Au cours du XVIIIe siècle, la culture s’est diversifiée. Cependant, la production de sucre est demeurée importante jusqu’à la crise sucrière des années 1900. Aujourd’hui, la culture de la banane prédomine. Ce bottage en touche est structuralement inscrit dans l’ensemble de la muséographie néocoloniale martiniquaise. C’est un procédé d’ensemble d’abolition du sens ici détaillé par C. Chivallon à propos du musée de la canne (on y reviendra) : « La Maison de la canne, comme les quatre autres musées, opère par immersion dans un « autre chose », ici le patrimoine technique, qui finit par supplanter le message relatif à l’institution esclavagiste. La monumentalité des pièces présentées – charrue, moulin à bêtes, chaudière, générateur tubulaire, colonnes à distiller, rolles des moulins de broyage, balance à fûts… – en vient à envahir l’espace d’énonciation muséographique et faire du musée un lieu consacré à l’industrie de la canne plutôt qu’à l’institution sociale qui en a gouverné l’invention et l’usage. Les mêmes commentaires peuvent être faits pour les autres musées. On y relève un glissement identique vers un autre domaine que celui fondateur qu’est le système esclavagiste » [22].
A cette représentation économiciste de la vie plantationnaire -sans groupes sociaux donc sans Békés- s’adjoint un paysage pur de la dénégation du régime esclavagiste. D’une part, on l’a vu, parce que l’appartenance religieuse de l’habitation l’aurait rendue vivable. D’autre part, parce que les violences sont non seulement résiduelles (un commandeur avec le fouet à la main, une phrase isolée sur la mortalité forte, une autre sur les « mauvais traitements et les injustices ») mais surtout neutralisées par les moments « culturels » qui témoignent de l’humanité du régime : « Il a organisé l’espace de vie en construisant les cases des esclaves à proximité du maître pour faciliter leur surveillance (rien sur les viols alors que ce sera un thème clé dans le musée de Gilbert Larose). Dans la chapelle, dont la construction remonte à 1660, se tenaient des fêtes religieuses tandis que, dans la cour des esclaves, les fêtes étaient menées au son du tambour ». Sur le panneau « La vie des esclaves sur la plantation », le sous-thème « Les fêtes » vient avant le suivant, « Les résistances ». Dans cette rubrique « fête », jamais rapportée à sa signification dans un tel espace, les organisateurs laissent libre cours à leur imaginaire consensualiste : « Les dimanches et jours de fête sont des occasions de visite chez les uns et les autres. Les esclaves aimaient se retrouver les jours de fêtes religieuses comme la Pâques, ou le dimanche pour chanter et danser. Au courant du XVIIe siècle, une danse faisait fureur (sic) aux Antilles : la calenda provenant de la Côte de Guinée, du Royaume d’Arada ». Dans un tel cadre de « vie » (et non de survie), de vie culturelle, religieuse et festive, on a dès lors du mal à saisir le sens de cette phrase, dans la rubrique « Les résistances » : « En réponse aux mauvais traitements et aux injustices, les esclaves se suicidaient…Les colonies ont aussi été secouées, surtout au XVIIIe siècle, par des révoltes d’esclaves ». L’absence de cohérence tenant à une posture visant l’euphémisation sans omettre l’évocation allusive mais nécessaire de la rébellion, bref la stratégie de la dénégation plutôt que celle du déni, explique cette juxtaposition de registres parfaitement contradictoires. Il est absolument impossible de constater l’existence de soulèvements armés (d’ailleurs rien n’est dit sur le meurtre de planteurs), de suicides, d’une mortalité forte (sans parler des infanticides de mères violées ne voulant pas donner un esclave au maître) qui émaillent la vie « ordinaire » d’un ordre concentrationnaire sans s’interroger simultanément sur les espaces concédés ou tolérés par le maître. Parler de « vie » ou de « fête » ou de « culture », en ce sens, c’est forcer un cadrage qui ne tient pas dans un univers esclavagiste où la marchandise humaine n’a que très peu de marges de manœuvre. Les révoltes n’ont jamais débouché sur des droits ou des libertés sociales. De plus l’historiographie converge sur la répression : la chasse aux fugitifs ou aux dissidents était souvent associée à un verdict de condamnation à mort, avec des tortures sophistiquées, destinées à montrer à tous les autres le coût d’une évasion.
Tout se passe comme si cette exposition avait été montée par les Békés eux-mêmes -tout en demeurant invisible comme un Dieu dont il faut taire le nom par peur des représailles- les panneaux exposés ressemblant en fait à une hagiographie à peine nuancée de l’habitation. Le choix de se focaliser sur la plantation atypique d’un religieux - versus les plantations de Békés qui sont les plus nombreuses - ajoute encore à ce travail sophistiqué d’invisibilisation et d’euphémisation des structures socio-raciales et des réalités esclavagistes. La dénégation des relations sociales et la concentration des propos sur des thèmes qui font justement la fierté symbolique de la caste esclavagiste (le sucre, le rhum, l’invention de techniques) aboutissent à une sorte de mythologie d’un groupe social hissé au pinacle de la compétence sociale. « La production de rhum n’a cependant pas été abandonnée puisque le rhum Saint James perpétue une vocation centenaire à Sainte-Marie ». Sur le panneau « Sainte-Marie, autour de la canne », la conclusion de la démonstration est posée : « Plusieurs fois primé au salon de l’agriculture, il obtint en 2001, la médaille d’or pour son rhum vieux ». Mêmes affiches à Lamauny, Clément ou Trois-Rivières. Marketing économique d’une exposition intéressée par la présence des touristes ou exposition sur une plantation esclavagiste ? L’angle d’attaque de l’exposition prend alors tout son sens : « Quatre siècles d’histoire ». En adoptant une périodisation qui ne correspond à rien d’autre qu’à la durée d’existence des Békés à la Martinique, toutes les périodes classiques, esclavagiste, coloniale puis départementale (pour reprendre ici les catégories officielles) deviennent des sous-catégories de l’histoire de la grandeur d’un groupe social, ici grands producteurs de sucre, là fabricants émérites de Rhum.
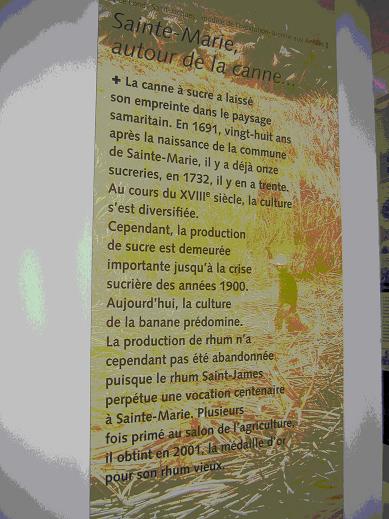
L’abolition des relations humaines au profit d’un discours économiste impersonnel et continu traversant les âges signe autant le refus de penser les fondements totalitaires d’une économie qu’elle voile, qu’elle ne dévoile simultanément le maintien d’une vision néo-coloniale bien faite pour glorifier des dominants toujours présents sur leur habitation, bien faite aussi pour apaiser les soucis des descendants de mulâtres installés majoritairement au Conseil général [23]. Des chercheurs américains ont pu montrer que cette manière de juxtaposer le monde des planteurs et leurs réalisations d’une part et le monde euphémisé des esclaves correspond à un type fréquent dans un ensemble de 5 cadrages majeurs d’oblitération du réel où la consécration des Blancs va de pair avec une vision racialisée explicite [24].
A la lecture de ce chef d’œuvre d’édulcoration, comment interpréter le rôle « scientifique » de M. Cottias, historienne reconnue de l’esclavage et qui d’ailleurs, organise ces dernières années des colloques internationaux sur ce thème, sur fonds européens ? Faut-il y voir une chercheuse manipulée ? Ou bien un effet de la partition entre commande politique et recherche fondamentale [25] ? Comment alors est définie la « commande politique », entre normes explicites, marchandages et auto-censure [26] ? En tout état de cause, cette chercheuse a participé à une aventure idéologique qui n’est pas loin de ressembler au profil politique des mulâtres dans la première moitié du XXe siècle tels qu’ils sont dépeints polémiquement dans Tropiques, Légitime défense ou l’œuvre de Fanon.
Le travail de Gilbert Larose se présente comme l’exact opposé de cette exposition. Au lieu d’adopter le point de vue des Blancs et de leur économie impersonnelle victorieuse, économie dans laquelle les Mulâtres vont prendre aisément leur place, l’organisateur choisit d’insister sur ce qui fait la substance de l’esclavage et que C. Chivallon regrette de ne pas retrouver dans les musées qu’elle a étudié : la dimension phénoménologique de la souffrance extrême sur la plantation et, aussi, cette mémoire souterraine des nègres qui prend place dans l’ensemble des « textes cachés » qu’agitent tous les dominés extrêmes. L’existence de ce musée est primordiale, non pour attester en direct de l’existence de la zone grise ou de la dimension ternaire de la plantation, mais pour manifester le cadrage spécifique des autres musées et ainsi marquer distinctement l’espace muséal entre une « construction mulâtre » et une « construction nègre ». C’est dans la composition du musée, l’accent mis sur la souffrance des nègres esclaves, que la vérité structurale de la tripartition émerge ; que la vérité structurale de la tripartition émerge dans la mise en perspective de la mémoire muséale mulâtre.
Le musée de Gilbert Larose vient contredire bien des discours savants ou littéraires sur l’impossibilité de donner une forme à la mémoire « nègre ». Plutôt que de postuler une sorte de barrière symbolique a priori entre la « culture des opprimés » et leur mise en forme muséale, il faudrait plutôt se poser la question des conditions pratiques qui interdisent le plus souvent aux dominés extrêmes de pouvoir parler. L’incorporation de l’idéologie dominante, la remise de soi (fides implicita), la peur des représailles (si prégnante à la Martinique dont la petitesse rend possible des entreprises de rétorsion à l’encontre de la cible ou de ses collatéraux [27]), le système des interdépendances (notamment les djobeurs qui travaillent au « noir » pour les classes supérieures ou ceux, un tiers, qui vivotent à temps partiel dans les postes subalternes de la fonction publique) et la faiblesse des moyens matériels (on l’a vu pour Gilbert Larose qui n’a obtenu aucune subvention de la part des « élus du peuple ») contribuent sans doute plus au silence des « Nègres » que l’effet « culturel » de leur mode de fonctionnement. D’ailleurs, que ce soient des intellectuels dominants à capital culturel comme E. Glissant, aussi illisible pour le peuple que P. Bourdieu, qui signalent cette aporie « sémiotique » ou « communicationnelle » ne manque pas de saveur. C’est là un point de divergence avec les travaux par ailleurs remarquables de C. Chivallon. La substantialisation d’une soi-disant forme d’expression orale, mythique, alambiquée et anti-occidentale issue de l’esclavage et du marronnage, est tout simplement invalidée par le montage du Musée de l’esclavage, initiative d’une personne sans emploi « officiel », originaire de la campagne et prolétaire djobeur inspiré par les Anciens.
Alors que, comme le remarque justement la spécialiste de la Martinique, la restitution de l’esclavage dans les musées martiniquais ressemble au montage glacé d’un « épisode » historique parmi d’autres, une « époque » où ça se faisait en ce temps-là, sans rentrer dans les détails, sans se soucier de travailler le plus possible le sens de cette condition du point de vue de la victime, sans montrer l’horreur des faits au quotidien, La Savane des esclaves offre le théâtre d’une composition singulière mettant en avant la vie concrète des esclaves.
Au premier plan de leur musée, situé dans une case ressemblant à celle des Anciens, G. Larose et sa femme ont inventé un théâtre de marionnettes en pâte à modeler qui traduisent les écrits des historiens. Le viol, la torture, les punitions, sont mis en représentation, avec des textes qui entourent sur les murs en bois le cube de verre de 2 mètres sur 1 à l’intérieur duquel les figurines sont agencées.
Une des feuilles apposées sur le mur de la cabane résume les articles du code noir qui légitiment une partie des mises en scène :
![]() Article 34 : « Et quant aux excès et voies de fait qui seront commis par les esclaves contre les personnes libres, voulons qu’ils soient sévèrement punis, même de mort »
Article 34 : « Et quant aux excès et voies de fait qui seront commis par les esclaves contre les personnes libres, voulons qu’ils soient sévèrement punis, même de mort »
![]() Article 38 : « L’esclave fugitif qui aura été en fuite pendant un mois, aura les oreilles coupées et sera marqués d’une fleur de lys sur une épaule ; s’il récidive, il aura le jarret coupé et il sera marqué d’une fleur de lys sur l’autre épaule, et la troisième fois, il sera puni de mort »
Article 38 : « L’esclave fugitif qui aura été en fuite pendant un mois, aura les oreilles coupées et sera marqués d’une fleur de lys sur une épaule ; s’il récidive, il aura le jarret coupé et il sera marqué d’une fleur de lys sur l’autre épaule, et la troisième fois, il sera puni de mort »
![]() Article 42 : « Pourront seulement les maîtres, lorsqu’ils croiront que leurs esclaves l’auront mérité, les faire enchaîner et les battre de verges ou cordes ».
Article 42 : « Pourront seulement les maîtres, lorsqu’ils croiront que leurs esclaves l’auront mérité, les faire enchaîner et les battre de verges ou cordes ».
Ces textes, rendant compte de violences physiques de même facture que ceux dont Foucault a détaillé l’horreur dans l’éclat des supplices, ne sont sans doute encore rien comparé au réel [28]. Bien mieux que des textes officiels, les mémorialistes, ainsi que les historiens qui les ont convoqués, ont restitué les diverses formes de sanctions et répression sur les plantations.
A la même époque en Europe, entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, les tortures sont monnaie courante. Elles se déploient plus spécifiquement dans le champ religieux. Le musée de la torture, à Amsterdam, livre quelques portraits édifiants des martyrs corporels usuels tant contre les mécréants ou les blasphémateurs qu’à l’encontre des perturbateurs de l’ordre social, y compris les musiciens trop bruyants dans les foires. Tout porte à croire que le cumul de ce double ordre des choses - la culture du recours usuel à la torture comme mode de sanction et le passage à l’acte facilité par l’article 44 du code noir qui déclare « les esclaves être meubles » - a signifié, concrètement, sur les plantations, un monde social se définissant comme concentrationnaire. Et ce que Confiant ou Chamoiseau ont tenté de faire revivre dans leurs romans sonne comme une phénoménologie d’un ordre de la violence extrême et généralisée. Gilbert Larose, dans cette tentative de ressusciter le vécu de l’esclavage, a donc façonné le visage de la souffrance, de la détresse et de l’impuissance. Mais, aussi, il a voulu offrir des traces écrites qu’utilise l’historiographie. Ainsi, cet extrait des mémoires de Bernardin de Saint-Pierre du 15 avril 1769, est riche d’enseignement. Il montre, comme pour les récits des déportés, que les ressentis de violences ne se nichent pas uniquement dans les tortures les plus visibles, classiques pourrait-on dire. Ce sont toutes les relations sociales qui sont meurtrières, dépossédant le captif des éléments élémentaires de son humanité : « On les débarque tout nus avec un chiffon autour des reins. On met les hommes d’un côté, et les femmes à part, avec leurs petits enfants qui se pressent, de frayeur, contre leurs mères. L’habitant les visite partout. Les frères, les sœurs, les amis, les amants sont séparés. Ils se font leurs adieux en pleurant ». Si l’extermination des Juifs a été préparée par mille morts sociales (perte des biens matériels dont la maison et les objets porteurs de la mémoire sociale ; interdictions de professions et d’accès dans l’espace public ; mutilations symboliques par l’étoile jaune et les injures, etc), la transportation des Noirs a signifié un processus équivalent de génocide culturel qui prend naissance dans l’arrachement au monde originaire, puis, en Caraïbe, dans le découpage, le démembrement de la cellule familiale. Ce « simple » fait, sans même parler de « torture », nous invite tout de même à parler de tortures. Ces abominations sont totalement rayées de la carte mémorielle des Békés dans leurs pseudo-musées situés sur leur ancien espace concentrationnaire. Et elles sont largement euphémisées dans les musées mulâtres. Symptomatiquement, elles apparaissent au premier plan dans le musée populaire des Trois Ilets. Poursuivons l’extrait retenu de Bernardin de Saint-Pierre, qui détaille les violences domestiques, le travail forcé, l’oppression climatique, le désespoir et le suicide : « Voici comment on les traite. Au point du jour, trois coups de fouet sont le signal qui les appelle à l’ouvrage. Chacun se rend avec sa pioche dans les plantations où ils travaillent presque nus, à l’ardeur du soleil. A la moindre négligence, on les attache par les pieds et par les mains sur une échelle ; le commandeur, armé d’un fouet de poste, leur donne sur leur derrière nu cinquante, cent et jusqu’à deux cent coups (notons par comparaison l’unique mention « fouet à la main » dans l’exposition de Sainte-Marie). Chaque coup enlève une portion de peau. Ensuite, on détache le misérable tout sanglant. Les femmes sont punies de la même manière…Enfin quand les Noirs ne peuvent plus supporter leur sort, ils se livrent au désespoir : les uns se pendent ou s’empoisonnent, d’autres se mettent dans une pirogue…se hasardent à faire un trajet en mer. Voilà ce que je vois presque toutes les semaines ». « Lieu de vie, lieu de culture » affirment avec conviction les émules de la vision pacifiée…
Les différentes traces (code noir, mémorialistes, travaux des historiens sur l’organisation de la plantation avec une fine description des professions et de la hiérarchie) mobilisées par les époux Larose trouvent leur point d’orgue dans une composition aujourd’hui disparue à cause d’un cyclone. Celle-ci, photographiée en 2007, atteste d’une création esthétique muséale originale. Les postures des figurines en pate à modeler, ainsi que leurs peintures, attestent d’une intention claire de visualiser de façon moderne, comme une photographie, comme un documentaire audio-visuel, la réalité concentrationnaire de la plantation.
En premier lieu, une vision d’ensemble indique que rien de ce qui est montré ne sort du thème des violences extrêmes. Sur la plantation, l’auteur expose une scène de viol, l’arrivée d’esclaves enchaînés, le travail forcé dans le champ de canne, de corps puni et immobilisé par des chaînes reliées à une barre de fer, une vengeance d’un esclave en marronnage sur un planteur découpé en morceaux, une séance de fouet. Ce cadrage évoque tout sauf l’ambiance de « fête » que l’exposition de Sainte-Marie entendait placer avant les résistances.
En fait, ce que parvient à réaliser le concepteur de la Savane va bien au-delà d’une exposition statique des personnages. Les photographies prises en gros plan permettent nettement d’identifier les corps et le travail de précision recherché dans l’examen du comportement des acteurs sociaux. Chaque scène positionne subtilement des personnages.
Première scène : le viol. Le maître violente une femme qui, sous lui, doit supporter l’agression en public. Tout est dévoilé. Sur la plantation, l’espace totalitaire du maître se mire dans sa disposition absolue de l’espace temps. Pour bien le reconnaître, la blancheur lui recouvre tout le corps tandis qu’il arbore le chapeau colonial. La symbolisation ne s’arrête pas dans cette toute puissance tranquille dans l’usage des lieux, du corps et du moment. Elle fonctionne dans la multiplication à l’excès. Le viol est symbolisé par la posture mais aussi par la répétition. Le Béké est en train de violer. Mais il vient de violer une autre femme, celle qui voit un esclave lui tendre les mains. A demi dévêtue, elle est assise, ses vêtements déchirés, tandis qu’un frère de condition vient vers elle. Solidarité dans l’infortune tandis que le maître ponctionne, puise dans son vivier humain à sa guise, hors de toute contrainte d’espace et de temps. Viol sur la plantation, viol d’un Blanc sur une Noire, viol répété, régulier. Autant d’indices qui sont travaillés pour montrer le monde de la déshumanisation. Rien de tel dans l’exposition gentillette de Sainte-Marie où le macroéconomique de la production vient à lui seul gifler la réalité du quotidien colonial.

Seconde scène : l’esclave puni. Il est seul, les mains enchaînées. Mais, plus encore, son corps lui fait mal parce qu’il est plié, une barre de fer sous les genoux. Le musée de la torture en Hollande l’enseigne. Etre plié sans pouvoir se dégourdir les jambes entraine des crampes, des douleurs musculaires atroces. Esclave abandonné, corps broyé. Là encore, redondance des signes, entre les scènes et à l’intérieur de chaque scène. Le souci de déployer les registres de la souffrance ne se sépare pas d’une description finalement banale du régime plantationnaire. Mais la dimension phénoménologique chère à C. Chivallon s’exalte dans cette volonté de montrer réellement, au-delà des mots, un visuel surchargé des mots froids des historiens reconvertis en postures, en ballets, en concentrations de gestes et de poses corporelles. La plantation, c’est avant tout un corps martyrisé, vidé de ses forces dans la production, exploité sexuellement, punitivement violenté, précocement mort. C’est dans ce cadre qu’il est possible de resituer les « fêtes » et la danse « calenda qui fait fureur ».

Troisième scène : l’arrivé d’un groupe d’esclaves sur la plantation. Cette phrase en elle-même ne signifie rien, elle est de notre monde. Transfigurée par la dramaturgie iconographique, elle devient l’incarnation de Bernardin de Saint Pierre sur les lieux. On peut désormais imaginer les familles éclatées, les souffrances de la séparation, la fatigue du voyage, l’humiliation de l’inspection corporelle, la gêne occasionnée par le raclement des chaînes sur les chairs gonflées par le soleil, la mise au pas sur le débarcadère, la peur du lendemain sur une terre inconnue, la dépossession radicale. Le maître, devant, conduit son troupeau. Le symbole de la liberté totale du colon et de la soumission totale du déporté. Les corps sont affaiblis, les yeux hagards, la bouche ouverte. Soif, peur, tétanisation. Tout à la fois. Mais déjà en creux, la solitude du maître appelle la méfiance contre la masse et l’obligation d’être aidé par ces chaînes qui seront bientôt secondées par la zone grise. La toute puissance mais aussi la menace. Gilbert Larose peint sans doute la toute puissance dans la redondance des signes dualistes entre le maître actif et les esclaves passifs. Il n’y a pas de trace de zone grise, certes. Mais, on l’a dit, la preuve recherchée de la tripartition s’inscrit dans l’alignement des Mulâtres aux intérêts des Békés, ce qui est loin d’être le cas ici.

Quatrième scène : le marronnage. Les époux Larose étalent la violence extrême et offrent le sens de la résistance, de l’insurrection ou de la fuite solitaire. Tout cet empire de souffrances appelle une riposte, soit dans le suicide, soit dans le contournement, soit dans l’affrontement. Le maître est allongé. Avec son chien hurleur à ses côtés, ce chien que Chamoiseau a immortalisé dans Le vieil homme et le molosse. Il a les jambes coupées. La fureur s’est libérée et, tandis que dans la rage contenue, le planteur a pu être empoisonné, ici dans la rage furibonde, il met en pièce son bourreau. Volonté d’aller au bout de la logique. Inversion parfaite. Mutilation ici, découpage du monstre en retour. Le corps annihilé de l’esclave (travail forcé, séparation avec des corps aimés, tortures, viols féminins et masculins (ceux là on n’en parle jamais), postures incessantes du corps soumis) n’est pas un corps que l’on maintient en « vie ». C’est un corps concentrationnaire, non un corps sur un « lieu de vie ». Et ce n’est pas parce qu’il n’a pas été exterminé à son arrivée comme pour les Juifs que la mémoire historique peut s’autoriser à utiliser des expressions qui désignent la vie ou la culture, la fête ou la danse. « Lieu de vie », « lieu de culture », comme au Musée Dubuc, lui aussi financé par le Conseil général. Cette mémoire collective là n’est que la mémoire particulariste de dominants noirs camouflant le passé, un passé où ils ont été aussi propriétaires d’esclaves et farouches opposants à l’émancipation des Nègres : une dimension mémorielle qui ne figure dans aucun musée.

Cinquième scène : le fouet. Retour à l’ordre, punition pour mauvais travail, pour une tentative de fuite, pour un mauvais regard. Peu importe. Le fouet est utilisé encore dans la scénographie carnavalesque dans les groupes roots de Guadeloupe [29]. Comme le chien « morphoisé » incarne le nègre zombifié. Comme le diable incarne le maître dans les contes créoles. La mémoire populaire n’a pas oublié, en dépit du patient travail des chiens de garde nizaniens. Le fouet et la douleur. Rien, dans les autres musées, ne laisse transpirer la souffrance. Ce sont des musées scolaires, des musées de recouvrement en couches de cognitif choisi et verbeux, cognitif et technique, économiques et performatif, engoncé dans l’énoncé d’une gloire globale, contre l’émotionnel du muscle et du marquage. Là, l’esclavage est quantitatif, abstrait, fonctionnel, inexistant comme la culture distanciée. De la culture pour touristes qui s’instruisent. De la culture filtrée pour une population locale dont la mémoire est bornée par les contraintes d’une présence coloniale toujours agissante. Ici, en revanche, le nègre n’est pas beau à voir. Il est éthologiquement allongé sur le dos, les mains exposées, passives. Plus que se protéger, dire au maître que l’on est inoffensif, qu’il peut arrêter, que la proie est à lui, elle ne se possède même plus dans l’intensité engagée d’une protection. Et là encore, des yeux énormes, démesurés, la bouche ouverte sur les cris que l’on ne peut plus entendre désormais. Film muet d’une abomination qui peine à retrouver les sonorités d’antan, les vibrations qui faisaient trembler, ces hurlements qui rythmaient les jours, définissant l’Habitation comme un lieu à fuir, à moins d’en être un serviteur zélé et récompensé.

Toute cette fureur rassemblée ici forme symbole. L’enjeu n’est pas de pondérer, d’équationner avec les tambours, les chants et les sociétés secrètes du soir chères à Thierry l’Etang. L’enjeu est d’abolir les distorsions pour atteindre la symbolisation du mal que fut l’esclavage. Sur ce registre, tout s’oppose au bon vieux rhum et à ses prix, à l’entreprise sucrière anonyme et ses productions chiffrées, bref à l’externalisation si bien analysée par C. Chivallon. Le symbole concentre l’objet majeur : le corps de l’homme déshumanisé. Le régime de l’esclavage, c’est d’abord et avant tout ce broyage du corps humain pour que son jus donne naissance au jus de canne, au jus alcoolisé. « Lieu de vie » ? Non, lieu de mise à mort après l’extraction des forces de vie productives. Voilà ce que nous disent les époux Larose. L’espace muséal populaire existe sur cette terre martiniquaise. Et il donne à voir l’existence des castes socio-raciales ternaires dans les différences exemplaires que ces codages symboliques de l’esclavage forment structuralement. Un espace mémoriel tranché qui renvoie aux groupes socio-racialement segmentés. Quand la mémoire collective populaire rejoint la socio-graphie, autrement dit la mémoire historique, alors il est permis de dire qu’il ne s’agit pas d’une construction sociale comme une autre. Le relativisme culturel cède la place à une recherche de vérité sur laquelle un champ de lutte existe, sans aucun doute. Mais ces luttes s’ordonnent aussi autour d’exigences de plus en plus strictes à produire des preuves recevables. Force est de reconnaître que l’intérêt à dire la vérité, dans la sociologie critique, rejoint ici l’intérêt à retrouver une mémoire collective déniée. Sans doute l’accent est cette fois-ci trop polarisé sur les violences extrêmes. Cependant, cette symbolisation, par son souci d’amplification, ressemble à une respiration après une sortie d’asphyxie. Cet aspect des choses est intentionnellement posé par Gilbert Larose qui, telle une anamnèse, nous entraîne dans les caches d’une mémoire meurtrie et aliénée.
Il y a une loi du silence ?
Ah oui il ne fallait pas parler. Les gens avaient peur et honte en même temps. L’esclavage c’est comme se voir encore comme paysan, comme nègre. Pour moi c’est pas la honte mais je comprends la honte des Anciens parce que si on te viole, tu vas pas répéter tout le temps qu’on t’a violé, c’est comme ça que les Anciens le ressentent. C’est une honte de parler de ça, de ce que tu as subi, c’est comme si tu es le diable quoi. Parce que nous, on nous faisait comprendre qu’on était le diable parce que lorsque le Maître parlait, il disait : ‘Vous sortez d’Afrique, et l‘Afrique c’est le diable, donc il faut être esclave, parce que c’est seulement ici que vous aurez le paradis, c’est seulement ici qu’il y a la bible. Ici les gens ne savent pas lire et écrire. Alors ils ont cru. Tu as vu comment les églises sont bondées ici ? Les Jésuites aussi avaient des esclaves, ils faisaient des sous avec. Donc la honte est toujours là. C’est comme masquer les trucs sur ton visage. Ça c’est une honte pour nous d’en parler trop. Moi je n’ai aucun diplôme je ne suis pas inscrit dans la société. Mes parents n’ont jamais fait l’école, jamais jamais. Mon père est un paysan comme moi. Si tu n’as pas l’instruction tu n’es rien. Et le Béké ici il possède 80 % de l’île. Et on est 90 % de nègres. Ils ont tous les commerces. Et on te donne jamais la possibilité de monter dans cette case là. Et ceux qui ont de l’instruction peuvent trouver du travail en métropole. Mais tu es toujours plus bas. Et les gens ont perdu toute la connaissance du jardin. On a tous les produits de la métropole mais pas les produits de la Martinique. Nous on n’a plus de terrain. Tu es toujours sous leur emprise. Pour rester calme, tu as la voiture, le supermarché. Ils ont masqué les choses ! Et les Martiniquais ils ne veulent pas connaître l’histoire. En 1974, ils ont tiré les gendarmes. Ils ont tiré. Moi ce que je voulais c’est l’histoire de l’île mais complet…l’histoire comme ça il manque des choses, qu’est-ce qu’ils ont eu comme sort les gens qui sont venus ici, esclaves, c’est pour ça que l’histoire comme ça, y a des panneaux dans les éco- musées et tout, mais à un moment on va lire ça on sera lass’… mais comme je l’ai réalisé, c’est pas pareil donc c’est l’histoire complet. Dans chaque pays, dans chaque île il y a l’histoire, nous on apprend l’histoire de France mais on n’apprend pas l’histoire d’ici. Il faut voir comment les enfants sont contents ici, même si il y a la boue, ils sont contents. C’est eux qui emmènent les parents. Faut voir le livre d’or c’est le témoin !Il y a une enfant qui a dit à maman « maintenant tu peux plus dire que c’est toi qui a vu la maison en paille, tout ce que tu nous disais on a vu maintenant en 2009 ce que tu as u quand tu étais petite », tu as vu le boom ? Alors à force d’entendre des trucs comme ça, tu as envie de continuer, ça plait et les gens sont contents, les gens sont fiers. Ça rend les gens fiers » [30].
L’analyse ainsi posée d’une exposition que d’aucuns qualifieraient de « révisionniste », mise en relief par une conception opposée assez proche de l’historiographie, ne s’arrête pas à un cas de comparaison monographique. C’est en fait l’ensemble de la muséographie de la Martinique qui se compose de constructions dénégatrices du passé mises en relief par la Savane des esclaves. C’est dire toute la valeur d’un musée comme celui de Gilbert Larose, forme atypique de résistance populaire dans un secteur symbolique qui est traditionnellement contrôlé par les dominants mulâtres. Mais il faut bien reconnaître que ce qui est le plus hallucinant, du point de vue du chercheur, réside dans ce grand écart entre les apparences de la négritude dans un pays dirigé localement par des élites noires (valorisation de la culture créole, commémoration de l’abolition de l’esclavage, défense de l’emploi local), et la réalité néocoloniale d’une zone grise qui érode intentionnellement une réalité esclavagiste qu’on aurait soupçonné d’être plus contrôlée et célébrée ici qu’ailleurs. C’est dire que la saisie de ce paradoxe « impensable » ne peut être compris sans référence aux impensés qui sont précautionneusement travaillés par des élites affectées par la mauvaise conscience. Une mauvaise conscience qui provient d’une hiérarchie socio-raciale structurée dans le cadre colonial et qui perdure largement aujourd’hui. Le colonialisme oublié, c’est aussi l’existence de groupes dominants noirs qui doivent leur place sociale des rôles d’allégeance aux colons blancs du temps de l’esclavage. Sans se réduire à cette fonction de zone grise, l’élite noire martiniquaise en est issue et, de ce fait, elle cherche à museler une mémoire qui pourrait travailler contre elle.
NOTES
[1] J. Daniel parle de « la volonté longtemps affichée par le pouvoir central français, d’éradiquer les lieux de résistance collective à travers les tentatives répétées d’assignation d’une identité par le haut ». Daniel J. « L’espace politique aux Antilles françaises », Ethnologie française, XXXII, 4, 2002, pp. 589-600.
[2] Le même auteur évoque la « condamnation sans appel de la culture locale et de la langue créole » qui a « bénéficié du soutien de certaines catégories sociales locales ». Ibid., p. 591.
[3] Les musées du crime, des camps de la mort, de la guerre, de la torture, attestent aisément de l’existence de possibilités d’élaborer un « lieu d’oubli actif » (J.L. Déotte). C.A. Celius, « L’esclavage au musée. Récit d’un refoulement », L’Homme, vol. 38, n° 145, 1998, pp. 249-261.
[4] M. Cottias, « ‘L’oubli du passé’ » contre la ‘citoyenneté’ : troc et ressentiments à la Martinique », F. Constant et J. Daniel, 50 ans de départementalisation outre mer, Paris, L’Harmattan, 1997, pp. 293-313 ; O. Lara, De l’oubli à l’histoire, op. cit., pp. 151-207.
[5] A. Lucrèce, Frantz Fanon et les Antilles. L’empreinte d’une pensée, Fort de France, Le Teneur, pp. 74-79.
[6] Contacts de civilisation en Martinique et en Guadeloupe, UNESCO, 1955.
[7] Paris, (trad.) Plon, 1955. N. Hare, The Black Anglo Saxons, New York, Marzani and Munsell, 1965 ; M. Kilson, « The Black Bourgeoisie Revisited », Dissent Magazine, Hiver 1983 ; Dans la même veine, mais dans un cadre colonial différent, L. Kuper, An African Bourgeoisie : Race, class and politics in South Africa, New Haven, Yale University Press, 1965.
[8] La condition noire. Essai sur une minorité française, Paris, Gallimard, 2008, pp. 88-96.
[9] E. Glissant, Le discours antillais, Gallimard, 1997, p. 187.
[10] Tout au moins au sein des partis. Les cadres du PPM, MIM et GRS rencontrés lors de diverses enquêtes (sur l’altermondialisme, la pauvreté et l’insertion) disent tous que les Békés sont des Martiniquais et qu’il est hors de question de les inclure comme « ennemis » lorsque la question de l’indépendance est abordée. Si celle-ci survenait, ils trouveraient normal de les associer au développement du pays.
[11] Un ouvrage récent sur la question du postcolonialisme n’aborde même pas la différence fondamentale entre le postcolonial dépassé politiquement (Afrique, Amérique du Sud, l’Asie et une partie de la Caraïbe) et le postcolonial en continuité politique coloniale (une partie de la Caraïbe dont les Départements Français d’Amérique). M.C. Smouts (dir.), La situation postcoloniale. Les postcolonial studies dans le débat français, Presses de Science Po, 1997, en dépit d’une courte évocation de la situation des « Outre-mers ». Ibid., pp. 59-60. D’ailleurs, les thèmes principaux sont le rôle des intellectuels issus des espaces « post-coloniaux », les résistances populaires, les courants théoriques, dont le post-colonialisme et le post-modernisme, les effets psycho-culturels du traumatisme. Il n’y a presque rien sur les formes de domination sédimentées dans des groupes sociaux.
[12] « The Cultural Citizen : Negations of Race and Language in the Making of Martiniquais », Anthropological Quartely, vol. 70, n°2, avril 1997, pp. 79-90 (p 83).
[13] G. Sainton, Les Nègres en politique. Couleur, identité et stratégies de pouvoir en Guadeloupe au tournant du siècle, Mémoire d’histoire, Université de Provence, 1997, p 106 (Fonds régional, UAG).
[14] J. Daniel, « L’espace politique aux Antilles françaises », op. cit., p 598.
[15] « Les revendications portant sur le statut politique tendent à structurer le jeu partisan », J. Daniel, « L’espace politique… », op. cit., p 589. Il ajoute : « Les clivages nés de la subordination coloniale ont durablement structuré les représentations de l’identité ». Ibid. p 590.
[16] « The Cultural Citizen : Negations of Race and Language in the Making of Martiniquais », Anthropological Quartely, op. cit., p 84.
[17] A. Brossat, D. Maragnès, Les Antilles dans l’impasse. Des intellectuels antillais s’expliquent, Paris, Editions caribéennes/L’Harmattan, 1981, p 19 et s.
[18] C. Chivallon, « Rendre visible l’esclavage. Muséographie et hiatus de la mémoire aux Antilles françaises », L’Homme, 2006/4, n° 180, p. 7-41.
[19] En juin 2012, je rencontre à nouveau cette historienne renommée, recevant des fonds européens afin de promotionner la mémoire de l’esclavage. En compagnie de représentants d’une association martiniquaise oeuvrant sur le même thème, j’aborde frontalement la question de son inauthenticité scientifique. Les deux représentants associatifs martiniquais sont gênés. L’un d’eux parle « d’ambivalence » à la suite d’une floppée de détails que je rapporte, prouvant un travail d’euphémisation systématique. Mon propos les bouleverse d’autant plus qu’ils se réunissaient en vue d’une journée d’étude municipale autour de la transmission de la mémoire de l’esclavage aux enfants métropolitains ! M. Cottias me répond, devant trois témoins, qu’elle n’a pu définir à elle-seule les thèmes de l’exposition. « Il a fallu tenir compte des exigences du Conseil général » tient-elle à préciser. Je lui dis que je rapporterai ses propos qui attestent clairement d’un positionnement des élites locales.
[20] op. cit., p. 31.
[21] Cette vision classique de la performance économique et technique est d’ailleurs contestée par E. Glissant, Le discours antillais, op. cit., p. 98-99. Il parle lui de stagnation « depuis deux siècles ».
[22] « Rendre visible l’esclavage. Muséographie et hiatus de la mémoire aux Antilles françaises », op. cit., p. 22-23.
[23] Cette hypothèse mériterait qu’on la vérifie. Dans la logique coloriste de P. Ndiaye, il est aisé de constater que la grande majorité des élus de cette collectivité sont issus des professions dominantes. Par ailleurs leur origine sociale les positionne comme plus proche de la bourgeoisie (médecins, avocats, propriétaires fonciers, détenteurs de biens immobiliers) que les élus indépendantistes du Conseil régional, davantage membres de la petite bourgeoisie de la fonction publique.
[24] Eichstedt, J. L. & S. Small, Representations of Slavery : Race and Ideology in Southern Plantation Museums, Washington, Smithsonian Institution Press, 2002. Je dois cette référence précieuse à la bibliographie de C. Chivallon.
[25] Largement reconnue par la communauté scientifique, elle publie des ouvrages académiques qui s’alignent sur les recherches actuelles. Elle participe aussi au travail de déconstruction de la mémoire officielle. M. Cottias, « L’oubli du passé contre la citoyenneté : troc et ressentiment à la Martinique (1848-1946) », F. Constant & J. Daniel (dir.), 1946-1996 : cinquante ans de départementalisation Outre-mer. Paris, L’Harmattan, 1997, pp. 293-313
[26] Une comparaison entre deux articles évoquant le même événement historique, celui d’Oruno D. Lara et celui de Myriam Cottias révèle une certaine conduite d’euphémisation. Evoquant les effets de l’abolition de 1848, le premier dit : « Les colonisés ‘nouveaux libres’ de 1848 furent réduits à l’impuissance par des méthodes coercitives plus sophistiquées. Une machinerie complexe fut mise en place dès 1848 pour assurer la production de l’oubli. Les planteurs blancs créoles continuèrent à dominer l’économie coloniale. Ils obtinrent une indemnité de 120 Millions de francs (…) Les esclaves libérés ne reçurent aucune indemnité ni lopin de terre. Ils s’aperçurent que le décret d’avril autorisait leurs maîtres à se saisir de leurs cases et des jardins qu’ils avaient pris tant de soin parfois à constituer. Expulsés par les anciens maîtres, les travailleurs et leurs familles durent en outre abandonner leurs volailles, voire même des bestiaux et un mobilier sommaire fabriqué de leurs mains ». O. D. Lara, De l’oubli à l’histoire. Espace et identité caraïbes, Guadeloupe, Guyane, Haïti, Martinique, Paris, Maisonneuve & Larose, 1998, pp. 151-152. La seconde dit : « Les Républicains offrent ainsi aux nouveaux affranchis qui constituent 60 % de la population totale de la Martinique, l’égalité politique et sociale, la citoyenneté pleine et entière, le droit à un travail salarié, l’accès à la terre, l’éducation et une respectabilité définie selon les critères de l’époque (…) C’est autour de la question de la terre que le ressentiment explose brutalement pour trouver des moments de pacification grâce à des négociations entre propriétaires (sic) et travailleurs. Tout de suite la formule du contrat d’association se développe avec ses désavantages, ses inégalités et ses désaccords entre les parties (sic) ». « L’oubli du passé contre la citoyenneté : troc et ressentiment à la Martinique », op cit., p 294 et 309. On appréciera à sa juste valeur cette dernière expression de « respectabilité définie selon les critères de l’époque ». Tout le propos fait penser à une sorte de conflit collectif moderne entre « propriétaires » et « travailleurs » comme elle dit, refusant ici les termes clairs, socio-raciaux de Békés et de Nègres dans une relation coloniale maintenue. Mais le plus surprenant, dans sa démonstration, est le recours presque systématique à des mémoires d’un colon -Pierre Dessales- pour attester de la réalité des réformes sur la plantation et le « contrat d’association ».
[27] Travaillant depuis 2004 sur la pauvreté dans cette île, j’ai constaté, lors des entretiens menés auprès de dominés, notamment un des représentants de chômeurs, que la contestation trop appuyée n’est même pas réprimée par les patrons visés. Elle est d’abord muselée par les membres de la famille du protestataire qui ont peur de perdre leur emploi.
[28] Bernardin de Saint pierre, que Gilbert Larose utilise, affirme dans un de ses passages : « Il y a une loi faite en leur faveur appelée le Code Noir. Cette loi favorable (sic) ordonne qu’à chaque punition ils ne recevront pas plus de 30 coups ; qu’ils ne travailleront pas le dimanche ; qu’on leur donnera de la viande toutes les semaines, des chemises tous les ans ; mais on ne suit pas cette loi ». C’est dire que les belles listes de prestations auxquelles ont droit formellement les esclaves sur la plantation du Père Labat, et que les organisateurs se sont empressés de dresser de manière auto-suffisante, sont soit la preuve d’une naïveté qu’un historien averti dépasse dans les toutes premières années de son cursus, soit l’indicateur probant d’une intention manifeste d’euphémiser les violences exercées contre la marchandise humaine.
[29] Christian Cécile, « Mas et rites de Guadeloupe : un carnaval contestataire », C. Falguayrettes-Leveau (dir.), Masques et mascarades, Musée Dapper, 2011.
[30] Entretien informel après une visite de la Savane en juin 2007 et entretien formel mené avec J. Kabile en avril 2008.
 Fil des publications
Fil des publications
 retour au sommaire
retour au sommaire