Dans la frontière
Une expérience documentaire dans un centre d’hébergement d’urgence parisien
présentation de l'éditeur
 |
Collectif Précipité, Dans la frontière - Une expérience documentaire dans un centre d’hébergement d’urgence parisien . Paris, Khiasma Sud, 2007. Paru le : 7 mars 2007 - Éditeur : Khiasma Sud - Collection : Limitrophe - Reliure : Broché - Couverture : couleur - Description : 112 pages (21 x 21 cm) - ISBN : 978-2-91 4699-26-6 - Prix : 13 € A lire sur TERRA : l’introduction, la table des matières |
Mots clefs
PRESENTATION :
Ce livre, montage de photographies, de récits de vies, de discussions et de parcours dans la ville déplie les histoires et le quotidien de plusieurs hommes et femmes, demandeurs d’asile ou sans-papiers. Leur point commun est d’avoir un jour quitté leur pays et d’être arrivé aux portes d’un foyer Emmaüs à Paris. Ils sont là, mais sans y être pourtant tout à fait. Comme si les frontières se prolongeaient indéfiniment et continuaient de les séparer du pays où ils sont arrivés, les prenant au piège d’un temps suspendu. Résultat d’un travail collectif mené avec les « résidents » d’un centre d’hébergement d’urgence, ce livre, à mi-chemin de l’archive et de l’enquête, revient sur les « lieux » de cette division de l’espace commun, explore une géographie invisible et pourtant présente dans les interstices de nos villes.
Recueil de témoignages, photographies, textes et montage : collectif Précipité collectifprecipite@no-log.org
Edition : Khiasma Sud, collection Limitrophe 11 rue des Frères Silvy 13007 Ceyreste Khiasmasud@free.fr
Diffusion : Co-errances carmela@co-errances.org 01 40 05 04 24
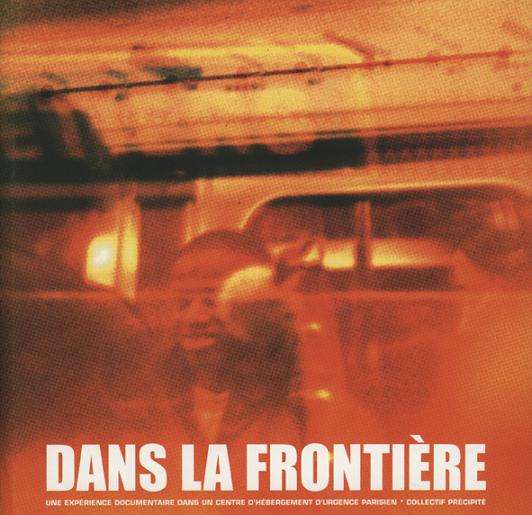
INTRODUCTION :
355 RUE DES PYRÉNÉES
Paris, janvier 2003. Premier rendez-vous au foyer Emmaüs. Nous connaissons déjà le lieu et son directeur, Mustapha Beckhtaoui, qui a organisé cette rencontre avec le personnel et les hébergés. C’est dimanche, il y a un peu de monde. Le week-end fait ici figure de parenthèse, les hébergés pouvant exceptionnellement demeurer dans l’immeuble pendant la journée. Nous sommes installés dans la salle commune, au rez-de-chaussée de cet ancien hôtel. Nous projetons sur une petite télé un film [1] pour introduire notre proposition d’atelier documentaire. L’idée est simple, à la mesure du peu que nous savons : depuis plusieurs années, ce foyer, comme beaucoup d’autres en région parisienne, comprend une grande majorité de personnes étrangères, qui arrivent d’à peu près toutes les régions du monde. Nous proposons de réfléchir avec eux sur l’idée de frontière. Nous parlons d’« atelier de témoignages », d’« enquête » pour expliquer notre démarche. Il s’agit moins de travailler sur un thème que de créer les conditions d’un travail collectif. Plus précisément de faire émerger la possibilité d’une prise de parole à l’intérieur du lieu et de tout construire à partir de là. Ensuite, nous verrons bien…
De cette première discussion, c’est l’idée de témoignage qui semble la plus concrète à tout le monde. Le reste, notre installation éventuelle ou l’idée de travailler ensemble paraissent floues. Le lieu n’est pas fait pour cela, tout le monde est ici de passage. Au moment de se quitter, certains viennent individuellement nous parler du pays abandonné, des difficultés rencontrées pour arriver jusqu’à Paris. Ces choses-là se racontent dans le couloir, de personne à personne. Nous quittons la salle en promettant d’apporter la semaine suivante une affiche annonçant le projet. Tout le monde se disperse. Certains demandent leur clef de chambre au « compagnon » assis derrière le comptoir à l’entrée de la salle, d’autres ressortent avec nous dans la rue.
La rencontre s’est finalement poursuivie pendant quatre mois, temps de notre présence à l’intérieur du foyer. Elle a évolué, s’est déplacée, se confondant entièrement avec le travail. Mais il a fallu toujours repartir de là. Quotidiennement, passer du temps en bas, entre les deux portes d’entrée de l’immeuble faisant un peu office de sas, le couloir conduisant à l’escalier de cinq étages, et la salle commune. S’appuyer sur le rythme officiel du lieu, ses contraintes de fonctionnement. Prendre conscience qu’au-delà du cadre matériel, il y avait une situation institutionnelle précise, dite « Centre d’hébergement d’urgence ». Soixante-cinq personnes maximum, en principe deux par chambre. Une durée de présence autorisée de 15 jours renouvelable une fois. Des horaires stricts de fermeture entre 8h00, le matin, et 18h30, le soir. Pas vraiment un lieu en fait, puisque quasiment vide tout au long de la journée, hormis quelques « compagnons » occupés aux tâches d’organisation et de ménage. Entre 18h30 et 22h00, un court moment d’intensité, pourtant loin de présenter les traits d’une vie commune. Succession des retours au foyer. Défilé dans les escaliers qui conduisent aux chambres. Allées et venues dans le couloir d’entrée avec ceux qui se dirigent vers la salle de repas, utilisent le poste téléphonique, ou viennent rencontrer le directeur. La porte de son bureau est toujours ouverte, il y a peu de temps pour répondre aux problèmes de chacun. 20h00, rassemblement devant le journal télévisé. Scotchée sur une vitre de la salle, une note de la direction « rappelle aux permanents, hébergés et compagnons qu’à 22h30, lors de la fin du film de la soirée, tout le monde doit regagner sa chambre ».
L’ordinaire de l’urgence en somme, avec cette étrangeté d’un lieu entièrement aspiré vers le dehors. Le vieux schéma de réinsertion des populations démunies soumet le lieu à un temps social encore dominé par la norme du travail salarié. Le matin, les personnes sont censées sortir, entreprendre des démarches, se rendre dans d’autres structures comme les centres de jour par exemple. Rien ne donne l’illusion d’un arrêt possible. La logique d’urgence restreint la logique d’accueil, et avec elle, l’idée d’un temps propre au lieu et à ceux qui le fréquentent. Que veut pourtant dire l’urgence lorsqu’elle s’applique à des personnes qui circulent incessamment dans le réseau de l’assistance ? Durant les quatre mois passés à l’intérieur du foyer, nous en avons vu beaucoup partir et revenir. Certains étaient déjà familiarisés avec le « circuit », d’autres, à peine arrivés sur le territoire français, le découvraient encore. La plupart étaient passés par les mêmes étapes, avec plus ou moins de chance, plus ou moins de difficultés : Roissy, la zone d’attente, le numéro d’urgence du 115, le centre pour sans-abris de Nanterre, le métro, les squares, la rue... le foyer de la rue des Pyrénées. Un parcours-type replaçant l’arrivée aux portes du foyer dans l’échelle plus vaste de leurs trajets migratoires.
Notre intention n’était pas de décrypter l’institution Emmaüs, mais d’y inscrire matériellement une tentative documentaire. Partir de ce qui pouvait être dit et rendre visible ce que cette parole portait. Le pari était double : interroger l’hypothétique communauté de ceux qui trouvaient ici un abri et décrire ce qu’elle nous permettait de voir et d’apprendre. De cette expérience documentaire, le foyer n’a jamais été le sujet, mais il en est devenu la métaphore. Où étions-nous ? La question était difficile à un endroit où espace et temps fuient en permanence, où la logique institutionnelle interdit toute inscription des corps et des pensées. Un hébergé, Mamadou, en a pourtant trouvé la formule : « Nous sommes dans la frontière ». Les quatre mois de notre installation ont entièrement été consacrés au déchiffrement de cette parole.
RÉCITS
Quatrième étage. Chambre 41. Comme les autres, une pièce unique assez étroite, divisée en son milieu par une salle de bain. À gauche, un espace juste assez grand pour installer deux lits, à droite, dans le prolongement de la porte d’entrée, un renfoncement avec une armoire. La chambre est vacante, et avec la complicité du directeur, nous l’avons transformée en salle de réunion. Une affiche réalisée dès les premières semaines est collée sur la porte d’entrée. Une carte d’Europe, avec, attablées tout autour, les silhouettes de plusieurs personnages en train de discuter. Un titre en assez gros lettrages : « Atelier de réflexion autour du mot frontière ». Sa valeur est d’usage : établir un point d’accroche dans le lieu, empiéter de façon visible sur l’anonymat des chambres. Elle indique la volonté de trancher sur le silence qui entoure la réalité sous-jacente du lieu, sa géographie véritable. On donne rendez-vous ici. À n’importe quelle heure, quand les personnes peuvent, trouvent le temps. Au fil des semaines, une vingtaine d’entretiens seront enregistrés. Très lentement au départ, puis, avec le bouche-à-oreille, à un rythme plus soutenu. Tout reste compliqué et il faut toujours deux, trois rendez-vous manqués pour finir par réaliser l’enregistrement. Reste d’ambiguïté, de méfiance, cet entretien risquant toujours d’apparaître comme un entretien de plus, à côté des autres auxquels ils sont contraints : assistants sociaux, directeurs de foyers, agents de l’Ofpra [2]… Pourtant, c’est souvent la première occasion qu’ils ont de raconter l’ensemble du parcours qui les a conduits jusqu’aux portes du foyer. De se ressaisir en dehors de ce qu’ils doivent dire ou de ce que l’on attend d’eux selon la catégorie à laquelle ils sont assignés. Qui sont-ils ? Pourquoi sont-ils venus ? De la réponse à ces questions dépendent souvent la possibilité d’un avenir ici et le couperet de la définition plus ou moins précise d’un statut : « demandeurs d’asile », « réfugiés », « sans-papiers », « clandestins », « migrants », « exilés »… Qu’elles proviennent du droit ou de l’opinion, ces appellations restent marquées du seul point de vue des états où arrivent ces personnes. Le regard sur l’immigration opère un tri, une sélection. De même le foyer, où le point de vue humanitaire efface la complexité des trajets personnels.
Paradoxalement, le foyer s’est transformé en instance de visibilité : en regroupant de fait des personnes aux statuts a priori différents (« demandeurs d’asile », « déboutés », « régularisés »), il poussait à interroger ce qu’elles avaient en commun. Sous les problématiques de l’asile ou de l’immigration, nous voulions faire remonter des histoires concrètes, matérielles, orientées par le souci du détail. Comment entendre et voir quelque chose à partir de cette chambre, de ce « point zéro » de l’hébergement d’urgence ?
Haby, par exemple, a mis du temps pour commencer à raconter son histoire sans se référer à la lettre qu’une association l’avait aidée à rédiger pour sa demande d’asile. D’un côté, il y avait un témoignage, de l’autre une histoire. Entre les deux, un changement de point de vue capable d’exprimer l’expérience singulière qui s’était ouverte pour elle avec le départ. Sans disjoindre l’avant et l’après, l’ailleurs et l’ici.
Les pays sont différents, la Guinée, le Sénégal, la Mauritanie, l’Algérie, le Maroc, la Turquie, le Nigéria… Les raisons, les désirs, les nécessités intriqués au départ, toujours mélangés et multiples. L’unité d’expérience, cependant, est commune. Une brisure, et l’ouverture de quelque chose qui ne s’est pas refermée avec l’arrivée en France. À l’intérieur des différences, une même trame. La perte d’un lieu, le plus souvent, et des attaches qui lui étaient liées. La guerre, les papiers d’identité déchirés, déjà, dans son propre pays. La perte d’un territoire d’existence possible, de ses droits. Ou alors, une géographie subjective qui ne se superpose pas aux frontières étatiques, la sensation d’étouffer. Suivent le départ et l’ouverture d’une longue errance du corps, des affects, de l’identité. Quelque chose de très concret. La nécessité de se cacher dans un camion ou dans un bateau, de changer de lieu en permanence. L’obligation de remettre sa vie dans les mains d’un autre. L’attente. Les histoires individuelles s’enracinent dans des contextes historiques et sociaux très particuliers, mais les mêmes mots reviennent pour décrire ce qui a commencé et ne s’est pas achevé avec l’événement de l’exil, un mouvement en suspens. Au final, quelque chose comme l’entrée dans un espace-temps spécifique, qui indique aussi une sortie du monde ordinaire, une mise à l’écart durable. Comme si le franchissement des frontières était interminable. La carte géographique, les lignes séparant les territoires se brouillent, mais les frontières sont là partout où les mêmes traits d’expérience se répètent. Jusqu’à Paris, jusque dans cette chambre. Enveloppement de deux échelles : une même attente indéfinie, un même confinement, une même errance se continuent dans ce centre d’hébergement qui ressemble finalement à tant d’autres lieux où ils ont fait halte.
JOURNAL
Même chambre 41. La porte est ouverte et nous attendons. Il est 20h00. Personne n’est encore là, sans doute à cause du journal télévisé. Certains se sont engagés à venir. Nous avons un peu réorganisé la pièce pour y installer une grande table. Des affichettes ont été placées dans la salle du bas et dans l’ascenseur, qui annoncent cette première réunion collective.
Au fil des entretiens, une carte subjective du monde a commencé à se dessiner, infléchissant celle qui se retrace chaque jour dans les têtes, à force de peur et d’ignorance, de lois sur les étrangers. Elle transforme la perception du temps et de l’espace, de l’histoire et de la géographie. Combien de « Sud » déjà dans ce qu’on appelle le « Nord » ? Les histoires qui s’entrechoquent à l’intérieur du foyer sont paradoxales. Marquées par la division, elles ne cessent de relier les différentes parties du monde. Il n’y est pas question de l’Autre, mais d’une histoire commune, même si en permanence déniée, refoulée. Ce n’est pas seulement l’histoire de la colonisation, si importante pour comprendre les imaginaires migratoires. C’est aussi une histoire au présent, qui s’écrit sous les pas de ceux qui arrivent et continueront d’arriver. Elles parlent de la guerre, d’un capitalisme en recomposition, du grand tremblement des frontières nationales. Elles parlent de nous.
C’est en tout cas l’idée de ces réunions : à l’entrecroisement de ces histoires individuelles, quelque chose d’autre apparaît, qui met en scène l’état du monde à une échelle globale. C’est l’échelle des vies qui se rassemblent ici et qui font du foyer une sorte de petit observatoire du monde. Les réunions veulent inscrire cela dans les murs du foyer. Une affirmation de Sem nous a particulièrement marqués : « Et maintenant, nous sommes là ». Discuter collectivement, c’est, au-delà des causes et des raisons, prendre acte du fait migratoire, d’une présence, et questionner combien elle modifie les rapports traditionnels du lieu et de l’identité, les certitudes quant à ce qui est d’ailleurs et d’ici. Moins une affaire de témoins que de sujets qui prennent activement part à cette évolution. Qu’ont-ils à se dire, eux qui partagent cette expérience ? Qu’avons-nous à nous dire ? Cette table de discussion est une fiction : celle d’un espace égalitaire où la pluralité des points de vue pourrait apparaître. Où chaque trajectoire se transformerait en question appropriable par tous, trouverait son propre langage. Nous savons la contrainte ou les violences qui ont impulsé le mouvement des uns et des autres jusqu’à ce foyer. Ils n’en sont pas pour autant sans lieu, sans histoire ou sans culture. Les mots de « réfugiés » ou de « migrants économiques » ne disent rien de ce qu’ils ont emporté avec eux en quittant le pays, la ville, le quartier où ils vivaient. D’autant que l’exil, la migration relancent cette histoire. Ici, à Paris.
Dès la première réunion, il y a du monde. À partir de ceux qui ont déjà fait des entretiens, la discussion s’élargit vite. Les chaises s’alignent jusque dans le couloir. Tout le monde ne parle pas le français, certains traduisent. D’autres passent ou écoutent simplement. Vers 23h00, ceux qui restent autour de la table ne sont pas forcément les mêmes qu’au début. Au fil des semaines, le rendez-vous s’impose. Un petit journal est édité et distribué dans le foyer à partir des discussions, intitulé « Chroniques du foyer-monde ». Il rend visible le travail en cours, fait le lien entre ceux qui partent et ceux qui arrivent, permet une continuité. Les « Chroniques » sont déposées au rythme irrégulier des réunions sur le comptoir d’entrée du Centre, où chaque jour les personnes hébergées viennent chercher leurs clefs de chambre. En bas, les commentaires sont fréquents, on relit ce qu’a dit l’un ou l’autre. Fragments de ce qui se pense ici, même si ça ne sort pas des limites du foyer. À moins d’y entrer, il est impossible de savoir qu’il y a là un Centre d’hébergement d’urgence, d’imaginer le réel de ce lieu.
L’évolution des discussions organisées dans la chambre 41 en porte l’empreinte. Non pas que l’idée du « foyer-monde » soit fausse, mais elle est contredite par le quotidien des personnes qui se réunissent autour de la table. Ce qui se dit ici n’existe pas à l’extérieur, n’a pas de place. Sauf pour quelques anciens militants politiques dont les réseaux peuvent exister jusque Paris, les espaces collectifs sont la plupart du temps inexistants. Le mouvement des sans-papiers est méconnu, même pour ceux qui sont en France depuis plus longtemps. Et c’est naturellement que les thèmes choisis pour les discussions retournent vers la négativité de l’existence dans la ville. C’est une façon de rappeler que la frontière traverse le foyer lui-même, qu’il est un des lieux de sa matérialisation. Et que la communauté réelle, mais précaire, qui se révèle dans ces discussions explose chaque matin à l’heure de la fermeture du foyer.
TRAJETS
Le lieu est problématique, travaillé par l’écart entre ce que dit l’institution et ce qu’elle fait [3]. Confronté au vécu des personnes hébergées, le principe d’inconditionnalité de l’accueil y résonne étrangement. À l’ampleur des trajectoires, répondent le silence et l’anonymat des chambres. À la complexité des histoires, la logique minimale et aveugle de l’urgence sociale. Au plein, le vide. Dans cette tension, ce qui reste souvent, c’est l’incompréhension d’être là. Les informations qu’on peut obtenir sur ses droits ou sur les démarches à entreprendre sont maigres ; le personnel n’a souvent pas été formé pour cela. Le temps ne donne aucune prise : le turn-over élevé, les listes d’attente à l’entrée des différents centres d’hébergement empêchent qu’on puisse inventer ici des outils collectifs pour sortir de la simple relation d’assistance. Ce Centre est débordé, comme les autres. La situation est connue, les journaux en parlent, techniquement : il est question de l’afflux croissant de demandeurs d’asile dans la capitale, du manque de places en Cada [4], d’un risque d’explosion du système… En fait, il faudrait remonter le fil un peu différemment, et surtout, ne pas partir du « problème » de la « saturation des Centres d’hébergement d’urgence ». Comprendre le chemin assez réglé qui amène cette nouvelle population jusqu’au dispositif de l’urgence, la fermeture des frontières ne cessant de prolonger ses effets à l’intérieur du territoire. Une addition minutieuse serait à faire, des mesures légales et administratives de plus en plus restrictives qui encadrent les étrangers… jusqu’aux horaires du foyer. À ne considérer que l’exemple de la demande d’asile, souvent la dernière porte d’entrée légale sur le territoire, les délais d’accès à la procédure, de traitement des dossiers, l’interdiction de travailler conjuguent leurs effets pour précariser le séjour en France. La réponse bureaucratique visant à accélérer les procédures ne fait, elle, que déplacer le problème en augmentant le nombre de refus et donc de déboutés de la demande d’asile. Dans cette longue chaîne d’empêchements et d’obstacles, le foyer n’est pas un terme. Au mieux fait-il figure de parenthèse qui, avec le temps, peut revêtir l’aspect d’un piège, dans lequel l’attente n’est parfois que celle de la prochaine expulsion.
Les discussions et entretiens se déroulent majoritairement le soir, et malgré notre présence, le temps partagé reste très réduit. De fait, nous ne cessons de discuter de ce qui se passe à l’extérieur. Les mêmes lieux reviennent, institutionnels comme la préfecture, les centres de domiciliation, ou plus informels comme ceux où l’on peut chercher du travail, rester un peu tranquille, à l’abri. Les adresses sont connues de tous. Le foyer est l’une d’entre elles, où l’on ne passe pas plus de temps qu’ailleurs. Seuls les usages diffèrent : ici, on peut manger et dormir.
Nous voulons poursuivre l’amorce d’enquête qui a émergé des réunions collectives. En décidant d’accompagner quelques-uns aux heures de fermeture du foyer, nous ajoutons l’idée d’un travail photographique. Nous en discutons avec ceux qui sont le plus présents depuis le début, Haby, Myriam, Mamadou, Nacer, Gustave, Sem… parce qu’ils travaillent au foyer ou y sont revenus depuis notre arrivée. Pas de photographies des visages, juste de l’espace parcouru quotidiennement. Nous voulons voir la ville par-dessus leur épaule. Ils seront nos guides. Les rendez-vous sont pris, avec pour point de départ et d’arrivée, le foyer. 8h00 (parfois plus tôt, pour ceux qui travaillent), 18h30. Sous leurs pas, une autre carte se dessine. Les trajets en bus, en métro, en RER, à pieds, aimantés par la crainte du contrôle d’identité, la nécessité de ne pas se faire remarquer. Les arrêts contraints, obligatoires, avec le plus souvent pour point commun une file d’attente et son corollaire, un numéro, un document, une preuve à présenter. Un même « manège » s’y répète souvent, fait d’attraction et de répulsion, quand bien même il s’agit de lieux d’aide ou d’accueil. Quelques point-ressources dans des espaces ordinaires, mais souvent détournés de leur fonctionnalité habituelle. Ce peut être une bibliothèque, un cybercafé, un taxiphone, un simple kiosque à journaux… Comme au foyer, de nombreuses régions du monde s’y croisent. Des « lieux-frontières » qui rassemblent des vécus similaires, des personnes aux prises avec les mêmes difficultés, mais qui en même temps les séparent du reste de la ville. Pas forcément cachés, mais toujours invisibles dans leur fonctionnement ou les effets qu’ils produisent. Tous marquent une présence paradoxale. Ceux qui les subissent ou les utilisent sont bien là, dans cette ville, mais les signes se multiplient pour rappeler l’illégitimité de leur présence, son caractère exceptionnel. Matérialité complexe faite de comportements et de mentalités, de règlements et de documents administratifs, d’architectures, de barrières, d’horaires d’ouverture et de fermeture… Comme ici de retour au foyer, où les horaires du lieu s’imbriquent avec tous les autres. C’est cet enchaînement qui est sans doute le plus invisible, parce qu’entièrement impliqué dans le rapport entretenu avec ces différents lieux ordinaires, publics ou institutionnels. Point de contact entre des stratégies de vies, de résistance, de réappropriation de la ville, et les obstacles qui s’y opposent. Cet espace est pourtant réel, même s’il n’est perceptible qu’à travers le corps de ceux qui le pratiquent. Le « retour » au foyer a tendance à s’y dissoudre, simple coordonnée dans cette géographie de la mobilité contrainte. Sa fonction d’accueil y apparaît toute relative et ambivalente, puisque la logique humanitaire fait moins rupture qu’elle n’accompagne un processus de mise à l’écart, décidé ailleurs, politiquement. À l’intérieur du foyer, c’est encore l’extérieur, un espace hors des temps et des lieux communs, au seuil de la vie ordinaire.
Chaque soir, dans les murs du foyer, deux cartes se rejoignent et se superposent : celle des trajets faits de milliers de kilomètres et celle des parcours quotidiens dans Paris et sa banlieue. Comme s’il s’agissait d’une seule et même carte, décrivant un seul et même « pays » [5]. Celui de tous ceux qui sont un jour partis et ne sont pas vraiment arrivés quelque part. En s’attachant au seul point de vue de ceux qui trouvaient ici refuge, ce sont les ramifications de ce pays que nous avons cherché à rendre sensibles, une certaine expérience du monde. Chaque fois selon une prise de parole différente, un geste documentaire particulier mené depuis le foyer [6].
Collectif Précipité, janvier 2007.
NOTES
[1] Magume, film réalisé par Joachim Gatti et Jean-Baptiste Leroux, dans le cadre d’un projet d’atelier documentaire mené au Burundi en 2001.
[2] Office français de protection des réfugiés et apatrides.
[3] C’est après-coup que nous avons appris qu’Emmaüs intervenait publiquement sur l’accueil de populations étrangères dans ses structures. Cette question a par exemple fait l’objet d’un colloque organisé en janvier 2003 par Emmaüs France, « Droit d’asile dans une perspective européenne », où l’on apprend qu’une commission immigration a été créée.
[4] Centre d’accueil pour demandeurs d’asile.
[5] Dans son livre, Aux bords du monde, les réfugiés, l’anthropologue Michel Agier emploie cette expression pour qualifier la situation de l’ensemble des personnes déplacées aujourd’hui dans le monde.
[6] En juillet 2003, ce travail a fait l’objet d’une installation documentaire présentée pendant deux semaines dans le réfectoire du foyer, exceptionnellement ouvert sur la rue.
 Fil des publications
Fil des publications
 liste des ouvrages
liste des ouvrages

