novembre 2016
Frédéric NeyratLa part inconstructible de la Terre
Critique du géo-constructivisme
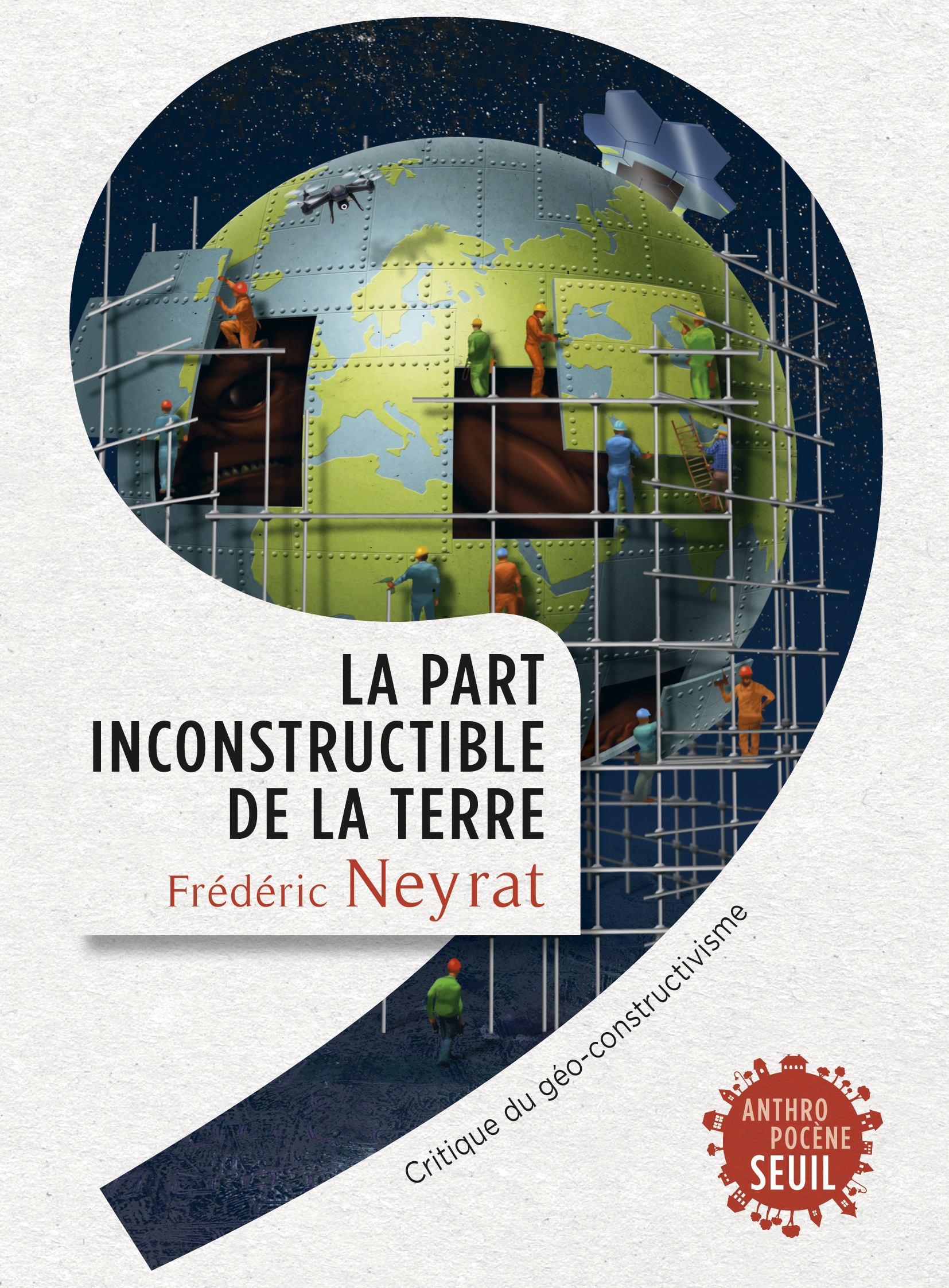
à lire sur Terra
Introduction
Editions Seuil
www.seuil.com
Frédéric Neyrat
LA PART INCONSTRUCTIBLE DE LA TERRE
Critique du géo-constructivisme
378 p. mars 2016, ISBN 978.2.02.129648.8
présentation de l'éditeur
La conquête de l’espace est terminée ? Non, une nouvelle planète est apparue : la Terre. Ce livre nous fait entrer dans le monde inquiétant des apprentis-sorciers et des puissants businessmen qui rêvent d’une Terre post-naturelle qu’on pourrait reconstruire et piloter grâce aux prouesses d’une ingénierie absolue. Frédéric Neyrat nous conduit au cœur de la pensée constructiviste qui domine aujourd’hui les sciences humaines et sociales, de Philippe Descola à Bruno Latour. Ce courant a abattu la césure nature-culture pour la remplacer par une nature hybride, toujours anthropisée et intégrée dans les réseaux technico-financiers. Et si, en déniant toute altérité à la nature, cette approche n’était que le prêt-à-penser du projet géo-constructiviste d’une Terre 2.0 ? Réinterrogeant le rapport nature-culture, et critiquant le mythe fusionnel de toute-puissance technologique, l’auteur propose alors une nouvelle philosophie de la nature et de la Terre : une écologie de la séparation, en prenant acte de ce qui n’est pas constructible dans la nature et en reconnaissant la Terre dans sa singularité.
Mots clefs
TABLE
Introduction. Refaire la Terre 9
Un nouveau grand récit, 10. — Technologie d’un monde sans nature, 13. — Reformater la Terre : la machine de pilotage, 19. — Les fondements théoriques de l’éco-constructivisme, 25. — Du paradoxe de l’Anthropocène à l’écologie de la séparation, 33. — Du multinaturalisme à l’antiproduction, 37. — Éloge de l’inconstructible, 42.
Frédéric Neyrat
LA PART INCONSTRUCTIBLE DE LA TERRE
Critique du géo-constructivisme
Pour les amis qui persistent à vivre.
Introduction
REFAIRE LA TERRE ?
« Que nous vivions sur Terre et que nous soyons capables de voir les étoiles – que les conditions nécessaires à la vie n’excluent pas celles qui sont nécessaires à la vision, et vice versa – est un concours de circonstances hautement improbable. »
HANS BLUMENBERG, La Genèse du monde copernicien.
« Vous n’avez pas voulu voir le visage de l’Inconnu ; vous verrez son masque. »
VICTOR HUGO, Préface de mes œuvres et post-scriptum de ma vie.
Un nouveau grand récit
La conquête de l’espace est terminée ? Non, on vient tout juste de découvrir une nouvelle planète : la Terre. Une Terre qu’on pourrait refaire et piloter grâce aux prouesses d’une ingénierie absolue. Au discours vorace qui fait de la Terre la proie consentante d’une conquête intégrale, nous donnerons le nom de géo-constructivisme.
Agrégeant différentes lignes philosophiques, économiques et scientifiques, le géo-constructivisme s’affirme à la croisée de plusieurs discours : celui d’ingénieurs et d’architectes qui aimeraient transformer la Terre en machine pilotable ; de biologistes croyant qu’il est préférable de ressusciter des espèces disparues plutôt que de protéger celles qui existent encore ; de politologues donnant les recettes d’une gouvernance globale ; de businessmen considérant les changements climatiques comme un nouveau marché ; de géographes enchantés par la puissance de l’humanité à l’ère de l’Anthropocène ; de sociologues et d’anthropologues arguant qu’il n’y a pas de monde commun et qu’il nous faut en composer un ; d’essayistes faisant la promotion du nucléaire pour tous ; de prophètes annonçant la mort de la nature ou la naissance du transhumain ; de philosophes nous invitant à accélérer notre mainmise technologique sur la société ; d’écologistes paradoxaux vantant les mérites de la fracturation hydraulique et rêvant la disparition de toute écologie à caractère politique. Comment s’est formé un tel discours ? Comment expliquer son emprise grandissante, son irrésistible hégémonie ? Quels en sont les principaux porte-voix ? Et quel est son avenir ?
Le géo-constructivisme n’est pas une théorie compacte, solidement et définitivement unifiée. Comme tout discours à vocation hégémonique, le géo-constructivisme connaît des contradictions, des points de fuite et des ambiguïtés. Afin de déplier cette hétérogénéité interne, ce livre propose une enquête philosophique d’abord empirique, qui s’intéressera au concept d’Anthropocène dans ses rapports aux projets récents d’ingénierie solaire (la fabrication d’un bouclier chimique contre le rayonnement solaire), de biologie de synthèse (création d’organismes aux caractères nouveaux ou améliorés), et d’intendance de la Terre (« Earth stewardship »). Puis nous décrypterons la forme de pensée de l’écologie compatible avec ces projets, avant de proposer pour finir une conception alternative de la nature et de notre relation avec la Terre. Ce passage progressif de l’empirique au spéculatif nous permettra d’analyser sous différents aspects le fantasme fondamental qui se tient au cœur du géo-constructivisme : il soutient que la Terre, et tout ce qu’elle contient – écosystèmes et organismes, humains et non-humains –, peut et doit être reconstruite, réformée et reformée. Entièrement.
Si la Terre peut soi-disant être reconstruite, c’est dans la mesure où les géo-constructivistes considèrent que la nature, comme force et entité indépendante, a été dépassée par le pouvoir techno-industriel de l’humanité ; si elle doit l’être, c’est parce que telle serait la seule manière de régler les problèmes environnementaux : le projet de « reconstruction générale du monde » (Michel Tibon-Cornillot) serait un projet d’intérêt écologique général [1]. Comme l’écrit Mark Lynas, qui résume ainsi parfaitement cette doctrine dans un livre publié en 2011 et intitulé The God Species : Saving the Planet in the Age of Humans (« L’Espèce divine. Sauver la planète à l’âge des humains »), « ce n’est plus la nature qui fait fonctionner la Terre, c’est nous. Désormais, nos choix déterminent ce qui arrive [2] ». La thèse de notre ouvrage est que cette doctrine, aussi fantasmatique soit-elle, est sur le point de constituer un nouveau grand récit, le mythe nouveau de notre temps : non pas une fiction sans conséquence, mais tout au contraire un discours susceptible de légitimer des choix économiques, des pratiques sociales, des modes de vie, des lois, des institutions, des orientations de civilisation. Que nous dit le grand récit géo-constructiviste, quelle est son inquiétante promesse ? Il nous dit : bien entendu, le monde est en proie à des périls écologiques, mais n’oublions pas que ces périls ont été causés par l’humanité et non pas par quelque obscur destin ; loin d’en tirer quelque culpabilité, il nous faut tout au contraire tirer profit de cette puissance tellurique. Si nous avons fait du mal à la Terre, c’est que nous avons eu le pouvoir de le faire. Nous avons mal fait la Terre ? Réparons-la, reprogrammons-la – reconstruisons-la !
Technologie d’un monde sans nature
Voici la prouesse du géo-constructivisme : être capable de recycler le projet de la modernité scientifique, celui consistant à devenir « comme maîtres et possesseurs de la nature » (Descartes), tout en prétendant résoudre les désastres environnementaux intrinsèquement liés à ce projet de conquête. Pour reprendre les concepts proposés par Ulrich Beck, le géo-constructivisme se présente comme un discours réflexif qui, ayant analysé et dépassé les erreurs de la première modernité (fondée sur l’idée de progrès), aurait su prendre en considération les critiques écologistes et les risques engendrés par les technologies industrielles [3] . Mais le rêve d’une « société absolument moderne » [4] s’est transformé en situation absolument cauchemardesque. Contrairement aux espoirs de Beck, la réflexivité n’a pas accouché d’une véritable critique écologiste de la modernité, elle a plutôt renforcé son projet inaugural sans l’améliorer, sans le purger de son défaut originaire – son anthropocentrisme conquérant, que celui-ci soit technologique (la mainmise sur une nature démise de sa puissance) ou culturel (la décision humaine, trop humaine, relative au partage contingent entre le naturel et l’artificiel), c’est-à-dire son incapacité à s’ouvrir à l’univers. En ce sens, les géo-constructivistes sont hypermodernes, plus modernes encore que Bacon et Descartes. En effet :
1. Ils intègrent, explicitement, les dangers techno-industriels. Nous ne savons pas que nous sommes des apprentis sorciers, que nous produisons de la destruction, soutenait Günther Anders en 1966 [5] ; désormais ce savoir est intégré comme la simple composante d’un savoir supposé supérieur : les sorciers seraient, comme par magie, passés du stade d’apprentis à celui de maîtres.
2. Les géo-constructivistes ne cherchent pas à conjurer ces dangers par une autolimitation de la puissance d’agir industrielle et technologique, mais par un surcroît de modification anthropogénique. Le géo-constructiviste sait qu’il joue avec les possibles, et que son intervention provoquera des faits inattendus, il est l’apprenti sorcier qui tient sa baguette magique d’une main de maître ; mais cela le confirme dans son appétit de transformation. Pour paraphraser une formule de Hölderlin, la croyance géo-constructiviste peut se formuler ainsi : là où croît le danger de l’industrie des nanoparticules, des champs d’OGM et des AGM alimentaires, du nucléaire, de la biologie de synthèse et de l’amélioration artificielle du climat, croît aussi ce qui sauve [6]. En ce sens, la promesse fondamentale du géo-constructivisme n’est plus le progrès (à la manière d’un Saint-Simon au XIXe siècle), mais la survie de l’humanité : le progrès est désormais le bénéfice secondaire d’un programme de sauvetage planétaire.
Disons-le d’emblée, ce livre n’est pas une dénonciation des technologies en général, au nom d’un retour à quelque pure nature. Notre perspective consiste à analyser la manière dont la conception de la nature, qui est au cœur du programme géo-constructiviste et de son horizon hypermoderne, est intimement corrélée à la possibilité technologique qu’il cherche à actualiser. Cette corrélation pourrait s’énoncer ainsi : le programme géo-constructiviste consiste à privilégier les technologies qui tiennent la nature pour rien. Comme « les conditions qui soutiennent la vie humaine ne sont pas naturelles et ne l’ont jamais été », comme « l’idée que les humains doivent vivre dans le cadre des limites environnementales naturelles de notre planète dénie la réalité de toute notre histoire », la conclusion d’Erle Ellis, professeur de géographie à l’université de Maryland, est implacable, et parfaitement géo-constructiviste : « l’environnement sera ce que nous en ferons » [7]. La nature est ici posée d’emblée comme un non-être, incapable de perturber de quelque manière que ce soit le programme de modification anthropogénique des environnements. La thèse centrale du géo-constructivisme n’est donc pas « naturaliste », c’est-à-dire – comme l’a analysé Philippe Descola – fondée sur un dualisme des humains et des non-humains, mais plutôt anaturaliste : sans nature, aveugle sur celle-ci [8]. L’optique anaturaliste du géo-constructivisme ne tend pas à séparer deux mondes (celui des humains et celui de la nature), mais à dénier l’existence de l’un d’entre eux, à l’effacer. Or, un déni n’est pas une séparation, qui reconnaît la différence entre deux termes, mais le refus de reconnaître l’un des deux termes d’une relation au profit de la seule identité de l’autre terme. Pour les promoteurs de l’anaturalisme, seule existe – c’est-à-dire seule doit exister – la technologie : vous lirez de nombreux écrits sur la « fin de la nature », mais quiconque annoncerait la fin de la technologie serait immédiatement enfermé dans un hôpital psychiatrique.
Avec Paul Feyerabend, on pourrait certes faire remonter à Parménide l’origine philosophique de la dénaturalisation de la nature : abstraite, homogène, loin de toute expérience, la nature selon Parménide semble déjà bien expurgée de ce qui pourrait la rattacher fermement au monde des vivants [9]. Pourtant, la nature demeure un modèle pour le paradigme antique, comme l’atteste cette célèbre formule d’Aristote : « L’art (technè) achève pour une part ce que la nature est incapable d’effectuer, et pour une part l’imite . [10] » Mais les monothéismes sauront, en substituant Dieu à la nature, dévaluer cette dernière, lui ôter sa puissance, préparant ainsi le terrain à la science nouvelle du XVIIe siècle : la nature devient une matière inanimée, mathématisable, sur laquelle s’applique un façonnement humain qui tend à repousser toujours plus loin les limites du possible, à transformer l’impossible en possible. L’anaturalisme assure dès lors son emprise sur Terre. Avec l’hypermodernité géo-constructiviste, c’est l’idée même de nature qui disparaît au fur et à mesure que s’y substituent des entités artificielles dont l’objectif est d’intégrer, digérer et reprogrammer toute altérité naturelle. La nature se fait « biodiversité », « prestations de service » (l’apport en eau, la pollinisation, etc.), « ressources » – marchandises [11]. L’anaturalisme apparaît dès lors clairement comme la condition de possibilité ontologique de technologies dont le but est de remplacer la nature. Le but de ces technologies de substitution n’est pas seulement de conquérir la nature, mais de la refaire en subtilisant sa puissance propre.
Insistons sur ce verbe : refaire peut signifier modifier (comme dans le cas des organismes génétiquement modifiés – OGM) ; trouver un substitut (comme un utérus artificiel ) [12] ; ou considérer que la forme de vie humaine et son corps obsolète doivent être supplantés par des « transhumains » ou des « posthumains ». Modifier, substituer et supplanter sont à l’œuvre dans la manière dont le géo-constructivisme envisage de refaire la Terre. Afin de mieux comprendre la façon dont le géo-constructivisme a traduit pour son propre compte la passion du refaire qui prolonge le projet de conquête moderne, lisons ce qu’annonçait Lewis Mumford en 1966 :
Notre époque est en train de passer de l’état primitif de l’homme, marqué par son invention des outils et des armes dans le but de parvenir à la maîtrise des forces de la nature, à un état radicalement différent dans lequel il aura non seulement conquis la nature, mais se sera détaché aussi loin que possible [nous soulignons] de l’habitat naturel. Avec cette nouvelle « mégatechnique », la minorité dominante créera une structure super-planétaire uniforme, enveloppant tout, conçue pour fonctionner automatiquement [13].
Voici se dessiner une étrange topologie : tout se passe comme si les géo-constructivistes se considéraient comme en dehors de la Terre, sans relation vitale avec l’écosphère, détachés aussi loin que possible de l’objet Terre à reformater. C’est de cette position extraplanétaire imaginaire que les géo-constructivistes méditent de produire une « structure super-planétaire » pour les heureux élus qui pourraient la contrôler. Refaire la Terre permettrait alors de réaliser activement le fantasme que Teilhard de Chardin voyait comme un destin inéluctable : le passage de la biosphère à la « noosphère », l’« Humanité planétisée », c’est-à-dire la sphère de l’esprit humain qui, grâce à sa globalisation technologique, serait capable de s’arracher matériellement et spirituellement à une vie organique jugée dépassée dans l’échelle de l’évolution [14]
Si notre analyse est juste, il s’ensuit que la pensée contemporaine de l’écologie et l’approche anthropologique qui l’accompagne doivent cesser de s’interroger sans fin sur les dualismes nature/technologie ou nature/culture, les grands partages attribués aux modernes occidentaux et les moyens de les dépasser grâce à plus d’hybridations, plus de transformation ou plus d’interactions. Il ne s’agit pas de « desserrer l’étau » du dualisme [15], mais de contester cette catégorie. Parler de dualisme, c’est faire croire qu’il y a du deux, alors que ce qui est en jeu est la disparition de l’un des termes nommés dans le prétendu partage. Croire qu’il y a du deux lorsqu’il n’y en a pas – croire qu’il y a du sauvage et de l’artificiel lorsque le premier disparaît sous un déluge de béton [16]– est faire le jeu de l’Un, c’est-à-dire de la domination. En définitive, la question n’est pas seulement éthique ou philosophique, mais d’abord politique : est-il possible, oui ou non, de cesser de participer à l’extension de l’empire d’un monde sans nature, à l’entreprise d’éradication intellectuelle et matérielle de toute altérité à l’expérience humaine ? Est-il possible d’aller non pas au-delà des dualismes et des grands partages, mais en deçà du grand déni ? Comme le note Eduardo Viveiros de Castro, « parce que les Européens pensaient que l’Amérique était un monde sans hommes, les Indiens sont devenus des hommes sans monde » : leur monde a été détruit par les Modernes [17]. Mais avec l’hypermodernité géo-constructiviste, le grand déni devient religion planétaire, et l’approche constructiviste de « l’humanité-sans-monde » s’applique tendanciellement à tout le monde [18]. Sortir du grand déni s’avère dès lors un enjeu majeur de l’écologie politique contemporaine.
Reformater la Terre : la machine de pilotage
Pour comprendre concrètement ce qu’est le dispositif nature-technologie lié au programme géo-constructiviste, la première partie de ce livre commencera par s’intéresser à l’un de ses projets les plus emblématiques : la géo-ingénierie, et plus spécifiquement l’ingénierie climatique, autrement dit la tentative de contrôler le climat par l’entremise de son optimisation technologique. Dispositif hyper-cartésien de maîtrise et possession consistant à refaire la nature terrestre, l’ingénierie climatique est le miroir dans lequel aimerait se reconnaître l’Anthropocène – époque où, nous dit-on, nous répète-t-on jusqu’à l’insolation, l’espèce humaine serait devenue, ô merveille !, une « force géologique majeure ». Nous étudierons dans cette première partie les liens qui unissent le discours dominant de l’Anthropocène et la géo-ingénierie. Car ce n’est tout de même pas un hasard si Paul Crutzen, co-inventeur avec Eugene Stoermer du mot Anthropocène, évoquait aussi dès 2002 la possibilité de « projets de géo-ingénierie à grande échelle » dans le but d’« optimiser » artificiellement le climat – dans un article qui n’hésitait pas à se référer à… Teilhard de Chardin [19]. Et c’est le même Crutzen qui, en 2006, proposa dans un article retentissant d’envoyer des tonnes de dioxyde de soufre dans l’atmosphère afin de former un « bouclier » chimique capable de nous protéger du soleil et par conséquent de refroidir la planète [20]
N’allons pas croire qu’il s’agit d’un simple scénario de science-fiction qui n’intéresserait que quelques scientifiques ou amateurs de films hollywoodiens. Pour s’en convaincre, il suffit de constater la manière dont les États financent de plus en plus de tels projets, l’intérêt qu’un président comme Obama et un journal aussi influent que le Wall Street Journal portent aux questions de géo-ingénierie. Comptabilisons également le nombre de colloques, d’articles universitaires et de livres grand public consacrés à cette question [21]. Même le GIEC, dans le paragraphe final de son « Résumé à l’intention des décideurs » de 2013, mentionne pour la première fois dans l’un de ses rapports la « géo-ingénierie [22]. Certains membres de célèbres associations écologistes « mainstream », tel le WWF, ne refusent plus désormais de compter cette technologie comme « possible [23] ». Cette « possibilité » explique sans doute pourquoi certain think tanks, qui jusqu’alors ne faisaient que dénier les changements climatiques, semblent maintenant les accepter – un nouveau marché à conquérir [24] ? La nouvelle frontière du capitalisme ? On évoque certes les dangers relatifs à de tels projets, on préfère parfois – comme l’Académie des Sciences états-unienne – parler d’« intervention climatique » plutôt que de géo-ingénierie (ce terme étant par trop attaché à l’idée d’un contrôle climatique jugé hors de portée) [25] ; mais cela n’empêche aucunement l’augmentation du nombre d’études relatives aux réglementations nationales et internationales qui devraient – éventuellement – encadrer cette géo-technologie [26]. Objet technologique, juridique, économique, social et environnemental, le bouclier climatique est le prétendu « plan B » que certains aimeraient voir passer au statut de « plan A » pour lutter contre les changements climatiques. Un plan B dont les promoteurs connaissent les dangers, mais telle est la nouvelle doctrine technologique des géo-constructivistes : non pas l’utopie d’un progrès constant, mais le pragmatisme d’un sauvetage nécessitant de (faire) prendre des risques.
Au cours de cette première partie, il apparaîtra que la représentation de la Terre qui prévaut chez les géo-constructivistes est celle d’une boîte creuse que l’on peut reformater à volonté. Les dynamismes de la nature terrestre sont reconnus seulement lorsqu’il s’agit de légitimer un reformatage : on qualifie de dynamique un processus biosphérique qu’on s’apprête à remodeler, puis à savamment piloter, en fonction des impératifs économiques du moment. Autrement dit encore, les dynamismes naturels sont les arguments qui permettent de mettre en boîte la Terre. Imaginairement, le géo-constructiviste se représente comme une sorte d’agent hors-bord, hors du monde, un scaphandrier aux pouvoirs démiurgiques refaçonnant la Terre de l’extérieur. Il réalise ainsi la vision de Richard Buckminster Fuller, le fameux architecte et designer inventeur américain des années 1950-1970, qui baptisa la Terre du nom de « vaisseau spatial » : « Nous sommes tous des astronautes et nous n’avons jamais été autre chose . [27] » Or, cette métaphore a de fait une double signification : ce n’est pas seulement que les êtres humains sont envisagés comme des extraterrestres ; c’est aussi que la Terre est vue non pas comme le berceau de l’humanité, mais comme une sorte d’expo-planète qu’il faudrait « terraformer ». Issue de la littérature de science-fiction, l’idée de « terraformation » signifie d’abord l’action consistant à modifier délibérément une autre planète afin de la rendre similaire à la Terre, et par conséquent habitable par des êtres humains ; mais c’est désormais la Terre que l’on voudrait transformer à notre convenance : l’Anthropocène a hérité de l’imaginaire de l’époque de la conquête spatiale et de ses ambitions de colonisation extrasolaire [28]. En effet, tout se passe comme si, pour employer le terme anglo-saxon qui désigne la période de la conquête spatiale (Space Age), la fin de l’âge de l’espace avait coïncidé avec la promotion de l’âge de l’Homme. On parle certes aujourd’hui d’un « plan C » qui consisterait à fabriquer un « vaisseau vivant » capable d’extirper l’humanité d’une planète moribonde et de lui trouver une planète d’accueil [29]. Mais cet imaginaire n’est pas celui d’une colonisation virile ; plutôt celui d’un revival – c’est le cas de le dire – des années 1950, une spéculation quant à des surlendemains alternatifs. Une fois abandonnée, ou tout du moins repoussée sur le très long terme, l’éventualité d’une colonisation de la Lune ou de Mars, c’est la Terre elle-même qui est devenue l’objet d’un projet de colonisation technologique. Désormais, la frontière du capitalisme n’est plus un au-delà rêvé dont les Spoutnik et les Apollo marquaient les premières bornes, elle est l’ici-bas laissé aux mains des géo-constructivistes et de leurs alliés bio-constructivistes : marchandiser l’atmosphère et titriser la planète (finance verte), artificialiser et piloter le climat planétaire (géo-ingénierie), refaire la vie et les conditions du vivant (biologie de synthèse), tels sont les fronts avancés du retournement de la frontière sur le corps de la Terre.
Après avoir décrypté la fondation imaginaire du projet et des dispositifs géo-constructivistes, il sera possible de comprendre la fonction précise des concepts de « pilotage » ou d’« intendance de la Terre » (Earth stewardship). Notion aujourd’hui proliférante dans la littérature scientifique sur l’environnement, l’intendance de la Terre situe la science comme ce qui doit faciliter la gestion concertée des changements socio-écologiques en vue du bien-être des humains et de leur résilience. Distinct en apparence du volontarisme géo-constructiviste, le concept de pilotage (de la biodiversité, des environnements, etc.) laisse entendre que les humains ne feraient que diriger des dynamismes, sans être vraiment capables de les maîtriser. Par leur apparence soft, coopérative, porteuse d’une morale du respect, les concepts d’intendance et de pilotage ont la fâcheuse tendance à nous faire oublier les technologies qui les rendent possibles : qu’est-ce, en effet, qu’une intendance qui s’appliquerait à des environnements modifiés par l’ingénierie climatique et ayant en vue le bien-être humain, si ce n’est le self-service de l’âge des humains ? D’ailleurs, le concept de pilotage s’applique d’abord à une machine : le pilotage d’une machine fait suite à la production de ce qu’on pourrait nommer la machine de pilotage, autrement dit la mégamachine technique, sociale, économique et politique, qui sous-tend toute intendance, toute gouvernance de l’écosphère. On pourrait dès lors définir l’Anthropocène comme un grand récit cherchant à légitimer la mise en place d’une machine de pilotage globale : sa politique s’adosse aux pouvoirs des ingénieurs, et son fantasme est la possibilité d’une terraformation intégrale.
Les fondements théoriques de l’éco-constructivisme
On comprendra dès lors pourquoi, aux États-Unis d’abord, certains think tanks et entreprises refusent de reconnaître l’origine anthropique des changements climatiques et en appellent à la géo-ingénierie. En effet, l’ingénierie climatique est censée permettre de continuer à brûler allègrement les énergies fossiles et de maintenir ainsi le même type de développement, le même genre de société, la même domination organisée par les militants du programme géo-constructiviste [30]. Mais comment se fait-il que de nombreux supposés écologistes puissent eux aussi épouser de telles idées ? La seconde partie de cet ouvrage voudrait montrer ceci : la pensée de l’écologie est aujourd’hui dominée par un courant éco-constructiviste de moins en moins apte à contester la position anaturaliste et la géo-ingénierie, et de plus en plus opposé à toute écologie politique véritablement contestataire. Dire que cet éco-constructivisme, élaboré dans les sciences humaines et sociales et l’écologie scientifique, est de plus en plus compatible avec le projet géo-constructiviste ne signifie nullement que la pensée de l’écologie a toujours été constructiviste, ni que toute pensée de l’écologie ou toute philosophie de l’environnement est désormais constructiviste. Mais nous constatons à quel point l’éco-constructivisme innerve désormais les débats – du marxisme vert à l’éthique environnementale, en passant par les pensées de Gaïa et le pragmatisme de la composition des mondes – et en ce sens impose son hégémonie. Identifier sous le nom d’éco-constructivisme la pensée dominante de l’écologie est le moyen que nous voulons utiliser pour fonder une nouvelle écologie politique résolument anticonstructiviste.
L’éco-constructivisme se situe au croisement de plusieurs lignes.
A. D’un point de vue historique, la racine de l’éco-constructivisme est l’écologie de la résilience. Née dans les années 1970, cette théorie est fondée sur l’affirmation de l’instabilité ontologique des écosystèmes et le rejet de toute idée de nature équilibrée ou stationnaire.
B. Le tronc de l’éco-constructivisme est composé par les approches que défendent les éco-modernes, ces post-environnementalistes qui professent la mort de l’environnementalisme [31], fustigent toute volonté protectrice consistant à soustraire des espaces et des formes de vie à la quête de croissance et de profits, rejetant toute idée de mettre des limites aux altérations et aux artificialisations anthropogéniques [32]. À ce titre, il nous faudra montrer que les constructivistes soi-disant « non modernes » et parfois certains écologistes « pragmatistes » sont souvent d’accord avec les options ontologiques fondamentales des éco-modernes [33].
C. Enfin, l’éco-constructivisme est très clairement porté à son paroxysme et à sa plus grande vérité par certains surgeons hors sol tels les très en vogue accélérationnistes qui, reconnaissant la pertinence des enjeux climatiques, en appellent à une « politique prométhéenne de maîtrise maximale sur la société et son environnement [34] », ainsi que certains courants transhumanistes qui, tout en étant conscients des risques d’extinction de l’espèce humaine, rêvent de formes de vie posthumaines. Une racine, un tronc, des pousses étranges – mais quels sont, d’un point de vue conceptuel, les points communs ou plutôt les champs de force qui informent le domaine éco-constructiviste ?
1. Tout d’abord, une proclamation euphorique de la mort de la nature. C’est l’un des traits distinctifs des éco-constructivistes, et – au-delà de la question écologique – de tout constructivisme : il n’y a pas de nature et par conséquent comme l’écrit Emilie Hache "il n’y a pas de monde commun" [35]. Pour les éco-constructivistes, rien n’est donné, tout est processus et, en ce sens, tout est constructible. Conséquence inévitable : le monde est à faire et à refaire, sans cesse. Loin d’être considérée comme une mauvaise nouvelle, la mort de la nature est célébrée dans la mesure où elle permettrait de frapper de nullité les supposées tristes idées de limite naturelle ou de finitude que le mouvement environnementaliste s’acharne à défendre. Emporté par sa passion anaturaliste, l’éco-constructivisme ne voit pas que le meurtre de la nature est une pratique aussi vieille que le dit « Occident ».
2. Ensuite, la prise en considération de l’« incertitude » comme nouveau dieu caché. Pour éclairer ce point, nous nous intéresserons de près au concept de résilience tel qu’il a été forgé dans les années 1970. L’idée fondamentale de ce que nous nommerons l’écologie de la résilience est la suivante : loin d’être une damnation, l’instabilité ontologique des écosystèmes, la « turbulence » du monde, est la réserve dans laquelle les organismes et les sociétés peuvent puiser afin de s’adapter à de nouvelles situations, de se transformer, et donc de survivre [36]. Il est certes important de reconnaître les apports réels des théories qui insistent sur la précarité ontologique du monde. Ilya Prigogine et Isabelle Stengers [37] – et Alfred North Whitehead avant eux [38] – ont soutenu que la tradition occidentale a cherché à conjurer le chaos, le désordre, le déséquilibre, à les mettre au second plan ; en ce sens, la réhabilitation dans les années 1970 des philosophies des flux instables (Michel Serres, Gilles Deleuze, Luce Irigaray) a été salutaire. Cependant, cette thèse ontologique a été utilisée par l’éco-constructivisme comme justification acritique du monde tel qu’il est : tout change, alors pourquoi s’opposer à quelque changement économique que ce soit ? Tout est instable, alors pourquoi demander quelque sécurité sociale, quelque assurance de la part de l’État ? Dans un tel cadre théorique, la résilience n’est autre que ce qui est exigé des individus afin qu’ils s’adaptent de force aux désastres écologiques, économiques et sociaux, sans ne jamais chercher à s’attaquer à leurs causes premières. Un rapport britannique de 2011 intitulé Migration et changement environnemental global valorisera ainsi les migrations non pas comme une malchance, mais comme moyen d’augmenter la capacité des individus (et non des collectifs) à s’adapter à un désastre environnemental, voire à l’anticiper – mieux vaut parfois migrer avant le désastre, nous dit ce rapport [39]… On voit immédiatement qu’une telle idée est en phase avec l’ingénierie climatique, qui est une manière de répondre au symptôme climatique sans ne jamais chercher à toucher aux causes – sociales, économiques, politiques – de ces changements [40]. La turbulence du ciel anthropogénique a remplacé le destin insondable que les dieux au-delà du ciel infligeaient naguère aux hommes.
3. Puis, répétée comme un mantra, l’idée selon laquelle tout est interconnecté. C’est ce que nous nommerons le principe des principes de l’écologie. De Ernst Haeckel à James Lovelock et Isabelle Stengers en passant par John Muir, Aldo Leopold, Barry Commoner et Arne Næss, la pensée de l’écologie sous tous ses aspects s’est très légitimement fondée sur ce principe en vue de combattre le déni de relation – entre les humains et leur environnement, la raison et le corps, la révolution industrielle et ses prétendus dommages collatéraux – sur lequel s’est bâtie l’époque moderne. Mais, secondée par les réseaux télé-technologiques qui enserrent le monde, la notion d’interconnexion constitue aujourd’hui une sorte de piège théorique, économique et politique qui s’énonce ainsi : puisque tout est en réseau, relié, interconnecté, alors plus aucune distance n’est possible par rapport au monde dans lequel nous vivons, donc acceptons le monde tel qu’il est, avec sa turbulence ontologique ; soyons pragmatiques, et prenons soin de notre résilience. Interconnexion et incertitude sont les deux faces d’une même approche du monde : comme tout est relié, on ne sait jamais jusqu’à quel point un phénomène peut se propager ; comme les frontières du monde sont incertaines, les relations entre les choses sont toujours plus consistantes – plus perméables, plus contagieuses – qu’on ne l’aurait cru.
4. Enfin une foi indéfectible dans la modernité technologique. Les éco-constructivistes croient dur comme fer dans la modernité et ses vertus technologiques. Bien entendu, la modernité des « éco-modernes » n’est pas de premier degré, elle se veut « réflexive », et le progrès qu’elle promeut est devenu sensible aux « risques » et aux « conséquences inattendues » qui toujours surviennent dans un « monde incertain ». Pourtant, cela n’empêche en rien les éco-constructivistes de partager, avec les géo-constructivistes, une même passion pour les dernières trouvailles de la techno-industrie capitaliste. Nous nous attacherons plus particulièrement à la théorie développée par Bruno Latour, dans la mesure où celui-ci est l’une des figures majeures de l’éco-constructivisme, et au vu de son influence notable quant à l’édification institutionnelle du discours aujourd’hui hégémonique sur l’écologie. En effet, Latour déclare qu’il n’est pas moderne ; nous tenterons pourtant de montrer que son rapport aux technologies et sa position anaturaliste font de lui un penseur profondément moderne. Encore faut-il s’entendre sur ce terme : Descartes, Galilée, Bacon constituent la modernité scientifique à partir d’une rupture méthodologique par rapport aux formes de connaissance rétroactivement nommées prémodernes, mais cette modernité est aussi en continuité fantasmatique avec les vœux prémodernes. Est moderne celui qui cherche l’élixir de longue vie avec la science de Descartes. En effaçant la coupure méthodologique moderne/prémoderne tout en maintenant une foi sans réserve dans l’élixir technologique, la sociologie de la « composition » des mondes a laissé déferler dans la théorie contemporaine un flux d’affects prémodernes, para-alchimiques, où les « agencements » de non-humains et d’humains s’attachent à chanter la gloire de la technicité globale, du capitalisme qui la sous-tend, et du consumérisme qui l’accompagne. C’est en effet qu’il ne suffit pas d’expliquer que les phénomènes sont hybrides pour contester la modernité anthropocentrique : encore faut-il aussi montrer que les hybridations ne sont pas seulement l’effet des pratiques et des technologies humaines. Avec Latour et ses alliés post-environnementalistes, nous sommes condamnés à renforcer la modernité et l’accentuer jusqu’à son point hypermoderne. À ce titre, est hypermoderne celui qui pense que la vie la plus longue concerne moins les humains que leurs successeurs dénaturalisés – quelque humanité « planétisée », ou quelque « Anthropos » plongé « dans une époque à la fois postnaturelle, posthumaine et postépistémologique [41] ».
On voit bien comment ces quatre points, ces quatre champs de force que nous venons de décrire, conspirent pour former un discours consistant : il n’y a pas de nature ; donc rien n’est donné, rien n’assure d’aucune règle préalable ; c’est-à-dire tout est ontologiquement turbulent, plein de surprises, et politiquement incertain ; en ce sens, débarrassons-nous de toute idée de limite ou de séparation et de tout principe qui pourrait par avance fixer une conduite [42] ; acceptons les technologies propulsées par l’économie dominante, autrement dit « aimons nos monstres » (Latour [43]) et, de façon pragmatique, attachons-nous à observer les effets de ces technologies. C’est contre ce suivisme technologique et politique que cet ouvrage plaide pour une autre écologie théorique et politique, une écologie de la séparation. Explicitons cette expression.
Du paradoxe de l’Anthropocène à l’écologie de la séparation
Géo-constructivisme et éco-constructivisme semblent s’opposer sur un point majeur : là où le géo-constructiviste se perçoit fantasmatiquement dans la stratosphère, face à un objet Terre qu’il tente de contrôler, l’éco-constructiviste insiste fortement sur l’« interconnexion » généralisée, les « enchevêtrements » (Stengers) et les « attachements » (Latour) qui lient tous les êtres, humains compris. De fait, on trouvera parfois, dans un même livre, sous une même plume, à la fois la reconnaissance des interconnexions absolues qui nous lient à l’écosphère et dans le même temps l’affirmation d’une souveraineté domaniale par laquelle « l’Homme », « le genre humain », « l’humanité », « anthropos », ou la « culture » (humaine) affirme son droit à la reconstruction de l’écosphère, voire de la planète tout entière. Tel est le paradoxe de l’Anthropocène, celui qui hante la pensée contemporaine de l’écologie : l’humanité est à la fois a) un sujet morphogéologiquement surpuissant, extérieur aux objets-corps (le corps des animaux, des humains ou de la Terre) qu’il déclare pouvoir contrôler, piloter, etc., et b) ce qui subit sur Terre les conséquences de ses actes dans la mesure où elle est reliée aux formes de vie et aux éléments abiotiques qui constituent la planète. Prométhée enchaîné à quelque cyber-aigle, l’humanité rêve de bouclier solaire mais ne sait pas encore quelle protection thermique elle pourrait inventer pour se protéger de son brûlant bouclier.
Pour sortir du paradoxe de l’Anthropocène autrement que par la voie hypermoderne – le surcroît de modernité Hi-Tech par lequel on cherchera à maîtriser les effets négatifs de notre maîtrise –, cet ouvrage propose une autre approche de l’écologie, une écologie de la séparation. Certains pourraient voir là un nouveau paradoxe : si l’écologie est une pensée des relations, comment peut-elle promouvoir la séparation : n’est-ce pas là, précisément, la démarche cartésienne et son prolongement géo-technologique ? Il nous faut pourtant réaliser que pour sortir du paradoxe de l’Anthropocène, la pensée de l’écologie doit lutter sur deux fronts, et non pas un seul :
1. Contre le clivage sujet Humanité/objet Terre, il s’agit bel et bien de proposer une mise en relation et de montrer à quel point rien n’existe isolément : l’humanité-sans-monde n’est autre qu’une impossibilité ontologique et environnementale vouée à l’autodestruction.
2. Mais contre la démence de l’interconnexion généralisée, contre les "fusions monstrueuses" de ce que Geneviève Azam nomme l’"utopie cyborg" -fusion de l’organisme et de la technologie, donc de la nature et de l’artifice, du donné et de l’acquis, etc. [44] mais -précisons- fusion asymétrique, au profit d’un terme colonisateur au détriment d’un terme asservi.]], c’est d’une mise à distance dont nous avons besoin . L’écologie de la séparation est ce qui cherche à relier ce qui est clivé, c’est-à-dire abusivement séparé, ainsi qu’à séparer ce qui est soudé, c’est-à-dire excessivement connecté. Notre approche ne rejette pas le principe des principes de l’écologie, nous ne voulons pas définir – comme le font les « ontologies orientées-objet » qui fleurissent aujourd’hui et que nous analyserons plus loin [45] – des essences objectives immunologiquement coupées de tout réseau relationnel, mais nous voulons compliquer le principe des principes et lui injecter un contre-principe de séparation, un second principe venant transformer l’économie bien trop impériale du premier. Telle est notre thérapie ontologique.
Mais la question n’est pas seulement ontologique, elle est aussi éminemment politique. L’écologie de la séparation affirme que, sans prise de distance à l’intérieur d’une situation socio-économique, nulle réelle décision politique n’est possible, nul choix technologique n’est véritablement envisageable. Lorsque tout est déclaré continu et relié, sans faille et sans dehors, les réactions automatisées remplacent les décisions, et chaque nouvelle technologie qui surgit sur le marché saturé des environnements anthropogéniques se présente comme un destin inéluctable. Incapable de penser la séparation, l’éco-constructivisme ne peut qu’évaluer, soi-disant pragmatiquement, les effets des actions humaines dans un monde « incertain ». « Incertain » pour ceux qui ne cherchent pas à comprendre les causes, forcément contingentes, issues de décisions qui auraient pu être autres que ce qu’elles furent, qui ont conduit à l’installation du monde que nous connaissons. En ce sens, pour être vraiment politique, pour prendre en considération les dangers qui nous menacent, pour distinguer entre ce que les humains peuvent construire et ce qui ne peut pas ou ne doit pas l’être, pour savoir quel usage est encore possible du mot nature et du mot environnement, pour faire de la résilience une capacité de recul avant d’être une aptitude à la survie, l’écologie doit laisser de la place à la séparation.
Autrement dit, l’extraterritorialité géo-constructiviste est une mauvaise traduction (une caricature) de la séparation ontologique qu’exige toute relation. En effet, il n’y a relation que là où des êtres se savent incomplets, manquants, appelés par l’autre et vers l’autre ; mais cette séparation est ou bien transformée en éloignement radical, qui fonde la position d’un sujet hors-bord cherchant à vampiriser le dynamisme naturel afin de refabriquer tout ce qui est (géo-constructivisme), ou bien déniée en interconnexion absolue, qui aplatit tous les êtres et en fait des « actants » au sein de « réseaux » d’artefacts naturalisés et de nature artificialisée (éco-constructivisme). Il faut certes revenir sur Terre, mais sans tomber dans le filet d’un monde plat, rendant tous les êtres équivalents et annulant toute extériorité. Pour que le retour sur Terre ne soit pas de l’ordre d’un enterrement financé par un géo-capitalisme conquérant, il est nécessaire de métaboliser la séparation : ni un éloignement radical ni une interconnexion absolue, mais la distance intérieure grâce à laquelle l’écologie de la séparation ouvre la Terre à ses propres dehors.
Du multinaturalisme à l’antiproduction
C’est au nom de cette écologie de la séparation que nous proposerons, au cours d’une troisième partie, une autre approche de la nature. Certes, il est nécessaire de dénoncer l’idée de « pure » nature. Prenons l’exemple insigne de la wilderness, cette prétendue « nature sauvage » qui serait présente dans les parcs nationaux états-uniens : dans ces espaces quasi sacrés, il serait possible de faire l’expérience du sublime et de renouer le contact avec l’esprit pionnier, l’esprit des temps où la nature du « nouveau monde » était encore vierge. Or la wilderness est une « création humaine » (William Cronon), une construction culturelle [46]. En vérité, les pionniers n’ont jamais traversé de nature vierge : celle-ci était habitée par les natifs depuis au moins dix mille ans. En 1492, entre trois et quatre millions de personnes habitaient le territoire maintenant constitué par le Canada et les États-Unis ; mais 90 % de cette population a été décimée, du fait des maladies européennes et du traitement brutal qui leur fut infligé. Renversement total de perspective : ce qui de la nature, au XIXe siècle, apparaît vierge et bon à être transformé en parc national est en fait le résultat d’un effacement des transformations opérées par les natifs pendant des siècles [47]. D’une façon générale, il est nécessaire de se débarrasser de l’usage doctrinaire, idéologique, de la « pure » nature, lorsque celle-ci sert à justifier racisme, sexisme, et nationalisme sanguinaire [48]. Alors que la bataille pour le mariage pour tous faisait rage en France, Thierry Jaccaud, alors rédacteur en chef de L’Écologiste, qualifia le projet de loi du gouvernement de « négation sidérante de la nature » [49]. En dépit de ce type de position consternante, cet ouvrage soutient qu’il est pourtant nécessaire d’aller au-delà de la déconstruction de la nature.
En effet, cette déconstruction n’est pas seulement théorique, elle se matérialise socialement et économiquement dans les cycles incessants de déconstruction et reconstruction qui définissent désormais notre planète. Refaire est l’impératif catégorique de notre temps, un fantasme masqué devenu peu à peu programme à ciel ouvert, le labeur éreintant du Sisyphe postmoderne condamné à refaire hier ce qu’il aurait dû modifier demain. Razmig Keucheyan a raison d’affirmer que « la nature est un champ de bataille », un « théâtre [nous soulignons] d’affrontement entre des acteurs aux intérêts divergents » : il nous faut traiter les problèmes dits environnementaux sans les cliver des problèmes de classe, de genre et de race – tel est le préalable de toute justice environnementale [50]. Mais l’option artificialiste que de nombreux marxistes partagent avec les constructivistes – considérer la nature comme « théâtre », illusion idéologique, abstraction mystificatrice, etc. – est précisément l’une des formes de cécité ontologique qui conduit à occulter une part du monde. Ôter le voile idéologique de la nature est devenu un nouveau voile, celui de la toute-puissance constructiviste qui déconstruit et reconstruit sans rémission. À l’heure où l’écosphère se dégrade réellement, et pas seulement conceptuellement, il devient littéralement vital d’affirmer que la nature n’est pas seulement un champ de bataille : elle est d’abord et avant tout un champ relationnel, intensif, de vie et de non-vie, qui ne peut pas se réduire aux espaces mesurés et appareillés par les puissances humaines, qui échappe inévitablement aux définitions stratégiques qu’en proposent les combattants, qu’ils soient militaires ou compagnies d’assurances transformant les catastrophes naturelles et les épidémies en marché financier [51]
Mais que faut-il entendre par ce que nous venons de nommer un « champ relationnel, intensif, de vie et de non-vie », quelle idée de la nature est ainsi avancée ?
1. Une première solution consisterait à envisager ce champ comme une diversité de natures, une biodiversité au sens propre, qui inclurait – parmi d’autres – la nature en friche, la nature non pas pure mais redevenue sauvage par retrait des actions humaines (comme autour de Tchernobyl), la nature hybride, la nature domestiquée, les artifices naturalisés, etc. Très en vogue aujourd’hui, cette pensée de la nature en termes de diversité structurelle pourrait sembler opportune : mettant en pièces – littéralement – l’idée de Nature une, pure et substantielle, elle est accueillante, démocratique, ouverte aux singularités culturelles, y compris aux cultures qui ne semblent pas reconnaître la catégorie dite occidentale de la nature. Mais la diversité a toujours un prix : doit être conjuré tout ce qui met en péril la bonne diversité. En faisant de ce qui est sauvage un élément parmi d’autres, le multinaturalisme de la diversité en annule la portée, semblant accepter d’une main – la diversité – ce qu’il refuse de l’autre – la diversité, oui, mais moins le sauvage. Or, la catégorie de sauvage déborde par essence la place qu’on veut lui donner au sein de la diversité : ni pure nature ni herbe folle survivant aux frontières du bitume, le sauvage est le différenciant comme tel, la matrice de l’Autre, l’expression de ce qui gronde sous la diversité et génère les différentes natures ;
2. Il nous semble en effet préférable de penser la nature en termes génétiques. C’est à cela que nous invite le multinaturalisme de la différenciation de Viveiros de Castro : « théorie post-pluraliste des multiplicités », « le multinaturalisme amazonien n’affirme pas tant une variété de natures que la naturalité de la variation, la variation comme nature » [52]. Or la variation, pour de Castro, est impensable sans un processus d’actualisation du virtuel ou un devenir (pour reprendre les termes de Deleuze et Guattari utilisés par l’anthropologue), le passage d’une « superposition intensive d’états hétérogènes [53] » à des mondes distincts : le monde incorporé de ce jaguar, cette plante, cet humain. Tel que nous le restitue Viveiros de Castro, le multinaturalisme amazonien est le multivers des corps distincts qui écarte d’un côté l’humanité commune d’où tous les êtres dérivent (à l’origine, disent les mythes amérindiens, tous les êtres étaient humains) et de l’autre les entités vivantes différenciées (plantes, animaux, humains, esprits). En ce sens, la nature est le différenciant ontologique. L’objectif de la pensée de l’écologie que nous cherchons à promouvoir n’est dès lors pas de déconstruire la nature, mais de comprendre et accompagner la genèse des naturés [54]. Nous ne voulons pas combler les grands partages, mais en changer le sens : le partage, comme son double sens l’indique – ce qui distingue et ce qui rassemble –, est le différenciant commun des mondes.
Tel est le véritable enjeu : penser la nature comme genèse et non comme structure. Or, ce livre voudrait contribuer à penser cette genèse autrement qu’en termes de processus, production ou transformation, comme il est trop souvent d’usage. En effet, toute genèse enveloppe une strate antigénétique, une phase d’antiproduction, non pas une transformation d’abord, mais un retrait de forme. Au lieu de seulement chercher à savoir comment on passe de la nature comme puissance (naturante) à la nature comme objet (naturé), au lieu de ne penser la nature que comme manifestation, mise au jour, nous montrerons qu’elle est retrait, contraction, un non-apparaître qui précède l’expression des êtres et des mondes. A la différence de l’écologie machinique d’un Guattari [55] et son avatar géo-constructiviste, de l’écologie des processus et des hybrides, de l’écologie qui en définitive renforce la machine de pilotage ontologique qui sous-tend la volonté de piloter la machine-Terre, l’écologie de la séparation énonce : sans part de nuit inaugurale, pas de venue au jour ; sans sombre revers, pas de multivers, et pas de natures plurielles.
C’est cet élément sombre et retiré qui échappe fondamentalement au pouvoir de l’humanité, à Homo faber. Certes l’humanité tente de s’accaparer la puissance de la nature, la puissance naturante, elle voudrait se faire Homo naturans ; mais le naturant est toujours précédé par un élément dénaturant qui est l’im-puissance au cœur même de la puissance naturelle. Tel est le sauvage : non pas un espace privilégié, ou banal, mais une réserve universelle de déliaison sans laquelle il n’y aurait nulle différence et nulle diversité [56]. Si chaque être vivant est dépassé par son caractère sauvage, y compris les êtres génétiquement modifiés qui tendent toujours à présenter des comportements inattendus, si la nature se sépare toujours de la manière dont nous cherchons à la naturer, c’est parce que le naturant est dépassé par le dénaturant, par l’antiproduction qui précède toute production et défait, de l’intérieur, l’empire constructiviste.
Éloge de l’inconstructible
Insistons à nouveau sur ce point : l’empire constructiviste n’est pas seulement un discours, il ne concerne pas uniquement une manière spécifique de réfléchir aux « acteurs » et aux « réseaux » ou une réflexion sur la manière dont la réalité est « corrélée » à la pensée humaine. Le constructivisme que nous analysons dans cet ouvrage est un constructivisme efficient, produisant réellement le monde et incorporant les discours qui l’accompagnent ou le précèdent dans sa tentative de refaçonnement intégral de la planète. Comment contester cet empire ?
En localisant une part inconstructible, excédant en amont et en aval l’empire constructiviste. Construire vient du latin construere (cum-struere) : « entasser par couches », « empiler » et en ce sens mettre ensemble (d’où le cum latin, le co-, qui veut dire avec). Il est possible que le radical stru- vienne de °ster- : « étendre », d’où l’idée d’« entasser par couches [57] ». D’abord et avant tout, l’inconstructible est ce qui rend possible d’édifier, de bâtir ou d’entasser – une condition de possibilité qui prend le nom, en philosophie, de transcendantal : non pas ce qui est transcendant, au-delà, mais ce qui, ici-bas, porte le monde à l’être. Ainsi, quand on veut construire quelque chose, on met ensemble ; mais on ne peut mettre ensemble que des entités qui ont d’abord été considérées comme distinctes. À moins de considérer que bâtir ou édifier consiste à déformer une matière plastique continue et sans séparation. Refuser cette ontologie démente, qui est l’ontologie pâte à modeler du capitalisme, revient à affirmer que l’inconstructible est le transcendantal de toute construction, c’est-à-dire ce sans quoi il n’y aurait nulle construction possible. Or ce livre soutient que la nature, sous sa forme dénaturante, est la dimension transcendantale permettant de créer une distance grâce à laquelle il est possible de composer, de construire et de former. Penser comme une montagne, pour reprendre la célèbre idée de l’environnementaliste états-unien Aldo Leopold [58], signifie sortir de soi-même, se couper de son intérêt immédiat, se retirer en ce sens : se contracter au point de créer une sorte de dehors du monde dans le monde grâce auquel il devient possible de comprendre le contexte dans lequel on était englué. Dans un monde hyperconnecté, où la technologie sert d’abord et avant tout à communiquer, la nature devient non pas un moyen de se « reconnecter » avec quelque authentique et pure dimension de l’univers, mais tout au contraire un vecteur de distance pouvant nous permettre de nous libérer de la communication électronique à caractère viral qui enveloppe le monde [59].
C’est à partir de la catégorie d’inconstructible que nous tenterons, pour finir, de repenser notre relation avec la Terre. Tout d’abord, il est nécessaire de ne pas s’en tenir au discours officiel de l’Anthropocène, ce nouveau grand récit supposé donner sens aux futures destinées de l’humanité. Car l’humanité n’est pas une : elle est divisée entre ceux qui ont intérêt à reformater la planète et ceux qui pourraient subir les conséquences écologiquement désastreuses des manipulations du climat – tout le problème d’une écologie réellement politique étant de marquer cette division. En lieu et place du mythe moderne d’une humanité conquérante devenue consciente de son pouvoir et désormais capable d’engloutir toute la nature, nous ferons apparaître le double corps de l’Anthropocène. L’un est majoritaire, technophile sans retenue, il s’est fondé sur la position anaturaliste ; l’autre est composé de ce que nous nommerons les corps minoritaires de l’Anthropocène. Corps sacrifiés sur l’autel du progrès et de ses résidus, corps qui depuis des siècles contestent la position anaturaliste, corps récalcitrants pour qui la Terre n’est pas une boîte creuse mais un corps plein, corps qui savent que les « controverses » scientifiques sont d’abord des expériences sans scrupule sur les territoires du vivant, corps des races surexposées aux dégâts industriels dans le Grand Sud comme dans les angles à demi morts du Grand Nord, corps privilégiant les technologies « démocratiques et dispersées » centrées sur la vie contre les technologies « totalitaires et centralisées » (Lewis Mumford) [60], les corps minoritaires de l’Anthropocène forment l’alliance qui exige que la justice climatique soit rendue.
En Équateur, en Bolivie, ces corps minoritaires soulignent l’importance des capacités « régénératives » de la « Terre-Mère », et tournent celles-ci en droit ; de par le monde, ils expliquent pourquoi et comment les capacités créatrices de la Terre dépasseront toujours les projets de géo-ingénierie ; ils font de la Terre un grand animal – un grand corps vivant, l’organisme des organismes, Gaïa ; ce que nous nommerons un corps plein. Tous ces néo-organicismes méritent attention et soutien politique – sont-ils pourtant suffisants pour contester efficacement la représentation de la Terre comme boîte creuse qui a la faveur des géo-ingénieurs ? En soutenant que la Terre est une « bête incontrôlable » qui réagira de façon inattendue aux projets des géo-ingénieurs, les néo-organicistes font-ils autre chose que d’aller dans le sens de ce que les maîtres du monde répètent à longueur de temps, à savoir que le monde est « turbulent », « incertain », et que c’est inévitable ?
Pour répondre à ces questions, nous proposerons une représentation qui ne réduit la Terre ni à un objet (boîte vide) ni à un sujet (corps plein), mais la pense comme trajet. En tant qu’événement au long cours ayant commencé par la naissance de notre système solaire, en tant que trajet inconstructible dont l’expérience ne peut être répétée en laboratoire, la Terre excède la représentation faible produite par les géo-climaticiens ; mais elle excède également la représentation holistique, organiciste et vitaliste de la Terre comme corps plein : dans l’histoire de la Terre, l’écosphère est une peau très récente. Non, la Terre n’est pas Gaïa, que l’on considère celle-ci comme système cybernétique ou comme mère – mère-nature généreuse ou mauvaise mère « intrusive », « redoutable », « assez indifférente [61] », monstre terrifiant qui nous fait perdre la face . [62] Venue du fond obscur de notre univers et promise à la nuit, prise dans une temporalité excentrique qui la déloge de toute spatialité objective ou subjective, la Terre est une planète excentrique qui allie temporairement le non-vivant avec le vivant, le très ancien et les formes en devenir. Elle échappe aux humains à l’instar du temps qui passe et se concrétise à chaque fois de façon inimitable. Inaccessible du début à la fin des temps, la Terre ne laisse aux géo-constructivistes qu’un peu de matière à décorer. Reconnaître cette part inconstructible de la Terre est ce que requiert une nouvelle écologie politique : une écologie de la séparation pour des êtres qui ne seraient ni des astronautes ni des êtres effrayés par les dehors du monde.
NOTES
[1] Michel Tibon-Cornillot, « La reconstruction générale du monde », in La Planète laboratoire, n° 1, 2007, p. 4.
[2] Mark Lynas, The God Species : Saving the Planet in the Age of Humans, Washington, DC, National Geographical Society, 2011, p. 8.
[3] Ulrich Beck, La Société du risque, Paris, Champs-Flammarion, 2001, p. 22 et p. 340-398.
[4] Ibid., p. 23.
[5] Günther Anders, L’Obsolescence de l’homme, t. II, Sur la destruction de la vie à l’époque de la troisième révolution industrielle, Paris, Fario, 2011, p. 397.
[6] La formule de Hölderlin est : « Là où croît le péril, croît aussi ce qui sauve » (Patmos).
[7] Erle Ellis, « Overpopulation is not the problem », New York Times, septembre 2013.
[8] Philippe Descola, Par-delà nature et culture, Paris, NRF-Gallimard, 2005.
[9] Paul Feyerabend, Philosophie de la nature, Paris, Seuil, 2014, p. 153 et p. 218-230.
[10] Aristote, La Physique, Paris, Vrin, 1999, p. 119.
[11] Nous nous appuyons ici sur Patrick Blandin, De la protection de la nature au pilotage de la biodiversité, Versailles, Quae, 2009, p. 18-19 et p. 28-30 ; Jacques Lepart et Pascal Marty, « Des réserves de nature aux territoires de la biodiversité. L’exemple de la France », in Annales de géographie, vol. 115, n° 651, 2006, p. 487, 497, 503-504 ; Christophe Bonneuil, « Une nature liquide ? Les discours de la biodiversité dans le nouvel esprit du capitalisme », in Frédéric Thomas et Valérie Boisvert (dir.), Le Pouvoir de la biodiversité : néolibéralisation de la nature dans les pays émergents, Paris, IRD-Quae, 2015, p. 193-213.
[12] Henri Atlan, L’Utérus artificiel, Paris, Seuil, « La Librairie du XXIe siècle », 2005.
[13] Lewis Mumford, The Myth of the Machine. Technics and Human Development, New York, Harcourt, Brace & World, Inc., 1966 (1re éd. 1934), p. 3 (ma traduction).
[14] Sur les concepts de biosphère et noosphère, voir Wladimir Vernadsky La Biosphère, Paris, Diderot Editeur, 1997, ainsi que « The biosphere and the noösphere », in American Scientist, vol. 33, n° 1, janv. 1945. C’est Teilhard de Chardin qui a inventé le concept de noosphère (voir La Place de l’homme dans la nature, Paris, 10/18-UGE, 1956, p. 25, p. 109-172). Voir aussi Frédéric Neyrat, Biopolitique des catastrophes, Paris, MF, 2008, p. 77-97.
[15] Catherine Larrère et Raphaël Larrère, Penser et agir avec la nature, Paris, La Découverte, 2015.
[16] Voir Jade Lindgaard, « Le grand bétonnage, une bombe climatique », in Mediapart, 27 juillet 2015.
[17] Eduardo Viveiros de Castro, « Et si le temps était venu de “devenir indiens” ? », L’Obs, 12 juillet 2014, http://bibliobs.nouvelobs.com/essai...
[18] Déborah Danowski et Eduardo Viveiros de Castro, « L’arrêt de monde », in De l’univers clos au monde infini, Paris, Dehors, 2014, p. 256.
[19] Paul Crutzen, « Geology of mankind », Nature, vol. 415, 2002, p. 23.
[20] Id., « Albedo enhancement by stratospheric sulfur injections : a contribution to resolve a policy dilemma ? An editorial essay », Climatic Change, vol. 77, 2006, p. 211-220.
[21] Voir « Big names behind US push for geoengineering », The Guardian, 6 octobre 2011 ; « Obama takes bold step to geoengineer climate change », Huffingtonpost, 4 janvier 2014. Quant au Wall Street Journal, voir Bjørn Lomborg, « Can anything serious happen in Cancun ? The upcoming climate summit promises more proposals that ignore economic reality », Wall Street Journal, 11 novembre 2010.
[22] IPCC, « Summary for policymakers », in Climate Change 2013 : The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge, et New York, Cambridge University Press, 2013, p. 29.
[23] « Geo-engineering – A tool in the fight to tackle climate change, or a dangerous distraction ? », Huffingtonpost, 11 septembre 2012. L’article était signé par Jon Taylor, alors directeur du Programme sur le changement climatique de WWF-UK.
[24] Concernant le Heartland Institute et l’American Enterprise Institute qui rejettent la science climatique mais supportent l’ingénierie climatique, voir Clive Hamilton, Earthmasters. The Dawn of the Age of Climate Engineering, New Haven et Londres, New HarYale University Press, 2013, p. 90.
[25] « Scientists urge global “wake-up call” to deal with climate change », in The Guardian, 10 février 2015. On apprend, à l’occasion, que la CIA est elle aussi impliquée dans les recherches sur le contrôle du climat… Voir « Spy agencies fund climate research in hunt for weather weapon, scientist fears », The Guardian, 15 février 2015.
[26] Suvi Huttunen, Emmi Skytén et Mikael Hildén, « Emerging policy perspectives on geoengineering : an international comparison », in The Anthropocene Review, vol. 2(1), 2015, p. 14-32, et John Virgoe, « International governance of a possible geoengineering intervention to combat climate change », in Climatic Change, n° 95, p. 103-119.
[27] Richard Buckminster Fuller, Manuel d’instruction pour le vaisseau spatial Terre, Baden, Lars Müller Publishers, 2010, p. 56.
[28] Sur la relation entre l’imaginaire de la guerre froide et la vision « déterrestrée » de la planète Terre, voir Christophe Bonneuil et Jean-Baptiste Fressoz, L’Événement Anthropocène. La Terre, l’histoire et nous, Paris, Seuil, 2013, p. 76-80.
[29] « Space ark will save man from a dying planet », The Times, 28 avril 2014.
[30] Voir Matt Ridley, « Fossil fuels will save the world (really) », The Wall Street Journal, 16 mars 2015.
[31] Michael Shellenberger et Ted Nordhaus, The Death of Environmentalism. Global Warming Politics in a Post-environmental World (2004), (http://www.thebreakthrough.org/imag...).
[32] Voir « An Ecomodernist Manifesto » (http://www.ecomodernism.org/), que nous analyserons dans la seconde partie de ce livre.
[33] Sur les termes « non moderne » ou « amoderne », voir Bruno Latour, Nous n’avons jamais été modernes. Essai d’anthropologie symétrique, Paris, La Découverte/Poche, 1997 (1re éd. : 1991), p. 69.
[34] Alex Williams et Nick Srnicek, « Manifeste accélérationniste », in Multitudes, n° 56, p. 34.
[35] Emilie Hache, Ce à quoi nous tenons. propositions pour une écologie pragmatique, Paris, La Découverte, 2011, p.142
[36] Voir Crawford S. Holling, « Resilience and stability of ecological systems », in Annual Review of Ecology and Systematics, vol. 4, 1973, et plus récemment Lance H. Gunderson et Crawford S. Holling, « Resilience and adaptative cycles », in Lance H. Gunderson et Crawford S. Holling (sous la dir. de) Panarchy. Understanding Transformations in Human and Natural Systems, Washington, Island Press, 2002, p. 25-62.
[37] Ilya Prigogine et Isabelle Stengers, La Nouvelle Alliance. Métamorphose de la science, Paris, Folio-Essais, 1986 (1re éd. : 1979).
[38] Le chapitre X de Procès et réalité, qui commence par « « Toutes choses s’écoulent » », analyse la « subordination de la fluence » chez Descartes comme chez Platon et Aristote (Alfred North Whitehead, Procès et Réalité, Paris, Gallimard, 1995, p. 339-350).
[39] Romain Felli et Noel Castree, « Neoliberalising adaptation to environmental change : foresight or foreclosure ? », in Environment and Planning A 2012, vol. 44, p. 1-4.
[40] Voir Jeremy Walker et Melinda Cooper, « Genealogies of resilience : from systems ecology to the political economy of crisis adaptation », in Security Dialogue, 2011, n° 42, p. 143-160 ; Melinda Cooper, « Turbulent Worlds : Financial Markets and Environmental Crisis », in Theory Culture Society, 2010, n° 27, p. 167-190 ; et Frédéric Neyrat, « Economy of turbulence. How to escape from the global state of emergency ? », in Philosophy Today, 2015.
[41] Bruno Latour, Face à Gaïa. Huit conférences sur le nouveau régime climatique, Paris, La Découverte, 2015, p. 189.
[42] « S’il existe un écart entre des principes moraux et le monde que nous expérimentons, ce sont nos principes et non le monde qui ne sont pas moraux » (Émilie Hache, Ce à quoi nous tenons, op. cit., p. 54-55). Éradiquer tout « écart » nous semble bien plus générer un problème qu’une solution.
[43] Bruno Latour, « Love your Monsters », in Michael Shellenberger et Ted Nordhaus (sous la dir. de), Love Your Monsters : Postenvironmentalism and the Anthropocene, Breakthrough Institute, Kindle Édition, 2011.
[44] Sur les « fusions monstrueuses » de l’« utopie cyborg » – fusion de l’organisme et de la technologie, donc de la nature et de l’artifice, du donné et de l’acquis, etc. – cf. Geneviève Azam, Osons rester humain. Les impasses de la toute-puissance, Paris, Les Liens qui libèrent, 2015, p. 89 et 19.
[45] Parmi les penseurs principaux des ontologies orientées-objets, citons Graham Harman qui soutient qu’il est possible de définir l’essence d’un objet en le soustrayant à tout réseau relationnel (L’Objet quadruple, Paris, PUF, 2010).
[46] William Cronon, « The trouble with wilderness », in William Cronon (sous la dir. de), Uncommon Ground : Rethinking the Human Place in Nature, New York, W. W. Norton & Co., 1996, p. 69.
[47] La prétendue virginité de la wilderness est dès lors l’effet d’un triple effacement : 1) un effacement réel (le génocide des natifs dont résulte l’impossibilité d’entretenir la mise en culture de la nature propre à cette tradition) ; 2) un effacement technique : c’est parfois, tardivement, au moment de la création de certains parcs nationaux que les natifs on été déplacés (ce fut le cas pour l’Organ Pipe National Monument et l’Organ Pipe Wilderness Area (voir Mark Woods, « Wilderness », in Dale Jamieson (sous la dir. de), A Companion to Environmental Philosophy, Malden & Oxford, Blackwell, 2001, p. 356-357) ; 3) un effacement théorique, autrement dit la volonté de créer la fiction d’une nature hors temps, hors histoire (voir William Cronon, « The Trouble with Wilderness », op. cit., p. 79-80).
[48] On pensera par exemple ici au darwinisme social, appliquant des concepts de type biologique venant de Darwin et de la théorie évolutionniste sur la politique. Voir Patrick Tort, Spencer et l’évolutionnisme philosophique, Paris, PUF, « Que sais-je ? », 1996.
[49] Thierry Jaccaud, « La vérité pour tous » (http://www.thierry-jaccaud.com/2013...).
[50] Razmig Keucheyan, La nature est un champ de bataille. Essai d’écologie politique, Paris, Zones, 2014, p. 11 et p. 17.
[51] Ibid., p. 75-135.
[52] Eduardo Viveiros de Castro, Métaphysiques cannibales. Lignes d’anthropologie post-structurale, Paris, PUF, 2009, respectivement p. 87 et p. 42.
[53] Ibid., p. 32.
[54] « La nature est la forme de l’Autre en tant que corps » (Eduardo Viveiros de Castro, « Perspectivisme et multinaturalisme en Amérique indigène », Journal des anthropologues, 2014/3, n° 138-139, p. 171).
[55] Félix Guattari, Qu’est-ce que l’écosophie ? Paris, Lignes/Imec, 2013. Comme nous le montrerons plus loin, l’écologie machinique de Guattari est supportée par un axiome ontologique : tout est production.
[56] Jamie Lorimer, qui défend une approche « multinaturelle » de la biologie de la conservation, élit le terme de « vie sauvage » (wildlife) comme processus et devenirs au détriment de celui de nature. Sa défense de l’immanence, des agencements non humains, d’une préservation « performative », de l’hybridité, etc., le range du côté du multinaturalisme de la biodiversité et de l’éco-constructivisme ; mais sa promotion (par l’intermédiaire de Deleuze) de la différence contre la diversité (Wildlife in the Anthropocene. Conservation after Nature, Minnesota, University of Minnesota Press, 2015, p. 32-34) le rapproche du multinaturalisme de la différenciation.
[57] Article « Construire », in Alain Rey (sous la dir. de), Dictionnaire historique de la langue française, Paris, Le Robert, 1992.
[58] Aldo Leopold, Almanach d’un comté des sables, Paris, GF-Flammarion, 2000, p. 283.
[59] Bernard Charbonneau, « Le sentiment de la nature, force révolutionnaire », in Bernard Charbonneau et Jacques Ellul, Nous sommes des révolutionnaires malgré nous, Paris, Seuil, 2014, p. 119
[60] Lewis Mumford, The Myth of the Machine. Technics and Human Development, op. cit., p. 235.
[61] Sur « l’intrusion de Gaïa », voir Isabelle Stengers, Au temps des catastrophes. Résister à la barbarie qui vient, Paris, La Découverte, 2009, et Une autre science est possible !, Paris, La Découverte, 2013, p. 116-117. Il nous faudrait une Melanie Klein pour analyser le rapport que les éco-constructivistes entretiennent avec Gaïa.
[62] Bruno Latour, Face à Gaïa, op. cit., p. 9, p. 312. Comme nous le verrons plus loin, Latour n’a pas peur de nos monstres technologiques, il nous demande de les aimer ; mais une seule chose l’effraie : Gaïa. L’un des buts de notre ouvrage est de montrer que cette frayeur-ci est l’effet inanalysé de cet amour-là.
 Fil des publications
Fil des publications
 liste des ouvrages
liste des ouvrages