Villes nomades
Histoires clandestines de la modernité
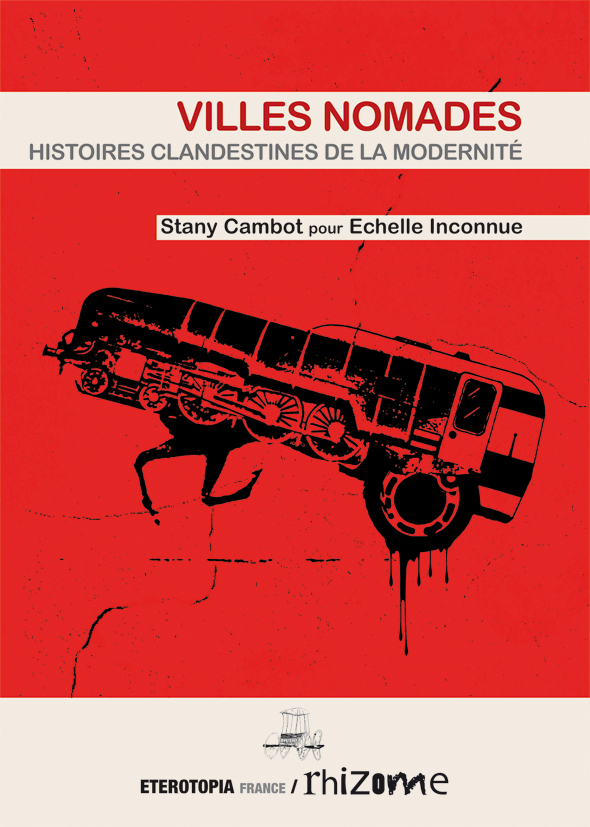
à lire sur Terra
Chapitre 5, Sacrifices et recaptures
Format : cm 15x21 Pages : 104 Prix : 14,00 euros ISBN : 979-10-93250-11-3 Parution : février 2016 ETEROTOPIA FRANCE /Rhizome www.eterotopiafrance.com Pollen diffusion
présentation de l'éditeur
Une double injonction est aujourd’hui faite aux villes et aux individus : les premières doivent devenir métropoles et les seconds mobiles. Ainsi, au programme de métropolisation du monde, répond une mobilité par lui souhaitée. Une mobilité de cadre métropolitain avec ses oripeaux (téléphones, ordinateurs, etc.) se déplaçant de "cité état" en "cité état" en avion ou train à grande vitesse. Les agents de la fabrique de la ville raccrochent alors le train, architectes en têtes, de peur de rater ce tournant comme ils ratèrent celui du développement pavillonnaire. On se pique désormais de mobile, de léger, de « logement une personne » ou de design de bidonville dans l’espoir qu’un marché émerge. Rien de subversif, mais l’aboutissement d’un programme économique et urbain qui se dessine dès le milieu du XIXe siècle dont le nouveau masque s’appelle métropole. Cependant et sans eux, depuis le nouveau millénaire, des tentes partout : des rassemblements militants ayant quitter la rue pour porter le coup là où, désormais, le pouvoir a Lieu, aux tristes révolutions oranges, en passant par les tentes contestataires ou nécessaires des sans-abris. Des camions, des caravanes, des containers aussi, abris ou logement de la renaissance d’un prolétariat nomade disparu dans les années 1920. Des cabanes reconstituant, aux abords des métropoles rêvées, les bidonvilles que l’on croyait disparus. La fabrique même de la métropole génère ainsi une toute autre mobilité. On le voit ici comme à Moscou avec ces brigades d’ouvriers (pour utiliser la dénomination russe) venant de l’autre bout du pays ou du continent que l’on trouve en hôtel low cost, en camping, en caravane ou camion au pied du chantier, en lisière de métropole, au bord de la tache verte de la carte. C’est là, que ces mobilités de constructeurs croisent les espaces d’une autre mobilité, celle de la fuite. Celle de ceux que le programme urbain expulse que l’on retrouvent en camping, camion, campement, containers ou celle de ceux qui fuient la métropole l’entendant comme la construction d’un espace de contrôle (travellers, certains voyageurs, habitants de yourtes ou de cabane). Un peuple sur roues qui vient grossir les rangs de ceux des tziganes, forains et autres roulottiers. Un autre peuple ? Peut-il seulement se considérer comme tel ? Tant la loi et l’État, le condamnent à la clandestinité. Tant la culture, l’architecture et l’urbanisme le considèrent comme marginal, anormal mais surtout insoluble dans une Histoire dont elles tentent de précipiter la fin.
Mots clefs
Le Chapitre 5 est publié sur le site de Terra-HN avec l’aimable autorisation de l’auteur de l’ouvrage et des Éditions Erotopia France/Rhizome.
Table des matières
- Saper le ré-orientalisme pour libérer le futur 5
- Nommer 11
- Zone(s) 15
- La construction orientaliste du nomade 29
- Sacrifices et recaptures 45
- La ville cool 51
- Fabrique urbaine du monstre nomade 63
- « Fawdawi » 75
- Marchez forains ! 91
- Foires politiques 107
- La forme urbaine de l’exode 117
- « La société contre l’État » 129
- La Java de l’infrastructure 137
- Les promesses non tenues de la modernité 145
- Le héro Vernien en bleu de travail et sweat à capuche 153
- David Vincent contre Aristote /Goliath 169
- Tentatives 177
- Postface à la ville nomade de Cosimo Lisi 183
Chapitre 5
Sacrifices et recaptures
Voilà un an qu’on l’a arraché aux siens et intégré à la cité. Il arrive, ivre. Ils le saisissent, l’allongent jambes et bras écartés. Le sacrifice consiste à arracher le coeur, puis à retirer sa peau que le sacrificateur portera comme un vêtement pendant un mois. Après le sacrifice, la dépouille découpée en morceaux, les ossements servent à la fabrication d’instruments de musique, de cuillères, de poinçons ou encore de parures. La prospérité de la cité est assurée et le monde continue de tourner. Tlacaxipehualiztli (« écorchement des hommes ») en l’honneur de Xipe Totec dieu aztèque du renouveau de la nature, de l’agriculture, des pluies nocturnes fertiles et patron des orfèvres.
L’Indien n’est peut-être pas celui que l’on croit et c’est paradoxalement quand la répression et la chasse à « l’homme forain » est la plus intense ou qu’elle approche de son anéantissement, que des jeux d’analogies formelles créent d’illusoires fraternités entre chasseurs et chassés, entre victimes et bourreaux. Cultures, architectures et modes de vie forains réduits à leurs enveloppes plastiques sont revêtus par le chasseur même. Comme l’Espagne du XIXe siècle imposa un gitanisme culturel qui finit par fonder, sur les cadavres gitans relégués, expropriés et périphérisés, le socle culturel de toute l’hispanité. La jeunesse bourgeoise de la fin du XXe réitéra le geste sous sa forme Bobo (bourgeois bohème) jouant des codes vestimentaires du baba cool comme de l’ouvrier (chaussures coquées de marque Caterpillar, ou cotte et bleu de chauffe), persuadée que le siècle en avait fini du prolétariat. À un nomadisme technique ou technologique dont le héros serait le cadre ou l’ingénieur métropolitain, répond aujourd’hui une recapture et revalorisation des codes nomades, réitération révisionniste des « Bohèmes » du XIXe siècle.
Notre actualité voit ainsi refleurir ces bohèmes de riches comme la Gypset Girl (contraction de Gypsy et Jetset), pendant féminin du nouveau nomade vanté par la publicité des hôtels Accor. À moins qu’il ne s’agisse du misandre symétrique de la misogynie orientaliste. La presse féminine lui consacre au cours de l’année 2015 différents articles, comme celui du Figaro Madame qui définit la Gypset Girl comme suit : « Elle promène son chic aristo-bohème de Brooklyn à Tanger… Le monde, pour elle, n’a pas de frontières. Sa philosophie, c’est l’épicurisme, son dogme l’authenticité, son style la simplicité. On adore et on adhère. »
« La bohème des temps modernes s’invente ici... auprès de la Gypset Girl (...) Qui est-elle ? Une élégante semi-nomade qui trimbale son sens inné du style aux quatre coins du globe. Le monde lui appartient. Elle en a fait son territoire, son terrain de jeu, change de ville comme d’autres de chemise, et pose ses valises millésimées au gré de ses envies. (...) contrairement à la jet-setteuse lambda, elle fuit les palaces clinquants et les plages VIP. Son truc ? L’authenticité. Elle cultive en plus une coolitude chicissime dans de petits paradis encore préservés d’un tourisme de masse. Cette nouvelle tribu de néonomades répond à des codes bien précis. » Le travail d’écorchement va plus loin encore quand Julia Chaplin, la papesse du mouvement, utilise les arguments des travailleurs précaires pour l’expliquer : « chômage endémique ou le peu de gratification au travail poussent les gens à abandonner les postes fixes et à plein temps. » Dans le magazine Marie-Claire, elle passe à l’analyse géopolitique : « Le monde, (...) n’est plus aussi sûr qu’auparavant. Est-il de plus en plus difficile de trouver des lieux paradisiaques ? Elle hésite : Oui et non. On ne peut plus aller en Afghanistan comme à l’époque hippie, mais à nouveau au Cambodge ou au Vietnam. Le Mali c’est fini mais, à l’inverse, le Bhoutan c’est tentant. La carte géopolitique de la Gypset change constamment. C’est ainsi, mais nous avons de belles années devant nous. » Eux aussi fuient la guerre…
Comme pour le cadre métropolitain plug and play, le monde est pour elle un terrain de jeu non délimité, désormais conquis ; reste à y piocher la rareté, l’exotisme. Post-orientaliste ? Son esthétique est un syncrétisme : ses tapis sont ouzbeks, sa caravane qu’elle traîne du désert texan aux côtes mexicaines, est en aluminium de modèle stream air. Néo ! Néonomade, néo-colon, néo-explorateur ou exploratrice d’un monde déjà entièrement propriété et cartographié qui entame la reconquête des « extérieurs » métropolitains, des Zones. Dans ce même article de Fabrice Gaignault, certains des amis de la Gypset Girl s’inquiètent : « Quand on voit que les hippies sont devenus des yuppies, on peut se demander si le jeune Gypset ne deviendra pas un jour chasseur de gitans. » Chasse ? Guerre rituelle plutôt dont la ville se nourrit. Il ne s’agit pas là d’un cannibalisme urbain ou de quelque autre forme de sacrifice visant à s’approprier la force ou les qualités de l’ennemi puisqu’elles lui sont niées. Mais, à l’image du sacrifice aztèque, il s’agit bien dans la guerre urbaine ritualisée de revêtir la dépouille de l’ennemi pour faire marcher la « machine mondiale » métropole. À cette figure incarnée du sacrificateur répond aussi une figure urbaine. La fabrique de la ville suit le mouvement. Fleurissent alors tentes, containers et toute une esthétique nomade. Esthétique ? Cosmétique peut-être quand, comme au Havre, on reconstruit, pour ainsi dire pièce par pièce, de faux containers qui serviront à « animer » la façade d’un espace dédié aux arts et à la « classe créative », coolement appelé Tétris.
Les architectes s’emparent de la question et s’émeuvent même de ces bidonvilles qui n’ont pas eu la chance de connaître leur patte. C’est à l’architecte ce que le « syndrome Duchamp » est au critique d’art : la peur de passer à côté de ce qui, demain peut-être, fera le marché. L’épisode traumatique fondateur de ce syndrome date de l’explosion pavillonnaire de la fin des années 1970. À l’époque, les campagnes de construction des grands ensembles font tourner les agences à plein régime. Elles produisent alors tellement qu’il n’est pas rare de voir une façade d’immeuble représentée par un simple rectangle avec, dans un angle, le motif de façade (fenêtre et modénatures éventuelles) à dupliquer sur l’ensemble de celle-ci. Franchir à l’époque la porte d’un cabinet avec un projet de maison se solde généralement par un sourire poli accompagné d’un « désolé mais on est vraiment charrette ».
La manne financière représentée par ces bâtiments photocopiés ne justifie pas de s’intéresser à des projets plus humbles représentant davantage de travail et moins d’argent. C’est dans ce vide que maçons constructeurs et entreprises de BTP vont s’engouffrer pour répondre à la demande croissante de pavillons que les habitants fuyards de la cité photocopiée par l’architecte veulent construire. À faible coût, et en prenant garde à ne pas dépasser le seuil des 170 m2 au dessus duquel la signature d’un architecte est imposée par la loi, ils produisent des pavillons, que le client peut customiser à partir du catalogue. Puis vient la crise. La construction des grands ensembles s’essouffle. Les agences suffoquent. Soudainement asthmatiques, elles contemplent la larme à l’œil le marché perdu du pavillonnaire. On ne les y reprendra plus et si le campement est le marché émergeant, alors au diable les normes dont ils étaient les garants. Ils planifieront la ville foraine, normeront le nomos. Occasion inespérée de se débarrasser de cette encombrante loi des 170 m2.
La guerre ritualisée à laquelle on convie une bonne part de la population réputée terminée, le dépeçage de l’espace nomade peut commencer. Alors on peut immoler les vaincus et revêtir leurs peaux (vêtement ou abris) pour nourrir « la terre et le soleil » de la cité. Mais pour cela, à l’instar des Aztèques du XVIe, sédentarisés seulement deux siècles plus tôt, il faut symboliquement assimiler les vaincus, leur signifier que leur sort est scellé mais glorieux. « Soyez les très bienvenus à cette cour de Mexico Tenochtitlan, [...], où le dieu Huitzilopochtli a son pouvoir et sa juridiction. Et ne croyez pas qu’il vous a conduits ici par hasard, mais pour que vous mouriez pour lui et offriez au couteau votre poitrine et votre gorge. Et c’est pour cela qu’il vous a été donné de jouir de cette insigne cité, car si ce n’était pour mourir, jamais on ne vous en ouvrirait les portes pour y entrer. Soyez les très bienvenus... » (Michel Graulich, « Les victimes du sacrifice humain aztèque », Civilisations n° 50, 2002, p. 91-114.)
Voilà à peu de mots près ce que l’on dit aux peuples forains. On les encense comme des entités sacrées, peut-être aussi pour les purifier en tant que future offrande aux dieux. On ne peut évidemment choisir la victime dans la communauté métropolitaine mais il faut cependant, à croire la théorie du bouc émissaire que l’anthropologue et philosophe Réné Girard expose en 1972 dans son ouvrage La violence et le sacré, que la victime en fasse tout de même partie afin que le sacrifice soit apaisant.
On la choisit alors marginale mais on l’intègre symboliquement.
 Fil des publications
Fil des publications
 liste des ouvrages
liste des ouvrages