La Maison des vulnérables
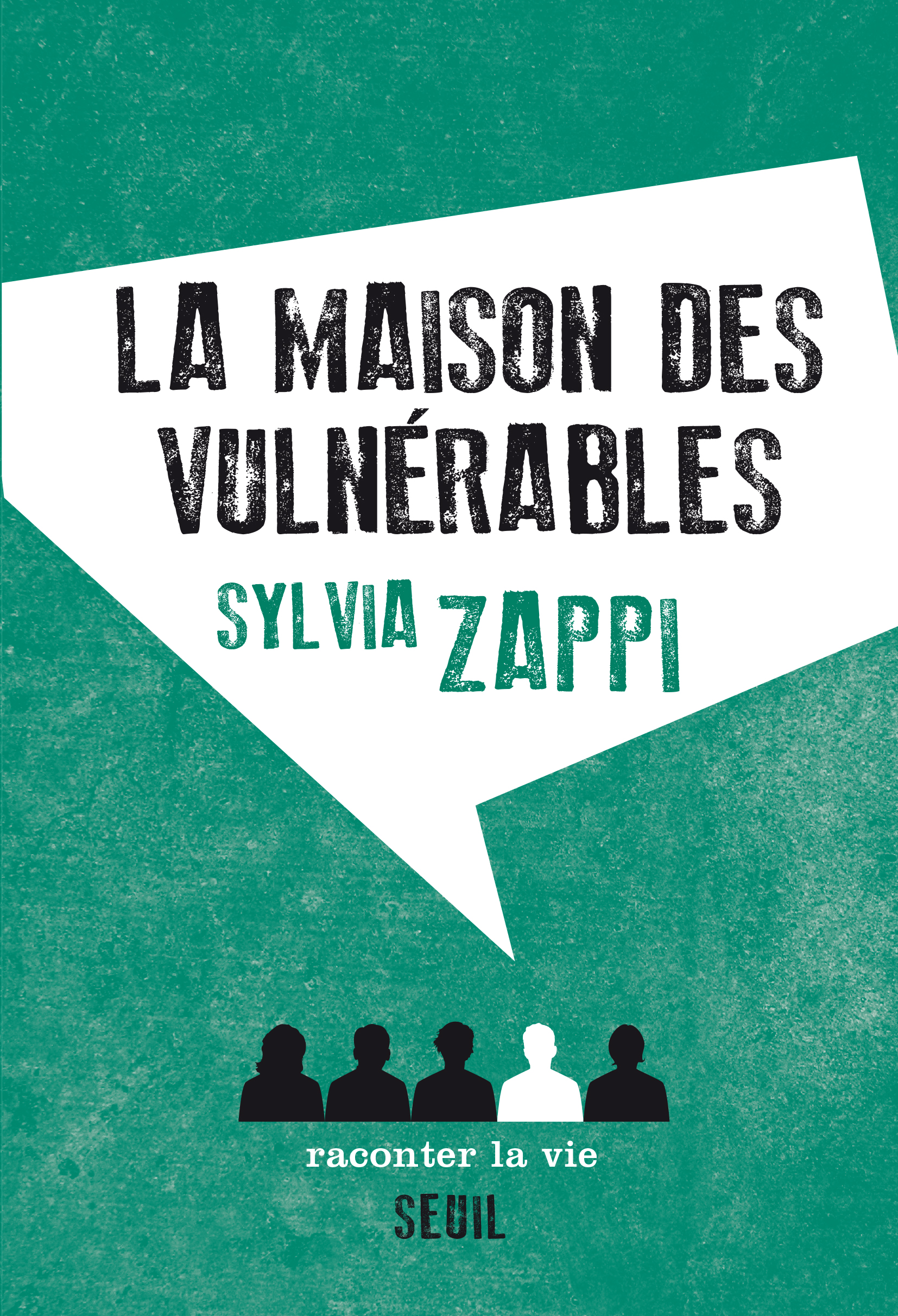
à lire sur Terra
La Maison des vulnérables, Sylvia Zappi Éditions du Seuil, collection "Raconter la vie" février 2016 112 p., 7,90 euros ISBN : 978-2-37021-118-7
présentation de l'éditeur
"A Bobigny, deux immeubles sont récemment sortis de terre sur l’emplacement d’un premier foyer Sonacotra de la région parisienne. Il s’agissait de favoriser la mixité sociale et l’individualisation des modes de vie. Là où seuls des ouvriers immigrés partageaient encore hier leur quotidien, vivent désormais aussi des Français, des femmes, des jeunes, des réfugiés. Pour les anciens, qui ont gagné le confort en perdant l’entre soi, il a fallu faire le deuil de la vie collective. Pour les autres, cassés par l’existence, la nouvelle résidence offre un premier logement. Une pause dans un itinéraire d’abandon et de rupture. A travers le portrait de ces habitants, le lecteur découvre des solitudes cohabitant les unes à côté des autres. "
Mots clefs
Le Chapitre 2 est publié sur le site de Terra-HN avec l’aimable autorisation de l’auteur de l’ouvrage et des Éditions du Seuil.
Table des matières
Introduction ................................................ 7
1. André P., le gardien .............................. 21
2. Meddah, le poète ................................... 27
3. Younès, le taxi ....................................... 35
4. Florence, un voile pour se rassurer ..... 41
5. César, encore à l’essai ........................... 47
6. Babacar et sa malle ................................ 53
7. Dominique, poussée vers la sortie ....... 59
8. Élisabeth, entre deux mères ................. 65
9. Hadyatou, exilée à 50 ans ..................... 71
10. Swarna et Mohammed, réfugiés du Bangladesh ........................ 77
11. Mathilde, entre les femmes et Dieu ... 83
12. Kertis, le bienheureux ......................... 91
Épilogue ...................................................... 97
Chapitre 2 : Meddah, le poète
Chapitre 2
Meddah, le poète
Sa petite chambre est toute nue et encombrée de valises. Meddah est sur le départ. Son pays lui manque, sa famille l’espère et il ne tient plus en place. Là‐ bas, à Abada, un village de Kabylie, sa vie l’attend. Comme beaucoup de ces chibanis hébergés dans la résidence, le septuagénaire part et revient tous les ans. Voilà quinze ans qu’il fait des allers et retours avec son pays d’origine pour toucher ses droits d’ancien travailleur immigré en France.
Meddah est arrivé très jeune pour échapper à la misère qui sévissait en Algérie. Il fallait aussi fuir cette sale guerre qui voyait les troupes françaises et le FLN prendre et perdre tour à tour les bleds de ces montagnes arides. Comme bon nombre de paysans, sa famille avait peur et ne voulait pas s’impliquer : « La nuit, le FLN mangeait avec nous le couscous et le matin, les soldats français nous distribuaient des bonbons. On était entre deux feux et la vie était trop compliquée », raconte le petit homme de 70 ans. Alors, en 1961, à 14 ans, Meddah rejoint son père en France pour « faire l’apprenti ».
Il est embauché un an plus tard, en région parisienne, comme manœuvre à la Société nucléaire canadienne, spécialisée dans la répa‐ ration des centrales. Sur le baraquement de chantier, entre le froid et la solitude lors des soirées au milieu des anciens cheminots retraités, la vie est dure pour l’adolescent. Un contre‐ maître le prend en pitié ; alors qu’il le voit faire le ramadan dehors, il l’envoie au dépôt. « Il y faisait chaud et je pouvais faire mes écri‐ tures », se souvient Meddah. Le jeune homme, qui sait tout juste lire et écrire, suit des cours en dehors de son travail. « L’école du soir », comme on l’appelle, pour apprendre le « vrai français ». Meddah suit durant dix ans ces cours pour étrangers, accroché à son cahier pour ne pas rester « ignorant ».
Sa première expérience de foyer Sonacotra se fait à 22 ans à Bobigny, où il parvient à décrocher un lit grâce à un cousin. Il est alors ouvrier chez Mapa, du groupe Hutchinson, et y fabrique des ballons. L’été, il retourne au pays où ses parents l’ont marié. « C’était obligatoire », sourit‐ il. Il y reste six mois puis revient. Il n’y a pas de travail dans la région de Tizi Ouzou et il faut nourrir la famille : ses premiers enfants sont nés. À l’usine, on le reprend toujours, comme ces dizaines de bras indigènes qui assument les tâches les plus dures de l’atelier. À l’époque, les allers et retours ne posaient pas de problème.
Dans cette dure vie d’exil, Meddah garde de quoi rêver grâce aux cours qu’il suit à l’Alliance française. Il y rencontre un professeur qui le fait entrer en douce à la Sorbonne. Là, le jeune Algérien va découvrir un monde nouveau : la philosophie, les sciences politiques, un langage qu’il n’imaginait pas. « C’est comme ça que je suis devenu romancier », claironne le petit homme. Montrant son carnet rouge qu’il a toujours sur lui, dans lequel il couche « ses écritures », il assure avoir déjà écrit deux romans et un essai « sur la renaissance et le déclin des sociétés ».
En 1972, son père meurt et il doit prendre à nouveau le bateau pour traverser la Méditerranée. Pendant trois ans, il essaye de survivre avec la petite Alimentation générale qu’il a ouverte et voit enfin grandir un peu ses enfants : « En France, c’était pas une vie. Je ne les voyais que quelques jours trois fois par an. Ma femme me réclamait. » Il reste jusqu’à ce que son commerce fasse faillite. Il faut alors repartir : « C’était un déchirement mais on n’y arrivait pas avec la boutique. » Une fois encore, il doit laisser ses proches derrière lui. Son patron lui promet depuis des mois de lui fournir un appartement à Paris mais il doit attendre longtemps avant de voir la promesse se concrétiser. Meddah rêve d’y emmener tout le monde, sa femme, ses enfants, y compris sa belle‐ mère. « Mais elle ne voulait pas nous accompagner et ma femme ne voulait pas laisser sa mère seule. Ça ne se fait pas chez nous. Qu’est‐ ce qu’allaient dire les voisins ? », souffle Meddah avec ses petits yeux pleins de bienveillance. Alors il a repris ses traversées de la Méditerranée, revenant « de temps en temps », en août et en décembre.
Le regard se voile sous les sourcils touffus. Le souvenir de ces années de labeur et d’éloignement est encore douloureux. Tout comme celles du chômage et de la déchéance qu’il n’a pu avouer à sa famille et qu’il tait encore par pudeur. Après 1988, les usines n’ont plus embauché ces vieux travailleurs qui parlaient mal français : il y avait trop de chômage et pléthore de salariés plus qua‐ lifiés. Meddah est retourné en Algérie s’occuper de ses huit vaches et moutons, se construire une maison. « Une belle villa à la campagne », souffle‐ t‐il. Il revenait en France par intermittence quand il réussissait à décrocher un contrat de quelques mois. Puis Meddah a été mis d’office à la retraite. C’était à la fin des années 1990 – les dates sont floues. Il n’a pu retrouver de travail. Meddah a alors été expulsé du logement qu’il avait et s’est retrouvé à la rue, sans un sou. Impossible de rentrer avec cette honte.
C’est dans une épave de voiture, échouée devant le foyer Sonacotra à Bobigny, que Rita V. l’a repéré. Il s’était réfugié dans l’ancienne Renault break bordeaux du boulanger, qui venait quotidiennement vendre son pain au foyer sur le parking. Elle stationnait là. Meddah y avait entassé ses sacs, ses couvertures, et survécu grâce à l’aide de quelques connaissances dans le foyer. La responsable lui a trouvé une chambre, l’a aidé à récupérer ses papiers perdus et à réintégrer ses droits. « Au début, ce n’était pas facile car les autres résidents se plaignaient de l’odeur... », se souvient « madame Rita » comme l’appellent les chibanis.
Meddah avait perdu l’habitude de vivre dans un logement, de prendre soin de lui. Les occupants du foyer ne sont pas tendres avec ceux d’entre eux qui perdent pied. Il faut se montrer digne, se tenir droit. Meddah remonte pourtant la pente et retrouve sa fierté d’homme. Il reprend contact avec son fils, peut de nouveau aller et venir entre les deux rives, ramener un peu d’argent. Et passer quelques semaines dans la chambre qu’il partage avec trois autres vieux immigrés. Une chambre alternée, comme l’est sa vie.
Depuis la construction de la nouvelle résidence, Meddah vit dans la nostalgie de l’ancien foyer et de son ambiance. « Le foyer était vieux, les chambres petites – des cages à lapin avec un lit où il ne restait que cinquante centimètres d’espace à vivre, séparées les unes des autres par du contreplaqué. Mais il y avait une vie collective, les amis qu’on rencontrait à la “caféterie” ou les prières dans la salle qui nous servait de mosquée. Et puis, on avait des photos accrochées au mur qui nous aidaient à tenir », raconte‐ t‐il. Dans la chambre, les murs jaunes sont propres mais nus. Pas de cliché ni de décoration, rien qui puisse la distinguer. « Quand on revient, on n’a pas toujours la même. Et puis on la partage avec trois autres... », glisse le vieil homme.
Meddah garde ses photos sur lui dorénavant. Sur son iPhone qu’il brandit en souriant devant les visages de ses sept enfants et neuf petits‐ enfants, qu’il doit continuer à laisser régulièrement derrière lui pour venir bénéficier de ses droits – la retraite et l’aide médicale. « Quand je suis malade, je rentre », ajoute‐ t‐il sans qu’on sache bien où le mot « rentrer » le mène. Comme si, après ces années d’allers et retours, la confusion sur l’identité de son « chez‐ lui » s’était insinuée dans son esprit. Le vieil homme se lève, regarde sa montre. « Un ami va venir me chercher pour l’aéroport. » Il reviendra en novembre. Toucher sa pension.
 Fil des publications
Fil des publications
 liste des ouvrages
liste des ouvrages