Ruptures postcoloniales
Les nouveaux visages de la société française

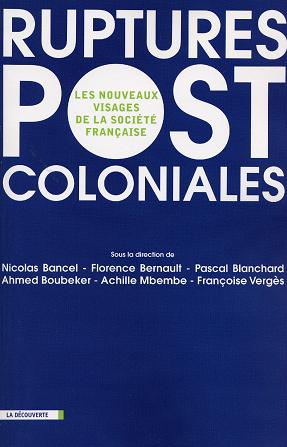
présentation de l'éditeur
 |
Nicolas BANCEL, Florence BERNAULT, Pascal BLANCHARD, Ahmed BOUBEKER, Achille MBEMBE, Françoise VERGÈS, (dir.) , Ruptures postcoloniales - Les nouveaux visages de la société française , Paris : La Découverte, 2010 : http://www.reseau-terra.eu/article1079.html Parution : mai 2010 - Éditeur : La Découverte - Pages : 540 - Format : 155 x 240 mm - ISBN : 9782707156891 - Prix : 26 € |
Mots clefs
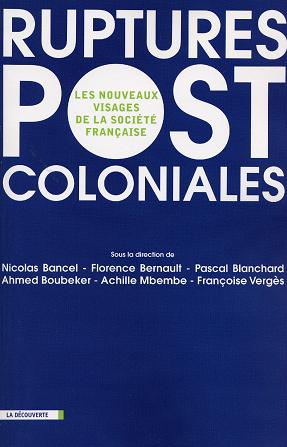
Comment penser la France d’aujourd’hui sans verser dans la nostalgie à l’égard de sa mythique grandeur passée, et comment construire un nouveau « vivre ensemble » ? De quelle manière sortir des pièges de l’identité nationale et des fantasmes sur les dangers de l’immigration ? Comment penser les relations de la France dans le monde postcolonial, alors que le continent africain fête les cinquante ans d’indépendance des anciennes colonies françaises, que les territoires des outre-mers réclament de nouveaux rôles dans la République et que de nouveaux centres et périphéries émergent ?
Prolongeant le tableau dressé en 2005 dans La Fracture coloniale (également paru à La Découverte), les auteurs de ce livre apportent un éclairage original sur les courant encore mal connus en France des post-colonial et subaltern studies. Ils tentent de comprendre pourquoi ces courants engagent tant d’oppositions et de fantasmes et examinent la société française à l’épreuve des perspectives postcoloniales.
Avec les contributions de spécialistes de tous horizons, internationalement reconnus, cet ouvrage constitue à la fois, une somme et une ouverture. Il analyse les mille facettes des effets contemporains de la période coloniale et incite à repenser la mondialisation, ainsi que la place des diasporas. Il s’attache à une critique des discriminations et des frontières politiques, interroge les enjeux culturels et les relations intercommunautaires, explique les conflits de mémoire, questionne les crises urbaines et explore les mouvements mobilisant les territoires des outre-mers.
Direction de l’ouvrage :
Nicolas Bancel, historien, spécialiste de l’histoire de la colonisation, des questions post-coloniales et des pratiques corporelles, est professeur à l’université de Strasbourg-II Marc-Bloch, vice-président de l’ACHAC, détaché à l’université de Lausanne (UNIL-ISSEP). Il est également chercheur associé au SEDET (Paris 7). Il a codirigé Zoos humains (La Découverte, 2002) et, avec Jean-Marc Gayman, Du guerrier à l’athlète (PUF, 2002).
Florence Bernault, historienne, est professeur d’histoire africaine à l’Université du Wiscontin à Madison, détachée de l’École normal supérieure de Lyon. Elle est membre du comité éditorial de l’American Historical Review et du comité scientifique du Journal of African History. Elle travaille actuellement sur le corps et le fétichisme en colonie et postcolonie, recherche qui a été soutenue par un Guggenheim Fellowship
Pascal Blanchard, historien, spécialiste du "fait colonial" et des immigrations des outre-mers en France, est chercheur associé au GDR 2322 du CNRS Anthropologie des représentations du corps (Marseille) et président de l’ACHAC (Paris).
Ahmed Boubeker, sociologue, spécialiste des processus migratoires et des immigrations, maghrébines, est professeur l’université de Metz (Laboratoire ERASE 2L2S).
Achille Mbembe est est professeur d’histoire et de science politique à l’université de Witwatersrand à Johannesbourg (Afrique du Sud). Chercheur au Witwatersrand Institute for Social and Economics Research (WISER), il enseigne également au département français et à Duke University (aux États-Unis). Il est notamment l’auteur de De la postcolonie. Essai sur l’imagination politique dans l’Afrique contemporaine (Karthala, 2000).
Françoise Vergès est chargée de mission MCUR, est consulting professor à Goldsmiths College (Londres) et président du Comité pour la mémoire de l’esclavage. Elle a publié entre autres ouvrages, seule ou collectivement Monsters and Revolutionaries (Duke University Press, 1999) ; Abolir l’esclavage : une utopie coloniale (Albin Michel, 2001) ; Racines et itinéraires de l’unité réunionnise (Graphica-Région Réunion, 2003) ; Nègre je suis, nègre je resterai. Entretiens avec Aimé Césaire (Albin Michel, 2005) ; Amarres. Créolisation india-océanes (L’Harmattan, 2005) ; La République coloniale. Essai sur une utopie (Hachette, 2006) et La Maison des civilisations et de l’unité réunionnaise (Somogy, 2009).
Pour acheter ce livre :
http://www.editionsladecouverte.fr/...
Autour de l’ouvrage
![]() Le programme de recherche du Groupe de recherche Achac
"Colonisation, immigration, post-colonialisme"
Le programme de recherche du Groupe de recherche Achac
"Colonisation, immigration, post-colonialisme"
![]() Compte-rendu de lecture par Thierry Leclère dans Télérama n° 3167 Le 22 septembre 2010.
Compte-rendu de lecture par Thierry Leclère dans Télérama n° 3167 Le 22 septembre 2010.
![]() Compte-rendu de lecture par Joël JEGOUZO sur son blog.
Compte-rendu de lecture par Joël JEGOUZO sur son blog.
![]() Interview sur RFI de Pascal Blanchar et Françoise Verges, 12 juin 2010.
Interview sur RFI de Pascal Blanchar et Françoise Verges, 12 juin 2010.
.
TABLE DES MATIÈRES
.
Introduction. De la fracture coloniale aux ruptures postcoloniales, par Nicolas Bancel, Florence Bergnault, Pascal Blanchard, Ahmed Boubeker, Achille Mbembe et Françoise Vergès
I / HÉRITAGE POSTCOLONIAL
A. Les fondations
- 1. Abdelmalek Sayad, pionnier d’une sociologie de l’immigration postcoloniale, par Ahmed Boubeker
- 2. Le moment saidien des postcolonial studies. , par Pierre Robert Baduel
- 3. L’aphasie coloniale française : l’histoire mutilée, par Ann Laura Stoler
- 4. Césaire, Fanon et la colonialité de la République, par François Durpaire
- 5. Albert Memmi, par Yvan Gastaut
- 6. Le postcolonialisme et l’ange du progrès, par Anne McClintock
- 7. De l’esclavage au postcolonial, par Patrick Weil
- 8. Vers une décolonisation des « uni-versalismes » occidentaux, par Ramón Grosfoguel
B.Les héritages
- 9. Réactions françaises à une perspective postcoloniale, par David Murphy et Charles Forsdick
- 10. Les postcolonial studies et leur réception dans le champ académique en France, par Mamadou Diouf
- 11. Les Barbares et le rêve d’Apollon, par Florence Bernault
- 12. Écrire le postcolonial depuis la langue française, par Carpanin Marimoutou
- 13. Quel espace de création pour ces « étrangers de l’intérieur » ?, par Olivier Barlet et Sylvie Chalaye
- 14. L’impensé colonial dans les institutions françaises, par Mathieu Rigouste
- 15. La République et l’impensé de la « race », par Achille Mbembe
- 16. Le corps-frontière, traces et trajets postcoloniaux, par Nacira Guenif-Souilamas
II / LA FRANCE POSTCOLONIALE
A. Les enjeux français
- 17. L’Utopie francophone, par Gabrielle Parker
- 18. Questions sur la « diversité », par Michel Wieviorka
- 19. Postcolonialisme et immigration : nouveaux enjeux, par Catherine Wihtol de Wender
- 20. L’immigration (post)coloniale en héritage, par Ahmed Boubeker
- 21. L’enseignement de l’histoire à l’épreuve du postcolonial, par Benoît Falaize
- 22. Échanges autour de l’actualité du postcolonial, par Achille Mbembe et François Vergès
- 23. Les études postcoloniales en France, par Marie-Claude Smouts
- 24. Le tropisme de l’Université française face aux postcolonial studies, par Catherine Coquery-Vidrovitch
- 25. Entre la France et l’Algérie, le traumatisme (post)colonial des années 2000, par Benjamin Stora
- 26. Repenser le politique dans les DOM, par Jacky Dahomay
B. Les Nouvelles dynamiques
- 27. « Race », ethnicisation et discriminations, par Patrick Simon
- 28. La France, la diversité et notre relation au monde, par Pascal Boniface
- 29. De l’Empire à la République : l’« islam de France », par Valérie Amiraux
- 30. Postcolonialité et francité dans les imaginaires télévisuels de la nation, par Eric Macé
- 31. L’émergence d’une « question noire » en France, par Dominic Thomas
- 32. Les nouveaux cosmopolitismes migratoires d’une mondialisation par le bas, par Alain Tarrius
- 33. Le grand strip-tease, par Elsa Dorlin
- 34. Le Musée du quai Branly, par Herman Lebovics
- 35. Le musée postcolonial, par Françoise Vergès
- 36. Colonisation : Commémorations et mémoriaux, par Nicolas Bancel et Pascal Blanchard
 Bibliographie
Bibliographie
 Les auteurs.
Les auteurs.
.
CHAPITRES CHOISIS
.
Chapitres publiés en ligne avec l’aimable autorisation de l’auteur et de l’éditeur.
Copyright © 2010 La Découverte
L’aphasie coloniale française : l’histoire mutilée
Ann Laura Stoler
Il y a presque dix ans, alors qu’une conférence donnée en l’honneur de Georges Balandier – présentée à l’époque comme la première conférence « transatlantique » consacrée à la « situation coloniale » – me donnait l’opportunité de réfléchir aux approches universitaires de l’histoire coloniale française, deux choses m’avaient frappée [1] : premièrement, l’explosion d’un intérêt commémoratif pour l’histoire coloniale française, qui se reflétait dans la prolifération des publications à ce sujet tant en France qu’aux États-Unis ; deuxièmement, les expressions commodes qui servaient à connoter le silence qui avait entouré jusque-là les questions coloniales : il s’agissait en l’occurrence d’un « trou de mémoire », d’une « amnésie collective » d’une « histoire oubliée », qui s’était en quelque sorte perdue au moment où la France avait finalement fait ses comptes avec Pétain, Vichy, et les sympathies nazies qui s’étendaient bien au-delà des collaborations les plus évidentes.
Pour nombre d’entre ceux qui, comme moi, travaillaient depuis longtemps sur une histoire coloniale française lourde de déterminants raciaux, cette exubérance semblait étrange, presque fébrile et hors de propos. Elle n’était pas seulement tardive, comme les spécialistes du colonialisme français s’empressent désormais de le faire observer. À la lumière du développement vertigineux des débats et des publications que l’on a pu observer au cours des dernières années, il est possible de considérer ce précédent frénétique comme un simple renouvellement* [2] de ce qui s’apparentait alors à l’annonce de la « découverte » des liens profonds qui liaient et qui continuent de lier la République* à la race.
Bien entendu, l’enjeu de cet épisode n’était pas la « découverte » de la place de la torture dans l’histoire coloniale française, ni les révélations au sujet des camps d’internement présents dans tout l’archipel carcéral de l’Empire. Publié en juin 1959, l’ouvrage La Gangrène documentait les pratiques sur l’intime et la proximité auxquelles recouraient les soldats français pour infliger des traitements avilissants aux hommes algériens [3]. En 1962, Simone de Beauvoir et Gisèle Halimi avaient publié un compte-rendu de la torture et du viol de Djamaila Boupacha, âgée de vingt-trois ans à l’époque des faits [4].
Les informations sur les premières colonies agricoles et pénales établies en Algérie et ailleurs étaient disponibles depuis longtemps. Quant au rôle de la violence exercée à partir de critères raciaux dans la constitution de la République, il n’était pas absent de la littérature populaire et universitaire. Jean-Paul Sartre, Albert Camus et, bien entendu, Frantz Fanon et Aimé Césaire l’avaient appelée par son nom à maintes reprises. Si, en 1992, Tony Judt pouvait aisément ne consacrer que huit pages aux aventures coloniales dans un ouvrage sur les intellectuels français de l’après-guerre qui fut fort bien accueilli, il ne pourrait plus se le permettre aujourd’hui [5]. Nombre de choses ont en effet changé : la façon dont l’histoire est aujourd’hui censée peser sur les choix présents et futurs des individus et sur la politique contemporaine ; le lieu où se situent les politiques sociales d’exclusion systématique dans la topologie des valeurs républicaines ; et par conséquent la place centrale de l’histoire.
Bien des choses distinguent cette intervention antérieure de celles qui animent le débat aujourd’hui, et notamment les causes immédiates et les référentiels de celui-ci. Parmi les causes immédiates figurent les réactions virulentes aux injonctions de l’État sur la façon d’écrire l’histoire coloniale française, et surtout la violence exacerbée qui s’est vérifiée en novembre 2005 dans les banlieues* – ce qu’Étienne Balibar a judicieusement appelé une « ligne de front » dans la « proximité des extrêmes ». Parmi les référentiels, retenons l’adoption d’un vocabulaire qui, pour la première fois, fait référence aux « études postcoloniales » du monde anglophone et reconnaît qu’elles sont susceptibles de fournir des catégories analytiques pertinentes, ce que les interventions précédentes se gardaient bien de faire [6]. Il n’en reste pas moins que ces deux épisodes sont marqués, l’un comme l’autre, par le peu de sensibilité dont ils témoignent vis-à-vis des énormes disparités qui avaient caractérisé la production universitaire française, laquelle, au cours des décennies précédentes, avait oscillé entre un silence assourdissant au sujet du passé colonial et une reconnaissance critique de ses implications contemporaines. Rares sont ceux qui ont pris le temps de considérer le fait que la reconnaissance de la nature raciale de l’État républicain français – tant dans la métropole que dans les colonies – constituait une réalité sociale dont les contours historiques avaient été alternativement très nets ou au contraire estompés, selon qu’elle pénétrait les limites universitaires de la nation ou en était tenue à l’écart.
Il y a plus de soixante ans, Georges Balandier appelait de ses vœux une anthropologie critique qui placerait une sensibilité historique au cœur de son projet théorique. Le défi qu’il lançait consistait à aborder de front l’univers traversé de contradictions du colonisateur et du colonisé plutôt qu’à le contourner, et à suivre les « distorsions sociales » racialisées qui avaient structuré les sociétés africaines soumises à la domination coloniale française. Il n’était pas seul à formuler ce vœu. En 1950, Alfred Metraux parlait de la « contradiction fatale » située au « cœur de notre civilisation [européenne] » ; en 1945, Bronislaw Malinowski s’en prenait à une anthropologie trop souvent satisfaite d’« entrées limitées à une colonne » et l’invitait au contraire à étudier les communautés européennes « agressives et conquérantes » en même temps que les communautés indigènes ; en 1951, Michel Leiris ne cachait pas son mépris pour une ethnographie vouée à l’insignifiance aussi longtemps qu’elle « ferm[er]ait les yeux sur le problème colonial [7] ». Si ces auteurs se montraient tout à fait disposés à dénoncer la valeur scientifique de la notion de race, et ne manquèrent pas de le faire avec beaucoup d’autres, il leur fut beaucoup plus difficile de repérer et de penser ethnographiquement les éléments historiques constitutifs du présent ethnographique. Il est difficile aujourd’hui d’imaginer à quel point leurs injonctions retentirent dans le vide [8].
Le renouvellement des études coloniales en France, un projet avorté
Lorsqu’en 1987 Frederick Cooper et moi-même appelâmes de nouveau les universitaires à prendre en considération les « tensions de l’empire » qui traversent les oppositions entre colonisateur et colonisé, métropole et colonie, et à étudier les pratiques qui associent libéralisme, racisme et réforme sociale, c’est à l’essai fondateur que Georges Balandier publia en 1951 que nous fîmes référence, « La situation coloniale : approche théorique [9] ». À l’époque, la recherche coloniale anglophone était avide de se pencher sur ces connexions, sous l’impulsion de ceux qui, des deux côtés de l’Atlantique, au Nord comme au Sud global – Aimé Césaire, Frantz Fanon, Bernard Cohn, Stuart Hall et Edward Said – avaient justement fait remarquer la pérennité des structures impériales et la ténacité des relations qu’elles mettaient en forme. Mais les sciences sociales françaises semblaient être imperméables, voire tout à fait réticentes vis-à-vis d’une réinterprétation qui plaçait la métropole et la colonie dans le même cadre analytique. Ce que Cooper et moi n’avions pas noté à l’époque était le fait que ni Balandier ni ses étudiants les plus éminents n’avaient relevé le défi que ce dernier avait lui-même lancé de façon si persuasive.
On peut évidemment invoquer la surveillance étroite des frontières de l’expertise disciplinaire pour expliquer cette lacune, mais il se trouve que les disciplines sont poreuses, qu’elles sont structurées par ceux qui y occupent des positions de force, et que leur focale évolue. Dans un entretien de 1995 avec Marc Augé et d’autres collègues africanistes portant sur son itinéraire intellectuel, Balandier offre une réponse oblique, inquiète et personnelle en s’identifiant à une génération qui était « libérée, mais pas entièrement, décolonisée, mais pas pleinement, et qui considérait l’Université différemment mais sans pour autant la construire de façon différente ». Voici ces propos :
« Je ne vais pas faire une sorte de bilan masochiste mais je dirai que j’ai appris à mon compte, à mon débit et avec peine d’une certaine manière que la présence à l’Histoire n’est pas une présence facile, qu’elle coûte de l’effort, qu’elle coûte de la désillusion, qu’elle coûte des désenchantements, mais qu’elle contraint à continuer, à “faire” [10] »
Les « désenchantements » vis-à-vis de l’histoire ne sont pas étrangers aux intellectuels français (qu’ils soient communistes ou non), pas plus qu’ils ne furent propres à Balandier. Mais si les souvenirs, les remémorations et les mémoriaux de la Première et de la Seconde Guerre mondiale furent des piliers de la société française d’après-guerre, tel ne fut pas le cas pour la France coloniale. Tout se passait comme si l’enquête historique et le travail ethnographique approfondis constituaient des projets incompatibles à partir du moment où il s’agissait de projets français. Avec cette mise entre parenthèses, les catégories de la gouvernance coloniale demeuraient coupées des politiques ultérieures de traitement de l’immigration, la torture systématique des sujets coloniaux restait dissociée des valeurs républicaines, les régimes racialisés séparés des débats sur la citoyenneté, et l’empire et la race étrangers à la formation de la France contemporaine.
Aujourd’hui, le paysage semble avoir radicalement changé. Le colonialisme, l’empire et la mémoire vivante de ceux qui ont fait l’expérience de ces relations semblent maintenant constituer les trames d’un tissu national qui se défait. Les désaccords profonds au sujet de leur statut, ou de la « continuité coloniale » – renforce-t-on les revendications pressantes d’égalité sociale en insistant sur cette continuité, ou n’a-t-elle au contraire aucune pertinence à cet égard ? La repentance contraint-elle la politique ? La politique a-t-elle remplacé la rigueur universitaire ? – ont donné lieu à des échanges tendus et à des agendas divergents [11]. Il est clair qu’il est désormais difficile de considérer la République et l’Empire comme des catégories qui s’excluent mutuellement. La « République coloniale », qui avait été de toute évidence un oxymore, demeure peut-être une association dépareillée pour certains, mais aux yeux d’une jeune génération de chercheurs, elle représente le leitmotiv du moment, un nouveau point de départ pour une histoire du présent, ainsi qu’un nouveau site d’engagement politique [12].
En moins d’une décennie, la pertinence des études postcoloniales anglophones dans le contexte français est devenue un sujet de débats parmi les universitaires, les activistes et les chercheurs. Les vocabulaires coloniaux ont été détournés de façon ironique. De même que dans les années 1990, lorsque le « métissage » – un terme associé à des perceptions et des pratiques grosses de dédain et de mépris – devint une façon de parler de la promesse d’une France multiculturelle, les Indigènes de la République dénoncent aujourd’hui les politiques coloniales racialisées du Code de l’Indigénat en se saisissant à nouveau du terme d’« indigène » pour refuser les discriminations raciales et la fiction d’une société qui n’accorde aucune existence juridique à la race.
Point n’est besoin ici de revenir sur ces transformations, ni sur les conditions explosives qui l’ont rendue possible : la loi du 23 février 2005, qui imposait aux programmes d’enseignement de souligner le « rôle positif » de la présence française outre-mer, a suscité de nombreux commentaires incisifs de la part de ses avocats et de ses adversaires, bien au-delà du cercle de ceux qui sont allés fouiller un jour dans les Archives d’outre-mer à Aix-en-Provence [13]. Entre 2000 et 2008, la production a été tout simplement vertigineuse : La Torture dans la République, de Pierre Vidal-Naquet (1998), Le Livre noir du colonialisme de Marc Ferro (2003), Colonisation : droit d’inventaire de Claude Liauzu (2004), Coloniser/Exterminer d’Olivier Le Cour Grandmaison (2005) et La Fracture coloniale (2005) de Nicolas Bancel, Pascal Blanchard et Sandrine Lemaire [14] ont ponctué un flot incessant de réévaluations historiques et de réorientations critiques. Le nombre de revues, universitaires ou non, qui ont abordé la question postcoloniale et sa relation aux violences urbaines ne contribue pas seulement à donner au passé coloniale une voix active dans le présent ; il place la politique du savoir et le devoir de rendre compte au cœur du débat public [15]. Cette ruée vers la récupération de technologies politiques permettant de relier le présent au passé colonial a aussi comporté une transgression des normes disciplinaires de l’université, et déclenché des luttes territoriales visant à établir qui connaissait les archives coloniales, et à stipuler qui avait le droit d’écrire cette histoire et qui ne l’avait pas [16]. Si les « découvertes » ont parfois cédé la place à un inventaire moral des crimes et à une série de condamnations, elles ont aussi produit des généalogies inquiétantes qui creusent de profondes ornières coloniales dans les structures de violence, de détention et de misère qui pèsent sur le présent – et notamment dans la distribution inégale des efforts visant à diminuer leur poids [17].
Mais cet espace politique et intellectuel au sein duquel la mémoire du colonial est débattue, abusée, revendiquée ou effacée laisse peu de place à la reconnaissance de ce qui est en effet « oublié », à la façon dont le savoir historique opère des lapsus, aux conditions psychiques, politiques et épistémologiques qui structurent l’effacement, l’incarnation – ou le déplacement – de la manière dont on vivait dans et de l’empire. La question n’est pas simple. Comme Sartre nous le rappelle, les gens savent et ne savent pas, et ce non pas dans une progression chronologique, mais au même moment [18]. Et, tout comme le terme d’« ignorance » est étymologiquement lié au verbe « ignorer », l’oubli n’est pas une condition passive. « Oublier », comme « ignorer », est un verbe actif, qui désigne le fait de se détourner de quelque chose. Il n’y a là rien de naturel ou de donné, mais un état qu’il s’agit de rejoindre.
Peut-être les conditions qui rendent possible cette distension de l’espace de l’histoire coloniale sont-elles maintenant évidentes. Herman Lebovics affirme avec force que les mythes fondateurs de l’identité culturelle française ont déshérité les généalogies de l’empire en les excluant de la France véritable, et que le « modèle politique » a fait de l’empire une « extension de la nation », si bien que les « cultures indigènes » ne pouvaient être incorporées à la première moitié du XXe siècle que si elles se trouvaient prises dans la « haute culture de la France européenne [19] ». Gérard Noiriel a, quant à lui, souligné l’existence d’un mythe unitaire de la France à l’origine d’un concept de la francité excluant systématiquement la population immigrée [20]. Nancy Green a fait observer que la notion de race a longtemps été tenue dans le mépris et considérée comme une catégorie américaine importée, et que « pendant de nombreuses années, la majorité des chercheurs français ont tout simplement ignoré le sujet du racisme en France [21] ». Certains ont avancé que toute référence à l’Indochine* qui ne se faisait pas sur un mode nostalgique évoquait l’humiliation nationale et les défaites de ce qui restait une guerre non déclarée. D’autres encore ont suggéré que les brutalités de la présence coloniale en Indochine* ont été effacées par les interventions américaines plus directes et par la masse documentaire qui témoigne de la guerre du Vietnam.
L’argument selon lequel la recherche en France n’était pas « prête » ou désireuse d’exhumer une page de l’histoire aussi sordide ne permet pas d’expliquer cette autre fracture mémorielle de la même période, celle qui n’a cessé de parler – et de rendre compte – de qui avait activement soutenu Pétain et la politique post-vichyste, qui avait caché qui et où, qui avait réellement pris part à la résistance* et qui ne l’avait pas fait. Quant à l’horreur des pratiques coloniales, elles figuraient déjà auparavant dans l’espace public. Les atrocités coloniales françaises étaient étalées dans la presse avant que le champ de l’histoire coloniale en France ne subisse des transformations profondes. En 2000, la une de L’Express, « Torture en Algérie : un témoignage inédit », s’inscrivait dans un genre familier de reportage à sensation sur la violence et les abus coloniaux – qui semblait anticiper les photos de Lyndie England à Abu Ghraib – , affichant des clichés privés qui avaient appartenu à des soldats – des corps, des têtes tranchées par l’armée française comme par le FLN, une jeune Algérienne gisant nue en plein soleil à Constantine que deux soldats français, cigarette aux lèvres, soulèvent par les poignets. De telles publications ont peut-être donné une idée des horreurs d’une guerre injuste, mais elles émettaient aussi des signaux ambigus quant à ce qui était confessé, ce qui était montré et quant à l’identité des coupables [22].
En 2001, plusieurs années avant que Jacques Chirac ne tente de donner force de loi au « rôle positif » des entreprises coloniales françaises, Le Monde diplomatique fit un portrait de l’enseignement de l’histoire dans les écoles publiques françaises au cours des quarante années précédentes. Celui-ci montrait que l’histoire coloniale elle-même, ainsi que les résistances suscitées par la colonisation, avaient été « évacuées des programmes scolaires », avec pour effet d’inculquer à toute une génération une connaissance faussée de l’Algérie et une « histoire expurgée, à la Bowdler » de la guerre d’Algérie [23]]. Quant à ce grand historien qu’est Benjamin Stora, il n’avait eu de cesse d’instruire le dossier à charge depuis longtemps [24].
La question qui se pose à ceux qui étudient le colonialisme n’est peut-être pas « Pourquoi cette mémoire et non telle autre ? », « Pourquoi certaines invocations du colonial et non d’autres ? », mais plutôt une question que Nietzsche formule dans « Les usages et les abus de l’histoire », lorsqu’il met en garde contre la tentation de « flâner dans le jardin du savoir [25] ». Ce qui rend l’histoire coloniale effective et non immobile n’est peut-être pas le fait qu’elle vienne à point – c’est-à-dire le fait qu’elle puisse servir des stratégies politiques actuelles ou faire écho à des récits entendus depuis longtemps –, mais sa capacité à déstabiliser les histoires que nous cherchons à mettre en récit, à ouvrir des failles intempestives dans les idées reçues, à refuser de céder aux attraits de l’héroïsme, qu’il soit subalterne ou non. Dans les années 1980, Nicholas Dirks a formulé une question qui n’était pas sans rapport, à un moment où la ruée universitaire vers l’histoire coloniale de l’Inde coïncidait avec un regain de nostalgie populaire pour le Raj britannique. Il se demandait si les études coloniales jouissaient d’un tel succès non pas seulement en raison de la présence accrue, en Angleterre et aux États-Unis, d’intellectuels postcoloniaux qui s’identifiaient comme tels, mais aussi parce qu’elles étaient désormais accessibles pour les chercheurs [26].
Les confessions au sujet de l’Algérie française entrent dans le jeu dans la mesure où elles exemptent ceux qui acceptent de parler, comme il en va de la mémoire de ce qui est longtemps resté à l’écart, ignoré, si ce n’est non-dit. Les publications consacrant leur une aux atrocités coloniales sont peut-être devenues des points de focalisation elles aussi, dans la mesure où elles ont pour effet pervers de suggérer que ces vérités individuelles exemptent le collectif (des innocents) : histoire coloniale tout court* – du début à la fin. Il semble aussi que certaines nostalgies soient toujours en mouvement – la nostalgie chic, toute de lin blanc, incarnée par Catherine Deneuve dans Indochine, de même que les plaisirs pédophiles plus osés de L’Amant, qui ont nourri l’image populaire du Vietnam comme destination de tourisme ou de voyage de noce. Mais il revient à ceux qui étudient le colonialisme de se demander et d’expliquer pourquoi et comment certaines questions deviennent assez sûres – tandis que d’autres non – pour faire l’objet d’une consommation publique et d’un intérêt universitaire (intérêt de qui ?) ; pourquoi elles suscitent la curiosité, l’outrage moral, l’ennui, le rejet ou le désintérêt ; pourquoi certains sites d’enquête historique sont présentés comme relevant de l’urgence, quand d’autres apparaissent, au contraire, comme dénués d’intérêt.
Histoires mutilées et aphasie coloniale
Gérard Noiriel a parlé d’« amnésie collective » pour désigner le fait que l’immigration était absente de l’historiographie et des programmes scolaires français. De même, parle-t-on souvent d’« amnésie coloniale » de façon un peu légère pour faire référence au profil public et historiographique très effacé de l’histoire coloniale en France [27]. Kristen Ross voit dans « le fait de maintenir la séparation entre deux histoires » (celle de la France moderne et celle du colonialisme) « une autre façon d’oublier l’une d’entre elle, ou de la reléguer à un autre cadre chronologique [28] ».
Mais l’oubli et l’amnésie ne sont peut-être pas les meilleures façons de comprendre cette séparation bien gardée, ni les procédures qui sont à sa source. Comme Gérard Noiriel l’a dit lui-même en 1987, l’historiographie consacrée à l’immigration « est une question qui reste incompréhensible, pratiquement dénuée de raison d’être » dans le cadre des fictions fondatrices de la République. Plutôt que d’amnésie, je préfère parler d’« aphasie », un terme probablement plus approprié pour décrire la nature de cette disjonction et les caractéristiques de cette perte. Parler d’« aphasie coloniale » au sujet de ce phénomène ne revient pas à pathologiser la perte historique en la réduisant à un déficit cognitif, mais à souligner deux choses, à savoir que ce qui est en jeu n’est pas une perte de mémoire, mais une occultation du savoir. L’aphasie est plutôt un démembrement, une difficulté à parler, à engendrer un vocabulaire qui associe les mots et les concepts appropriés aux choses qu’ils désignent. L’aphasie dans toutes ses formes décrit une difficulté à recourir à un vocabulaire disponible, et plus encore une difficulté à comprendre ce qui est dit [29].
Certains psychologues présentent l’aphasie comme un « déficit de compréhension », d’autres comme un « dysfonctionnement de la compréhension et de la production du langage sous ses formes orales et écrites ». Les individus atteints d’aphasie sont souvent « agrammatiques », en ce sens qu’ils rencontrent des difficultés à comprendre les « relations structurelles » – une anomalie qui révèle une désorganisation cognitive plus générale et plus profonde [30]. Je me garderai de pousser l’analogie plus loin, et je ne veux pas dire que l’histoire en France s’est trouvée réduite à l’aphasie. Mais je pense que l’aphasie, bien plus que l’« oubli », met en relief certaines caractéristiques de la relation que la production historiographique française entretient avec la situation coloniale – un vocabulaire tenu à l’écart, auquel l’accès est limité ; la présence et l’absence simultanées d’une même chose ; la méconnaissance d’une présence. Comme Roman Jakobson nous le rappelle, « le contexte est le facteur décisif et indispensable [31] ».
L’aphasie coloniale a notamment donné lieu à des méconnaissances, comme l’affirmation éculée selon laquelle le racisme serait un problème foncièrement américain, et non français, résumée de la façon suivante par le sociologue Emmanuel Todd en 1994 : « Ce sont les Américains qui ont un problème avec la race, pas les Français. » Le concept d’aphasie renvoie directement au film de Michael Haneke Caché (2005), où le personnage de Georges Laurent, talentueux animateur d’une émission télévisée littéraire, voit son existence bourgeoise et familiale déstabilisée par une série de vidéocassettes qu’il trouve sur le pas de sa porte. Les mémoires d’enfance d’un jeune algérien, Majid, dont les parents travaillaient comme domestiques pour les parents de Laurent et qui vivait avec eux, y sont ponctuées par le meurtre de ces derniers lors du massacre parisien de 1961 et par le départ de Majid pour l’orphelinat. Ce qui est « caché » dans le film, c’est tout autant la caméra que la mémoire ou l’identité du preneur de vues – une histoire de dépossession qui est aussi celle de l’Empire français. Il n’y a rien d’« oublié » chez ces deux adultes. En revanche, il y a une aphasie coloniale, une « déconnexion » entre les mots et les choses, une incapacité à reconnaître les choses du monde et à leur assigner un nom approprié. Pas une seule des recensions élogieuses du traitement « brillant » que le film a réservé au passé dérobé ne recèle un commentaire ou une référence à la trame coloniale qui traverse le film en filigrane, à l’histoire violente qu’il fait revivre, à la « proximité des extrêmes » qui sépare les vies des deux protagonistes.
Mais il existe d’autres sites d’aphasie coloniale qui traversent en profondeur la politique de la dissociation. Ainsi pourquoi, lorsque tout au long des années 1980 et 1990, tandis que les historiens français étaient tellement épris de l’attention que Pierre Nora accordait aux Lieux de mémoire dans sa célébration en plusieurs volumes des sites nationaux du souvenir, les immigrés en étaient-ils absents, comme Gérard Noiriel l’a fait observer [32] ? Pourquoi le seul lieu de mémoire* colonial figurant dans les deux premiers volumes de Nora – qui totalisent cinq mille pages – n’était-il pas appréhendé depuis Saïgon, Dakar ou le bled* dans lequel vivaient des milliers de colons français, mais uniquement à travers le prisme impérial de l’Exposition coloniale* qui se tint à Paris 1931 [33] ? Pourquoi accordait-on tant d’importance à la remémoration du « partage de l’espace-temps » qui séparait Paris de ses provinces, sans faire référence à la distinction politique omniprésente qui traverse encore aujourd’hui les fonds d’archives, les pratiques historiographiques et la mémoire populaire entre ce qui constituait l’« outre-mer » et la France ? C’est précisément sur ce sujet que Pierre Nora a été interpellé par Gérard Noiriel. De même que par Catherine Coquery-Vidrovitch. Celle-ci se souvient lui avoir demandé pourquoi les lieux de mémoire coloniaux étaient absents de ces volumes. Sa réponse fut qu’il n’en existait pas.
Nora n’avait rien « oublié ». Pas plus qu’il n’ignorait l’existence des sites qui se trouvaient ainsi expurgés de l’ouvrage. Bien au contraire, la reconstruction des lieux qu’il considérait comme fondamentaux pour la mémoire nationale française défiait sa propre biographie. Issu d’une famille appartenant à la grande bourgeoisie parisienne* et formé en histoire à la Sorbonne, Nora obtint son premier poste d’enseignement à vingt-sept ans dans un lycée d’Oran (été 1958 à l’été 1960). Lors de son retour à Paris, Nora passa quelques mois à rédiger son premier ouvrage, Les Français d’Algérie [34]. Dans la préface de ce livre, l’éminent historien colonial Charles-André Julien fait l’éloge du talent de son disciple : des capacités d’observation « aiguës » associées à une « formation historique rigoureuse » ont permis à Nora de se distinguer de ceux qui ont embrassé les excès du « totalitarisme anticolonial ». Selon Julien, Nora était au contraire « déterminé à comprendre le milieu dans lequel il [avait] vécu, ce qui exige une volonté de sympathiser qui n’exclut pas pour autant la liberté de juger et, lorsque cela est nécessaire, une certaine sévérité [35] ».
Et il ne se privait pas de juger. Le mépris, à la fois nationaliste et de classe, dont Nora fait preuve à l’encontre de ceux qui étaient les « Français d’Algérie » s’exprime presque à chaque page, et cela de façon criante lorsqu’il décrit les caractéristiques propres à la « communauté française ambiguë ». Ces individus avaient trois traits en commun : tous étaient psychologiquement « déclassés » dans leur propre pays, ils avaient laissé derrière eux une vie « manquée » en Europe, et ils étaient le produit de cent vingt années d’« injections européennes sporadiques d’indésirables ». Pour le dire brièvement, l’histoire des colons algériens que retrace Nora est celle de déportés politiques et de mécontents : une première vague de condamnés à la suite du coup d’État manqué de 1851, une deuxième vague en 1871, constituée de communards vaincus, suivie par une « onde prolétaire » venue d’Europe méridionale entre 1881 et 1901, qui porta la population européenne de l’Algérie à 365 000 personnes – dont la plupart furent naturalisées françaises en 1889 [36].
Le dédain dont fait preuve Nora s’étend peut-être à l’ensemble de ce sous-prolétariat européen, mais sa cible est constituée par les prolétaires espagnols, italiens et maltais qui n’étaient pas des « Français de souche », et qui n’avaient d’autres titres justifiant qu’ils étaient français que leur « carte d’identité [37] ». Pour Nora, le problème de la colonisation était avant tout le conflit entre les immigrants français et ceux qu’il appelle les « néo-Français », « qui avaient perdu leur ancrage en Europe, mais qui ne connaissaient pas la France ». L’antisémitisme, la répression, la brutalité et l’extermination systématique des villages arabes étaient, selon lui, le fait de cette lie migratoire française et européenne, un produit du complexe d’infériorité des individus qui la composaient, une question de « transfert classique » qui n’était due qu’à eux et qu’à eux seuls.
Vu le précédent que constitue ce récit, l’absence de mémoire coloniale – qu’il s’agisse des indigènes ou des Français d’Algérie – dans Les Lieux de mémoire est moins surprenante. Il ne s’agit là ni d’une négligence ni d’un aveuglement. Et, encore une fois, rien n’a été oublié. Il s’agit plutôt, comme Freud l’écrivait en 1891 au sujet de l’aphasie, de ruptures, d’« interruptions » des « liens » et des « systèmes d’association [38] ». Dans le cas de Nora, il s’agit de la grille d’interprétation qui est la sienne, et de l’explication de l’échec d’un projet colonial à partir de l’identité des coupables. Le titre, Les Français d’Algérie, se révèle être une référence mordante et caustique – souvent employée entre guillemets dans le texte – à ceux que Nora n’a jamais considérés comme des Français [39]. On pourrait en effet avancer qu’il n’y a rien de contradictoire dans ces deux moments du récit que fait Nora : l’un concerne les vrais Français, l’autre non.
Une telle aphasie laisse peu de place à une question qui a récemment fait l’objet d’une thèse à l’université de Berkeley : celle de la participation de nazis à la guerre d’Indochine [40]. S’interrogeant sur les représentations qui permettaient de faire comprendre l’occupation française de l’Indochine à l’opinion publique métropolitaine, son auteure, Hee Ko, étudie les récits d’atrocités « de type nazi » commises en 1947 par les troupes françaises en Indochine, et la façon dont ces brutalités ont fait l’objet de comparaisons. Elle montre que l’élite coloniale imposait aux Juifs et aux francs-maçons les mêmes mesures discriminatoires que celles qui visaient les mêmes populations en métropole. Quatre-vingt dix pour cent de la population française d’Indochine avait voté contre la Constitution vietnamienne. Les colons français ne se contentèrent par de « sympathiser » avec les politiques racistes japonaises et nazies ; la Légion étrangère comptait nombre d’anciens officiers et soldats SS, à tel point qu’un ancien parachutiste français a pu la décrire comme « une armée de pirates, de mécontents, d’individus situés quelque part entre le SS et l’homme des cavernes ».
Ces propos hyperboliques doivent nous faire réfléchir. D’anciens officiers français ont rapporté qu’entre 40 % et 60 % des unités de la Légion étrangère stationnées en Indochine étaient commandées par des officiers « d’origine allemande ». Qu’est-ce que cela veut dire ? Est-ce que cela signifie que tous les individus d’origine allemande sont des barbares et des nazis ? Ou que certains Allemands ont rejoint un combat qu’ils percevaient, à l’instar de nombreux soldats français, comme un combat contre le totalitarisme et non comme une guerre coloniale ? Ou, comme le montre Ko, que les Allemands qui rejoignirent les unités d’Indochine auraient été passibles des crimes de guerre s’ils étaient restés en Allemagne ? De toute évidence, l’empire et la nation ont été des catégories distinctes dans l’historiographie française, mais non dans la pratique. Les politiques réactionnaires de Vichy et d’après n’éclipsent pas l’importance de l’empire : elles en sont au contraire un élément essentiel [41]. S’agit-il d’un oubli ? D’un oubli inévitable ? Ou bien d’un cas de méconnaissance conceptuelle et politique, d’erreurs catégoriques qui produisent des distinctions oiseuses et passent à côté des distinctions pertinentes, de difficultés à voir dans l’État colonial et l’État métropolitain les éléments synthétiques d’une formation politique infléchie par la race ?
Si le travail de Foucault sur la société moderne et l’État racial me vient si facilement à l’esprit dans mes réflexions sur l’aphasie coloniale en France, c’est parce que ses intuitions au sujet de la fusion violente entre la race et la biopolitique ont été largement ignorées au cours de la dernière décennie, pourtant marquée par un regain d’intérêt pour ses leçons du Collège de France et pour tout ce qu’il a pu dire et écrire [42]. Encore une fois, lorsque sa leçon de 1976 sur la naissance du racisme fut publiée dans les Temps modernes en 1991, il était possible d’arguer du fait que le paysage intellectuel et politique n’était pas encore « prêt [43] ». Mais cet argument n’est plus défendable aujourd’hui. Le premier de ses cours qui fut publié, Il faut défendre la société, offre de l’avis général l’un des principaux chantiers où l’on peut retracer le développement de sa théorie de la biopolitique [44]. Quant au numéro spécial de la revue Cités. Philosophie, politique, histoire consacré à « Michel Foucault : de la guerre des races au biopouvoir », aucun des essais qui y figurent ne s’arrête suffisamment sur son analyse des racismes d’État pour la mobiliser ou la déployer dans une réflexion portant sur l’État racial défendant la société française [45].
De même, parmi toutes les contributions à l’excellent recueil d’essais Penser avec Michel Foucault. Théorie critique et pratiques politiques, qui porte sur les concepts-clés de critique, de gouvernementalité et de biopouvoir, aucune n’affronte l’argument de Foucault selon lequel « le racisme est la condition qui rend acceptable le fait de mettre à mort dans une société de normalisation [46] ». Ni la notion de race, ni le racisme ne font l’objet d’une entrée spécifique dans l’index. Quelque chose ne va pas lorsque les liens que Foucault a établis entre le génocide colonial et les frontières internes d’un État racial ne méritent ni un paragraphe ni une réflexion sur l’ancrage français de son travail.
Mais peut-être certaines réponses se trouvent-elles dans l’aphasie coloniale et dans l’œuvre de Foucault lui-même. Dans Les Mots et les Choses, celui-ci fait appel à la notion d’aphasie pour comprendre comment les catégories prennent forment et se distribuent, comment les aphasiques dissocient des analogies et rejettent des catégories viables pour les remplacer sans cesse par des associations incompréhensibles qui versent dans l’incommensurabilité, ce qui maintient ainsi les aphasiques dans la recherche anxieuse de nouvelles catégories leur permettant d’assembler les individus et les choses. Comme il l’écrit,
« [les aphasiques] forment, en cet espace uni où les choses normalement se distribuent et se nomment, une multiplicité de petits domaines grumeleux et fragmentaires où des ressemblances sans nom agglutinent les choses en îlots discontinus […]. Mais à peine esquissés, tous ces groupements se défont, car la plage d’identité qui les soutient, aussi étroite qu’elle soit, est encore trop étendue pour n’être pas instable ; et à l’infini, le malade rassemble et sépare, entasse les similitudes diverses, ruine les plus évidentes, disperse les identités, superpose les critères différents, s’agite, recommence, s’inquiète et arrive finalement au bord de l’angoisse [47]. »
Les formations impériales produisent elles aussi de telles angoisses épistémiques parmi les gouvernants, leurs architectes et leurs agents. Les projets impériaux ne se contentent pas de déterminer la façon dont le savoir est organisé, distribué, rendu disponible et conçu. Elles donnent lieu à une politique de la comparaison et créent les conditions de la commensurabilité, en établissant quels attributs constituent une catégorie, en déterminant ceux qui sont viables et ceux qui ne le sont pas.
Fernando Coronil saisit un aspect décisif du projet impérial lorsqu’il voit un « privilège des empires » dans le fait de pouvoir faire de leurs histoires l’Histoire elle-même… fondée sur des dissociations qui séparent des histoires relationnelles, réifient des différences culturelles, et transforment la différence en hiérarchie [48] ». Ce privilège ne vient pas seul. Lorsque Emmanuel Terray, avec une perversité intentionnelle, suggère que la tâche, aujourd’hui, ne saurait consister à s’accrocher à une mémoire réitérée mais au contraire à oublier, il perd de vue ce que les généalogies coloniales du présent sont censées accomplir. Elles n’ont pas pour but de régler des comptes. Pas plus que, comme il a raison de l’affirmer, elles ne devraient ou ne peuvent viser l’« instrumentalisation » d’un « devoir de mémoire » aiguillonné par la « concurrence des victimes ». On ne saurait contrer le privilège impérial qui consiste à faire l’Histoire à partir d’histoires en empruntant des raccourcis rebattus vers le colonial, mais uniquement en écrivant des histoires mesurées du présent qui soient capables de préserver la complexité des enchevêtrements coloniaux.
L’histoire est une voix active qui porte sur le passé et sur des futurs différentiels. Elle exige que l’on prenne la mesure des formes héritées à travers lesquelles les structures matérielles et psychiques des relations coloniales appartenant à un passé imparfait gardent aujourd’hui pour certains une qualité tangible et vivace, alors qu’il s’agit pour d’autres d’événements relégués à un passé composé [49]. La définition que donne Foucault de la critique comme « insolence réflexive » et de la vérité comme « parole courageuse » nous invite à nous demander comment – et sous quelles formes – les histoires coloniales de la France ont conservé certains liens et les ont détachés des histoires que vivent les gens aujourd’hui (qu’ils le veuillent ou non), liens qui méritent qu’on en fasse le récit.
Les Barbares et le rêve d’Apollon
Florence Bernault
« Les tenants des “études postcoloniales” [se] repaissent de discours plutôt qu’ils ne travaillent sur des pratiques sociales mises en situation historique. L’“origine” (Ursprung) de la cité postcoloniale, qui en serait le “lieu de la vérité”, se trouve à leur yeux dans l’ontologie de la colonisation, vouée à se reproduire sous des avatars contemporains en assignant aux sujets leur identité impériale, que celle-ci soit ethnique ou nationale, de classe ou de genre (gender). » Jean-François BAYART [50]
« Il s’agit de mesurer en quoi (et sous quelle forme) se perpétuent, se reconfigurent, se renforcent ou disparaissent des éléments de notre culture qui trouvent leur genèse (ou une partie de leurs origines) dans une “culture coloniale” en formation depuis le XVIIe siècle [...] Nous faisons le pari que [cette] perspective peut être heuristique dans la mesure où elle n’est pas gouvernée par le systématisme et la téléonomie. » Pascal BLANCHARD et Nicolas BANCEL [51]
« En définitive, le “legs colonial”, dans la “gouvernance” contemporaine, [...] structure dans leur intimité les sociétés politiques, celle du “Nord” comme celles du “Sud”. » Jean-François BAYART et Romain BERTRAND [52]
À relire ces extraits, avouons-le d’emblée, l’auteure de cet essai se demanda soudain si la laborieuse refutatio élaborée ci-dessous aurait une utilité quelconque, et si les assaillants du postcolonial ne se tromperaient pas d’ennemis. Où passe la ligne de partage entre auteurs qui s’inspirent des études postcoloniales et leurs adversaires déclarés ? L’observatrice naïve, pelotonnée dans sa sinécure américaine, se prend à rêver de concorde intellectuelle. Une dose de Cooper-Stoler le soir avant le coucher, peut-être ? Le médicament est éprouvé, la recette vieille de dix ans, les auteurs reconnus par l’establishment hexagonal [53]. Un extrait de Gilroy ou d’Appadurai ? Sûrement untel sera-t-il convaincu par la subtilité de l’argumentaire. Chose n’aurait rien à y redire, il a vu pire dans son terrain. Machin pourrait même devenir un converti. Soulignons d’ailleurs que les « études postcoloniales » n’existent pas vraiment. Mais cher ami, tout le monde sait cela. Tout au plus une constellation de propositions sans système ni conclusions déterminées. Des schèmes de pensée, certes, qui s’enracinent dans les aires non européennes et rejettent le grand récit des Lumières. Mais pas de problématique unique. Pas d’écoles intellectuelles à proprement parler. Certes, un champ privilégié, le colonial, où s’observent constructions culturelles et sociales inédites, mais enfin, tout ceci tient à peine ensemble, maigre provende pillée par une bande de maraudeurs grandiloquents.
L’oreille de la rêveuse se fait rétive aux hallalis. Pourtant, avec quelle âpreté continuent-ils de résonner dans l’Hexagone ! Depuis 2005, les quolibets journalistiques prolifèrent contre ces soi-disant « auto-flagellants », « nouveaux racistes », « indigènes lepénisés » et autres lampistes de la peste communautariste [54]. On pointe leur duplicité morale, à l’instar de ces quelques plumes affolées qui ne trouvèrent mieux que de comparer en 2003 les historiens du Groupe de recherche Achac à une bande de néopropagandistes coloniaux, prospérant au détriment de ceux qui les écoutent, indigènes réduits au rôle de stéréotypes ou de victimes [55]. Du sein feutré de leurs bibliothèques savantes, les universitaires aiguisent des pointes sur les postcoloniaux, esprits faibles convertis aux élucubrations anglo-saxonnes ou revenus, illuminés, de nouveaux Damas [56]. Chaque mois apporte sa bordée de sarcasmes sur leur opportunisme intellectuel, leur appât du gain (la « patrimonialisation » du passé), leur naïveté politique (l’ethnicisation du social) et leur morale à courte vue (la repentance) [57].
Sait-on assez quel gouffre sépare ce champ de bataille du paysage universitaire des années 1980 et 1990, lorsque régnait parmi les africanistes, marginaux chevelus aux théories obscures, une gentille résignation face à l’ignorance dominante sur le passé colonial et les « mondes extra-européens » (euphémisme pour extra-terrestres) [58] ? Si quelques brefs éclairs avaient traversé ce ciel sans nuage au milieu des années 1990, le Groupe de recherche Achac ayant commencé de trouver traces et preuves que le passé colonial travaillait encore la société française moderne, rien ne préparait vraiment les universitaires aux batailles du siècle à venir. Formée à Paris 1, Paris 7 et Aix-en-Provence par des historiens de l’Afrique observateurs passionnés de la domination impériale et de l’invention de la modernité africaine, j’avais quitté, en 1996, cette douce atmosphère de camaraderie désabusée pour partir enseigner aux États-Unis, où une autre forme d’endormissement menaçait. En Amérique, les lectures subalternistes et postcoloniales font partie du canon et fleurent vaguement le concept en cours de dévaluation. On lit les bons et les moins bons auteurs par devoir professionnel, et nul ne songe à s’alarmer de leurs répercussions sur le cerveau délicat des étudiants, encore moins sur le corps social.
On sait comment, de l’autre côté de l’Atlantique, l’irruption du paradigme colonial en 2005-2006 secoua ces certitudes intellectuelles. Mais on oublie souvent l’ampleur du paradoxe universitaire qui accompagna ces remaniements : face à la crise, les attaques les plus virulentes vinrent de la science politique et de l’anthropologie française et, autre remarquable particularité hexagonale, d’universitaires spécialistes de l’Afrique et de l’Asie. Qu’est-il donc arrivé aux gentils chevelus de notre jeunesse ?
Dans un contexte d’effondrement de l’influence des productions françaises sur le marché global des idées, l’affrontement entre pro- et anti-postcolonial studies a révélé des failles profondes dans le fonctionnement de la recherche et l’enseignement des sciences humaines et sociales. La nouvelle reconnaissance des paradigmes coloniaux et postcoloniaux dans l’analyse des faits sociaux contemporains a incité de nombreux chercheurs à prendre une conscience plus aiguë et plus critique des concepts produits à l’extérieur et à l’intérieur de l’Hexagone, de leur hiérarchie cachée, de leur domination implicite et de la possibilité de leur remise en question. Mais elle a aussi mis en évidence une série de blocages propres à l’Université française, y compris un inconscient scientifique travaillé par de vieux fantasmes. Aussitôt que l’on s’amuse à plaquer sur les débats le vocabulaire des angoisses romaines de la décadence, ou l’arrogance des Lumières intronisant la France en pôle de l’universelle raison, les avatars impériaux de ces hiérarchies mentales resurgissent.
La critique à large spectre développée depuis 2005 sur le site de l’association savante du Fasopo (Fonds d’analyse des sociétés politiques) se prête bien à cette radiographie [59]. Sous couvert d’affirmations générales, moins dictées par un engagement précis avec les textes incriminés que par l’établissement d’une règle et d’une orthodoxie, les deux chercheurs les plus prolifiques de cette mouvance, Romain Bertrand and Jean-François Bayart, ont entrepris d’expliquer aux observateurs du social comment dévoiler l’erreur postcoloniale, combattre l’impuissance analytique et redécouvrir les bons manuels de méthode, testés et approuvés par la Faculté. Ces querelles de compétence ont pris la proportion d’un véritable rappel à l’ordre disciplinaire, propulsant le Fasopo et les travaux des politistes sur un piédestal, du haut duquel seuls quelques experts ont le droit d’édicter la norme et de combattre l’hérésie. Certes, pendant qu’on court défendre les portes de Rome contre les hordes coupeuses de cheveux en quatre et tronçonneuses de concepts à la hache (si ce n’est pas l’un, c’est l’autre [60]), il est tout naturel d’abandonner son échoppe, voire de prendre, sous l’orage, la tête des brigades citoyennes. Le problème est d’éviter le soliloque.
Regardons Romain Bertrand s’avancer sur le champ de bataille. Armé de mille précautions oratoires et rassurant l’auditoire à grand renfort de conditionnels et d’articles indéfinis, il annonce s’attaquer aux « erreurs de méthode à l’œuvre dans les travaux de certains des auteurs des postcolonial studies », qui, selon lui, auraient été identifiées par les « historiens, sociologues et anthropologues [61] ». Une seule discipline est oubliée dans cette convocation de censeurs : la sienne. Ainsi propulsé unique porte-parole de sciences comptant, ne serait-ce qu’en France, plusieurs centaines de professionnels, héraut d’une convention disciplinaire dont il efface par là-même les frontières d’usage, Romain Bertrand ne recule pas devant ce léger détail – même claironné mille fois par l’adversaire – : parler à la place des autres.
Sanglé dans ces certitudes critiques, le jeune politiste dévoile donc à la face du monde universitaire consterné l’ampleur des erreurs des postcolonial studies sous la forme d’une impressionnante liste de monstres en –isme dont le manque d’exemples précis n’affaiblit en rien (c’est la vertu des vapeurs inquisitoriales) le pouvoir stupéfiant [62]. Les grotesques réduits à néant, une conclusion solaire s’élève : sous l’apparente innovation des postcolonial studies, celles-ci sont d’une consternante banalité [63].
C’est au tour de Jean-François Bayart d’occuper l’arène [64]. De quelle originalité se targuent les postcolonial studies, souligne-t-il, quand leurs balourds affidés ne font que copier les avancées critiques de la French Theory [65] ? La polémique n’est-elle pas en effet l’occasion de se souvenir que l’Université française a déjà, dès longtemps, tout compris ? Sphinx toujours renaissant de ses cendres, ne continue-t-elle pas de proposer au monde une inépuisable fertilité créatrice ? Jean-François Bayart insiste : les études postcoloniales sont « heuristiquement pauvres », leurs concepts « superflus » ou « superfétatoires ». Les débats dont elles se réclament ont été ouverts dès longtemps par Gramsci, Thompson, Foucault, Deleuze, Guattari, Balandier, Althabe et Leiris. Pourquoi aller se faire pendre hors de la Belle Europe ? Achille Mbembe fit du bon travail sur le nationalisme pendant son séjour au sein de l’Université française, suggère-t-il. Quelle mouche le piqua de se « convertir » au postcolonial [66] ? Migrer aux États-Unis, en Afrique du Sud ? Pagayer loin des rivages tempérés, à la recherche d’un évasif archipel où quelques Vendredis s’échinent à singer la parole du maître, accouchant seulement d’une piètre novlangue dont la meilleure vertu est d’exciter le rire [67] ?
Ah, le destin éternel de l’élégance française… Faire rendre raison au sauvage… le passer au filtre de l’élégante et subtile raison cartésienne, spécialité de l’Hexagone... Gaussons-nous à grands cris…Comment peut-on encore être Persan ! On a déjà donné [68] !
Gageons pourtant qu’à l’office on fait savonner des gueux les hardes clinquantes qu’on ira tout à l’heure endosser. Car l’Université française, dans sa catholique générosité, ne fermera pas les bras aux égarés. Pour les cas mineurs, nos collègues de la rue Monsieur-le-Prince (temporairement stationnés dans le Marais, ô ironie de la toponymie parisienne) ont concocté un traitement d’attaque. D’abord, assainir le terrain et appliquer quelques règles d’hygiène de base : ramenons, nous disent-ils, le colonial et le postcolonial aux « vertu[s] cardinale[s] » (sic) de l’« histoire impériale comparée [69] ». Grâce à ces saines méthodes historiques, qu’eux-mêmes ont sûrement pratiquées sans faille dès leur entrée à Sciences Po, l’intoxication postcoloniale décroîtra rapidement chez le patient. Il sera temps alors de solutionner un problème éthique urgent. Les chercheurs, aveuglés par l’hérésie, ont abandonné l’analyse des sociétés conquises. L’heure est grave, Romain Bertrand diagnostique : un « second oubli des histoires indigènes » [70] se profile, les sociétés africaines ou asiatiques n’apparaissent qu’« en contrepoint ou en filigrane dans la plupart des écrits des historiens français ou américains de la colonisation » ! Heureusement, les équipes de secours s’organisent. Oyez, bonnes gens, une « nouvelle histoire impériale » émerge, nous promet le jeune auteur de la rue Vieille-du-Temple, appuyée sur de « nombreux travaux » en cours, dont il nous donne pour unique mais lumineuse référence un numéro de revue qu’il codirigea [71]. Que les dizaines d’historiens de trois ou quatre continents occupés depuis trente ans et plus à l’analyse de l’Afrique, de l’Asie, etc. fassent amende honorable et se rassurent, une fraîche génération de French Doctors se lève pour sauver celles-ci du lourd silence qui les étouffait [72].
Une fois la communauté scientifique admonestée urbi et orbi, il est temps d’administrer au patient une pharmacopée plus radicale. Sortie tout armée de la cuisse du Fasopo, entre en scène de manière triomphale la « sociologie historique du politique », discipline mûrie dans le temple de la science politique française et seule capable, nous dit-on, de « soustraire la problématique des continuités du colonial à ses usages militants » et de « la constituer en véritable objet sociologique [73] ».
Exilée dans la pampa nord-américaine, engoncée dans un conformisme de migrante et plongée dans la lecture des postcolonial studies afin de donner des gages idéologiques à notre institution d’accueil [74], nous avions (vaguement) entendu parler de la sociologie historique de Weber. La voilà accommodée, pour notre plus grand plaisir, à la sauce politologique. Quelle bouffée d’air frais que de voir cette race nouvelle d’universitaires (les socio-historico-politicologues ?) remembrer les vieux cadastres, fouler aux pieds les barrières disciplinaires et prendre la peine d’expliquer à leurs poussiéreux collègues, penchés sur de tristes « sources » (hélas, bien mal nommées), la manière de construire leur récit en se préservant de leurs démons intimes, M. Continuitisme, M. Anachronisme, M. Mécanisme et Mme Simplification Abusive ! Après tout il n’est jamais inutile d’être rappelé au devoir de balayer son perron, fut-il d’exil (bien qu’on imaginerait plutôt, dans ce cas, une scène bouffonne : le brave historien prenant l’air entre deux brassées d’archives et voyant, ébahi, le bulldozer du collègue du quartier Saint-Germain changer subitement de course et venir pilonner son vieux paillasson).
Chaussons nos lunettes et regardons-y de plus près : que nous propose la sociologie historique du politique ? Quelle est son ambition à part lutter contre la manie des mauvais historiens de « dé-historiciser » le fait colonial, de le « substantiver », de postuler « sa reproduction mécanique », de l’ériger en « prophétie auto-réalisatrice », de réduire l’action des subalternes à un « rituel d’affliction doloriste ou morbide », de « ne pas comprendre que les espaces coloniaux ont été des espaces moraux », de « fantasmer l’empire en Léviathan », de raisonner « en termes utilitaristes », de « poser des pétitions de principe ontologiques tout en restant prisonniers du narratif national de la situation coloniale », bref, de plonger à pieds joints dans la « régression scientifique » [75] ?
La nouvelle discipline, nous dit-on, encourage quant à elle une approche comparative des empires et cherche à restituer l’historicité propre des sociétés colonisées, en se souvenant que celles-ci échappent en partie au colonial et, au mieux, entretiennent un rapport dialogique avec lui [76]. Programme utile et intéressant, à défaut d’être neuf. La sociologie historique du politique insiste en produisant deux concepts, le « legs » colonial et la « transmission hégémonique » (en clair : comment les autorités coloniales et postcoloniales ont négocié les effets de domination dans les empires et post-empires), dont l’une des raisons d’être est d’éviter les erreurs du « continuitisme » reprochées aux postcolonial studies. Arrêtons-nous un instant sur cette attaque.
Continuitisme et effets de dissolution
Le reproche de continuitisme (ou d’historicisme) revient souvent à oublier que la fertilité de toute chaîne problématique et narrative repose, quelques soient les précautions à prendre, sur le choix et la défense d’un rapport de sens chronologique, théorique ou généalogique appliqué à la réalité étudiée. La lecture du présent et du passé, comme tout récit de la relation entre les deux, est donc un acte simultanément analytique et productif.
La relation posée par les postcoloniaux entre moment impérial et monde contemporain n’est donc qu’une théorie comme une autre, et à ce titre ouverte aux critiques. Mais reprocher le fait même d’oser dresser des ponts entre divers pics du temps (ou ce que nous nous représentons comme tel) est une imposture et un sophisme. À ce compte, sous couvert de simplification abusive, de continuitisme béat ou d’inattention empirique, il faudrait invalider a priori les grandes narrations explicatives qui nous ont depuis deux cents ans aidés à discerner quelque logique dans le chaos de l’histoire. On ne sait pas que ceux qui alertent aujourd’hui sur l’effet délétère des postcolonial studies sur les « passions identitaires », la « demande sociale », la « mémoire collective des jeunes Français [77] » appliquent leur sourcilleuse critique à ces concepts, brandis comme allant de soi. Quant aux travaux des politistes, sont-ils exempts de tels choix ? Jean-François Bayart a fameusement esquissé la « fusion des élites » en Afrique comme un modèle généralisable de captation de l’État au moment des indépendances. Il a, avec la « politique du ventre », suggéré l’importance continue d’un mode politique africain de subjectivation-action [78]. Aujourd’hui, lorsqu’il élabore l’hypothèse d’une histoire longue des stratégies d’extraversion, c’est-à-dire la capacité historique de l’Afrique à utiliser l’inégalité de sa relation avec l’extérieur, de la traite atlantique aux dépendances contemporaines, ne pose-t-il pas en hypothèse la persistance temporelle et structurelle d’un principe de rapport au monde des sociétés africaines [79] ?
Or, tout en postulant que l’influence du « moment colonial » sur la construction progressive de nos « présents » sociaux, politiques, culturels ou économiques (la définition de ces termes restant question ouverte) n’est ni exclusif ni exhaustif, et que l’on ne peut comprendre la chaîne de ces héritages productifs sans faire la part de multiples influences autres que celle d’ordre colonial [80], les postcoloniaux ont le mérite de mettre en avant une problématique claire et un effort concerté. Ils défendent l’hypothèse que le concours du colonial au façonnement (chaotique) de la modernité européenne, asiatique ou africaine est essentiel et non marginal à la compréhension de nos multiples présents. Ils insistent sur le fait que si l’on ne reconnaît pas qu’il y a du continu et de la détermination, des relations logiques et chronologiques, textuelles, iconographiques, monumentales, institutionnelles et identitaires entre les deux mondes (métropoles et colonies) et les deux périodes (passé colonial et présent), on se condamne à ne guère comprendre l’un ou l’autre. Ils travaillent, enfin et surtout, à écrire l’histoire des multiples facettes de ce processus (les « zoos humains », l’idéologie républicaine en France, les politiques de l’immigration, la culture populaire) selon eux fondamental.
Face à ces efforts d’élucidation, la sociologie historique du politique offre surtout des tactiques de dissolution.
Ses hérauts proposent d’abord de remplacer le répertoire historien classique par une profusion de métaphores spatiales. Se rêvant géomètres et explorateurs, ils promettent de dresser ainsi une « carte plus complète des legs coloniaux » et de délimiter un « champ des continuités historiquement situé et sociologiquement circonscrit [81] ». Des prés bourdieusiens, on passe ensuite à Foucault et au laboratoire du petit chimiste pour décrire les processus coloniaux comme une série d’« interactions », de « superpositions », de « concaténations » et de « combinatoires », d’« imbrications », de « surajouts », d’« interfaces », de « réverbération », de « réfraction », de « précipitations » et d’« alchimie[s] » [82]. Ce laborieux réhabillage lexical permet, certes, de brosser un tableau avantageux de l’infinie complexité des « trajectoires » coloniales [83]. Mais qui recherche le sens réel de ces contorsions prodigieuses, quittant le paysage grandiose des généralisations, devra revenir au labeur d’une histoire critique et explicative serrée.
Le second effet de dissolution s’obtient en banalisant l’impérial et en dynamitant l’idée que les trajectoires du legs colonial puissent se penser d’abord entre anciennes colonies et leur métropoles. Romain Bertrand et Jean-François Bayart reprennent ici l’idée qu’aucun empire ne fonctionna comme un isolat et que les pratiques et idéologies impériales furent affaires d’influences globales et pan-coloniales [84]. Il s’agit ici surtout de contester que les traces coloniales en France puissent se comprendre d’abord sous l’angle de relations bilatérales avec « ses » ex-colonies. Dans cette perspective, le fait que les immigrés et les citoyens français de couleur d’aujourd’hui souffrent d’un racisme hérité en partie des exactions coloniales d’hier ne serait donc qu’une chimère historiciste.
De plus, l’argument de la banalité impériale permet d’écarter celui des postcoloniaux selon lequel le moment colonial est fondateur de la modernité, et du coup remet le national sur son piédestal. Pour Romain Bertrand, les impérialismes des XIXe et XXe siècles ne seraient qu’une nouvelle génération de « jeunes empires » surimposés à un « vieux fond d’imaginaire impérial eurasiatique », avec, certes, un poil de racialisation et d’ethnicisation. En conséquence, le passage des États à une forme nationale serait la « vraie question » à résoudre [85]. Idée renversante, et que Romain Bertrand espère sans doute copernicienne : il s’agit de montrer que ce fut le national qui succéda au colonial et non l’inverse, les États modernes apparaissant au XIXe siècle, voire un siècle plus tard, au moment des décolonisations, dans leur désengagement ultime des vieilles formes impériales. Les postcoloniaux au contraire insistent sur le paradoxe qui informe ce passage : si les nations modernes sonnent le glas des vieux empires, elles le font en créant une nouvelle forme impériale, le colonialisme, matrice historique qui engage toujours une part significative de la vie des nations modernes.
Dernier effet de dissolution : brouiller l’hypothèse des héritages coloniaux. Les prises de position du Fasopo sur ce plan sont un véritable tissu de contradictions. D’un côté, Jean-François Bayart et Romain Bertrand rappellent à l’envi que le moment colonial n’a été qu’un moment des trajectoires des sociétés indigènes, lesquelles ont su préserver leur « historicité propre ». L’école historiographique de langue anglaise ayant, depuis trente ans, exploré jusque dans ses plus intimes recoins l’idée de la résilience des colonisés et la part créatrice qu’ils prirent aux formes de modernité proposées/imposées par le régime colonial [86], cet élément de la démonstration n’est pas le plus original (la surprise venant plutôt du fait que ce beau savoir n’empêche pas le Fasopo de déplorer le long silence observé sur les sociétés conquises). Mais se servir de cette idée pour prétendre que les postcolonial studies occultent l’histoire et l’autonomie des sociétés colonisées est un véritable contresens, d’autant qu’on reproche simultanément aux subaltern studies et à leurs héritiers d’avoir renforcé voire exagéré l’attention à l’irréductibilité de ces dernières. Ayant rappelé donc à qui n’en avait pas besoin l’historicité des sociétés colonisées, Jean-François Bayart et Romain Bertrand font, d’un autre côté, bataille d’érudition pour insister sur l’impact du colonial parmi elles. Énumérant une lourde masse critique de transferts nord-sud, de la « perpétuation du territoire politique » des jeunes États indépendants, des « identités cristallisées durant le moment colonial », de l’enclenchement du « mécanisme de la prééminence des classes dominantes », des « racines » coloniales de la culture matérielle et symbolique de l’État contemporain, ils concluent : ceci « procèd[e] en ligne droite du moment colonial et de l’épistémè impériale [87] ».
D’où viennent de telles contradictions ? Du fait que pour les chercheurs du Fasopo, le moment colonial peut être générateur, mais surtout au Sud. La majorité des exemples qui leur servent à démontrer la perpétuation des influences coloniales proviennent des sociétés ex-colonisées, non des métropoles, reflet d’un vieil inconscient scientifique colonial et ethnocentrique [88]. Au sortir d’un siècle de débauches impériales, les nations du Nord surgissent miraculeusement indemnes des démonstrations du Fasopo. Elles restent le lieu des soubresauts imprévisibles, des circulations complexes et autres tressaillements insaisissables d’une histoire contingente de civilisés qui ne peut jamais être déterminée par le passé, surtout pas lorsqu’il est impérial. Face à elle, le bon sauvage, planté dans son terroir, illustre la vieille idée que ce sont les cahots brûlants mais fertiles des empires qui font naître, de la glaise froide du champ primitif, la modernité.
Les nouveaux Darwins
Venons-en à la seconde critique adressée aux postcolonial studies : l’ethnicisation du social. Au-delà du débat intellectuel en effet, l’énergie sociale de la dispute postcoloniale constitue le phénomène hautement original du cas français. Alors que plusieurs pans de la société se sont emparés du (post)colonial pour comprendre les discriminations et les conflits contemporains, l’angoisse de leurs adversaires est frappante. Il ne s’agit pas seulement de parler boutique ou de débattre concepts, mais de sauver la peau du pays [89].
Nous n’avons pas le temps ici de cartographier ces anxiétés, seulement d’en dresser les soubassements philosophiques, et en particulier l’existence en France d’un darwinisme social aussi inconscient que délétère. Tout se passe comme si, pour ceux qui s’effarent des postcolonial studies, les dynamiques sociales suivaient un ordre préétabli sur lequel tout le monde s’accorde en silence. L’axiome est le suivant : les identités particulières menacent le « tenir ensemble » de la communauté nationale. Sous la modestie de la sentence bout un extraordinaire maelström de présupposés méthodologiques et doctrinaux, et une indomptable énergie normative. Il est entendu une fois pour toutes que c’est ainsi que les sociétés vivent et meurent.
La doxa postule que la pyramide sociale fonctionne selon l’emboîtement d’unités plus ou moins grandes, plus ou moins inclusives, et plus ou moins (dys)fonctionnelles. Au bas de l’échelle, l’individu, puis la famille, la fratrie, le terroir et les loyautés géographiques, l’ethnie, la race, la religion ou le genre. Dans les strates supérieures, des institutions qui englobent mieux : classes sociales, partis et syndicats, grandes institutions républicaines et démocratiques, la conscience nationale, le droit collectif. Opposées à la puissance de cohésion de ces dernières – épines dorsales d’un « pays » en pleine santé –, les premières sont envisagées comme un amas de cellules radicales et informes, réservoir de germes antisociaux. Même si les analystes conviennent de l’existence de dynamiques transversales (le genre, l’appartenance de classe ou la race), ils ne peuvent s’empêcher de voir les identités ou groupes « restreints » comme potentiellement destructeurs de plus larges solidarités sociales [90]. Entre mille exemples impossibles à citer ici, l’idée circule que la communauté nationale serait « profondément stabilisante » et inciterait les individus à se rassembler en fonction d’un contrat social pour créer une « cité » politique dans laquelle les particularismes auraient vocation à s’effacer. En revanche, l’« identitarisme » (entendre la recherche d’identités primordiales centrées sur l’individu et le petit groupe) proposerait la reconstitution de communautés à partir de l’exclusion de l’autre [91]. En poussant l’idée jusqu’au bout, on peut renverser l’axiome : plus les unités sont restreintes, plus elles sont affublées par les analystes d’une marque de radicalité latente. En d’autres termes, le pouvoir de dissolution collectif des groupes restreints résulte non de leur idéologie, mais de leur taille.
Non seulement cette pensée naturalise le social et use d’un vocabulaire organiciste pour décrire les dynamiques des communautés ou des groupes comme autant de mécanismes physiques et pathologisés, elle peint depuis une dizaine d’années un effrayant tableau de crise de la société française. De sombres et brillantes métaphores évoquent l’atomisation de la « nation » ou de la « République » française, imaginée comme un corps sain guidé par la raison et devant sans cesse lutter contre le travail de sape de ses éléments plus primitifs – ou, depuis la vogue de la mondialisation, contre la dissolution du multiculturalisme et de la globalisation. Pendant que Dominique Schnapper étudie l’« affaiblissement du civisme et des liens politiques », Michel Wieviorka formule :
« [un bilan] en termes de liquidation [...] là où nous parlions hier de rapports de production et de luttes de classe, il nous faut aujourd’hui nous préoccuper d’exclusion, de précarisation et de décomposition du lien social. La France [...] voit s’affirmer un nationalisme xénophobe, raciste et antisémite, traduction politique d’un vaste ensemble de peurs et d’inquiétudes dont les plus décisives procèdent d’un sentiment de menace sur l’identité nationale. Elle découvre aussi la poussée de divers particularismes régionaux, religieux, ethniques, de genre ou autres, généralement appréhendés comme autant de défis à son modèle national d’intégration républicaine [92]. »
Contre l’anarchie destructrice, la nation et la République, à défaut la classe et le syndicat, restent pour la mouvance néodarwinienne des maux nécessaires, un barrage, lézardé et érodé mais essentiel, contre le flot des particularismes. Et qui mieux que l’État, incarnation de la volonté des citoyens comme chacun sait, pourrait mieux affronter cette tâche de Sisyphe ? Sorti tout rapetassé de Hegel et de Weber, astiqué à la Sainte Alliance germanique, il s’impose comme l’unité d’analyse majeure et comme l’antidote essentielle contre les postcolonial studies. Et comme la sociologie historique du politique se concentre malgré ses dénégations sur la gouvernance, les institutions et les groupes sociaux « porteurs des transmissions hégémoniques » (lire les dominants), nous ne sommes pas sortis de l’auberge des préjugés régaliens [93].
Quant à décrire les groupuscules qui menacent la nation et son grand corps malade, les néodarwiniens n’hésitent pas à puiser dans un savoureux gothique colonial mâtiné d’ironie des Lumières. Pour l’académisme savant, le monde semble divisé entre chevaliers de la raison pondérée et populaces houleuses prêtes à se prostituer aux pires chants de sirènes. D’un côté, la République et l’empire de la raison [94] ; leur moteur est le contrat et le libre-arbitre, leurs défenseurs les savants. Délestés des soucis matériels et blindés contre la faute idéologique, ceux-ci arborent l’armure du savoir impartial, de la distance critique et du « regard froid de l’historien ». De l’autre, les classes inférieures, esprits égarés ballotés entre tentation mondialisée et retour aux instincts bas. Chez les pauvres en effet, la chair est faible. Ainsi, ce sont surtout les « besoins » qui dictent l’ennuyeuse « demande sociale » des dépossédés, confirmant aux yeux des intellectuels leur désagréable propension à se jeter, en l’absence de baume idéologique, sur toute espèce de compensation sonnante et trébuchante [95]. Exposés à la première manipulation idéologique venue, leur seul mode d’action politique est archaïque, réduit selon les analystes à d’absurdes coups de boutoir et à des « réflexes sociaux » rudimentaires [96]. Le « communautarisme [97] », ou ce que l’on nomme aussi la « logique des minorités », est une forme de régression politique, un trouble de la raison submergée par les débordements du corps sauvage [98].
Le répertoire du colonisateur ensauvagé est particulièrement frappant lorsque les analystes évoquent le risque de guerre civile en termes à peine voilés [99]. Pour Jean-Pierre Rioux, historien affligé de la France contemporaine, les « politiques de l’identité qui assignent les individus à leur origine et non plus à une mémoire partagée et sécularisée », encouragent ceux-ci à entrer dans un « cycle de violence civile et d’exclusion sociale puis raciale, au nom de l’atavisme [100] ». Remis en selle, les experts du tiers monde sont convoqués comme experts des ethnicismes et évoquent de sombres cas d’études. Jean-Pierre Chrétien, spécialiste du Burundi et des génocides dans la région des Grands Lacs africains, s’effare des « enfermements sectaires de toutes natures », visibles selon lui dans l’appel des Indigènes de la République : « On connaît ce débat dans l’étude des génocides du XXe siècle. La défense aveugle des identités, quelles qu’elles soient, [...] peut devenir meurtrière [101]. »
La secte, l’ethnie, l’atavisme, les passions : ne sont-ce pas là, déguisées sous les oripeaux du jour, les marques du sauvage ? Les néodarwiniens du social l’ont compris : les Barbares sont de retour au cœur de Rome.
Antiques et Goths au cœur de Rome
Or ce que montrent précisément les nouvelles études coloniales et postcoloniales, c’est que loin de fonctionner comme des unifiants sociaux, l’État moderne, le cadre national et la prescription républicaine peuvent devenir – sont devenus dans les colonies – la condition même de nouvelles divisions et ségrégations sociales. Dans le contexte impérial, les bureaucraties impériales déclenchèrent de véritables entreprises de fragmentation et de régression sociales, conditions mêmes de la domination blanche [102]. La racialisation, l’ethnicisation, l’invention de la différence insurmontable, paradigmes apparus pour la première fois dans les empires modernes (XIXe-XXe siècle) comme instruments privilégiés d’action sur le social et sur sa représentation, furent portées sur les fonts baptismaux par l’État colonial, un État basé sur la promotion de la modernité bureaucratique, scientifique et démocratique, éclairé par des idéaux humanistes, mais aussi travaillé de l’intérieur par la violence, l’assignation ethnique, l’exoticisation, la traditionalisation et la pathologisation du corps social.
Ceux qui nient l’importance du moment colonial dans la construction de la modernité rappellent que l’idéologie de la race et la bestialisation des minorités ou des inférieurs étaient en germe dans la noble morgue de l’époque moderne et les préjugés de classes au XIXe siècle, et explosèrent plus tard dans le fascisme. Mais le racisme colonial est d’une essence différente : il ajoute un cadre humaniste et paradoxal à ce schème, la mission de transcender les différences. Les élites se projettent non seulement comme appartenant à une race supérieure, mais aussi dans la croyance au projet d’« assimilation ». Avec l’injonction d’imitation et de commensurabilité jetée à l’Autre, la volonté d’un lien est créée au moment même où la différence est instituée comme insurmontable. N’y voit-on pas une ressemblance avec la manière dont l’assignation à l’« intégration républicaine » des minorités fonctionne aujourd’hui en France ?
Pour saisir les contours de cette histoire complexe et contradictoire, la stratégie des postcoloniaux est de multiplier les angles de vue et de tester dans les plus infimes, parfois les plus invraisemblables recoins de l’Occident et des colonies les traces, les silences et les fantômes d’événements qui souvent n’apparaissent qu’à travers réfractions indirectes ou échos déformés. Les engendrements idéologiques et institutionnels sont donc envisagés d’emblée par les chercheurs de cette mouvance comme triviaux, subtils et élusifs, traversés de coupures et mêlés à de multiples influences. Cette quête méticuleuse et empirique n’a ni pour fin ni pour phare l’État, ce grand fétiche des penseurs politiques français.
Elle se conduit aussi sur le terrain, aux antipodes des postures d’auto-suffisance en vogue à Saint-Germain et chez les nostalgiques de la suprématie intellectuelle française. Les postcolonial studies sont à l’écoute d’autres perspectives épistémologiques qui ignorent l’Europe autant que faire se peut, en circulant du Sud au Sud, ou ailleurs. Accepter que les autres se regardent sans nous [103] est certes une désagréable sensation quand on s’est cru si longtemps le centre du monde. Mais dans la perspective de cet oubli créatif (sur la possibilité ultime duquel les postcolonial studies n’ont d’ailleurs aucune illusion [104]), de nouveaux paysages historiques ont surgi, comme celui de l’engendrement des nations à leurs limites [105]. Enfin, les postcoloniaux observent un certain nombre de précautions méthodologiques dérivées d’une longue réflexion sur les politiques de production du savoir. Inaugurée par l’autocritique des anthropologues dans les années 1970, la déstabilisation systématique des chercheurs [106], la prise en compte de leur relation politique et historique aux problématiques dites scientifiques et à leurs propres « objets » d’étude, la conscience qu’ils travaillent dans le contexte d’une ignorance asymétrique sont devenus des réflexes heuristiques pour la mouvance postcoloniale et pour les historiens classiques des aires colonisées, en tous cas dans le monde anglophone [107].
Sourd à ces petits cultes de la raison des autres, les adorateurs inquiets massés au temple d’Apollon n’ont pas fini de jouer avec le mirage de l’universel, même si celui-ci ressemble de plus en plus à un avatar de la pensée magique. Les Barbares, dit-on, leurs bonnes paroles et leurs petits travaux affaiblissent le tissu social, allument les haines identitaires et ouvrent la porte à la guerre racialo-ethnique. Car pour les zélateurs de l’idéal franco-républicain, les pourfendeurs des postcoloniaux et les adorateurs de la magie apollonienne, dire c’est faire exister. Hélas, entre-temps le principe de réalité avance. L’ennemi menace, la décomposition s’étend. Les Barbares arrivent ? Ah, chevalier, que ces hordes meurent donc par votre beau fleuret !
NOTES
[1] Certaines parties de cet article ont fait l’objet d’une communication précédente au cours de session plénière de cette conférence, « 1951-2001 : Transatlantic Perspectives on The Colonial Situation », avril 2001. Une version plus longue de cet essai, comprenant une réflexion plus poussée sur la relation entre postcolonial studies et État racial en France est destinée à paraître en 2010 dans un forum de la revue Public Culture sous le titre « Colonial Aphasia : Race and Disabled Histories in France ».
[2] Dans cet article, les astériques signalent des mots ou expressions en français dans le texte original (note du traducteur – N.d.T)
[3] Cet ouvrage, paru aux éditions de Minuit (Paris) en 1959, fut saisi et interdit de publication par le gouvernement français. Il reparut par la suite en anglais (The Gangrene, Lyle Stuart, New York, 1960).
[4] Beauvoir S. de et Halimi G., Djamila Boupacha, Gallimard, Paris, 1962.
[5] Judt T., Past Imperfect. French Intellectuals 1944-1956, University of California Press, Berkeley, 2002.
[6] Balibar E., « Uprisings in the “Banlieues” », Constellations, vol. 14, n° 1, mars 2007, p. 47-71.
[7] Malinowski B., « Dynamics of Culture Change [1946] », in Wallerstein I. (dir.), Social Change. The Colonial Situation, Wiley, New York, 1966, p. 11-24 ; Leiris M., « L’ethnographie devant le colonialisme] », in Leiris M., Cinq études d’ethnologie, Gallimard, Paris, 1951, p. 85 et Metraux A., « Race et civilisation », Le Courrier de l’Unesco, III, p. 6-7, cité dans Leiris M., Cinq études d’ethnologie, op. cit., p. 11.
[8] Balandier G., « La situation coloniale : approche théorique », Cahiers internationaux de sociologie, vol. 11, 1951, p. 44-79.
[9] Voir Stoler A. L. et Cooper F., « Between Metropole and Colony : Rethinking a Research Agenda », in Stoler A. L. et Cooper F., Tensions of Empire. Colonial Cultures in a Bourgeois World, University of California Press, Berkeley, 1997.
[10] Balandier G., Une anthropologie des moments critiques, MSH, Paris, 1996, p. 8.
[11] Parmi les nombreuses interventions incisives à sujet, voir Weil P., Liberté, Égalité, Discriminations. L’identité au regard de l’histoire, Grasset, Paris, 2008, qui comprend sept brèves pages sur l’« histoire oubliée » des musulmans en Algérie, p. 151-158 ; Lefeuvre D., Pour en finir avec la repentance coloniale, Flammarion, Paris, 2006, l’une des diatribes les plus violentes contre l’invocation de l’« héritage colonial » ; Stora B., La Guerre des mémoires. La France face à son passé colonial, L’Aube, Paris, 2007, où l’on trouve, comme dans le reste de son œuvre, la discussion la plus claire et la plus utile de ce qu’on ne peut qualifier de « nouveau » ou d’« oublié » ; ainsi que Terray E., Face aux abus de mémoire, Actes Sud, Paris, 2006. Voir aussi les innombrables réactions suscitées par les commentaires de Nicolas Sarkozy durant sa visite à Dakar, au cours de laquelle il avait appelé la jeunesse africaine à « ne pas rester accrochée au passé » et identifié les causes de la « véritable tragédie de l’Afrique » dans le fait « que les Africains n’ont pas suffisamment investi la scène de l’histoire » – et notamment l’article de Mbembe A., « Nicolas Sarkozy’s Africa », accessible sur le site http://www.africultures.com.
[12] Voir Bancel N., Blanchard P.et Verges F., La République coloniale, Albin Michel, Paris, 2003.
[13] Voir Bertrand R., Mémoires d’empire : la controverse autour du « fait colonial », Le Croquant, Bellecombe-en-Bauges, 2006.
[14] Vidal-Naquet P., La Torture dans la République, Minuit, Paris, 1998 ; Ferro M., Le Livre noir du colonialisme xvie-xxie siècle : de l’extermination à la repentance, Robert Laffont, Paris, 2003 ; Liauzu C. (dir.), Colonisation : droit d’inventaire, Armand Colin, Paris, 2004 ; Le Cour Grandmaison O., Coloniser/Exterminer. Sur la guerre et l’État colonial, Fayard, Paris, 2005 et Blanchard P., Bancel N. et Lemaire S., La Fracture coloniale, op. cit.
[15] Pour des numéros spéciaux de revues consacrés à ces questions, voir « La question postcoloniale », Hérodote, op. cit. ; « Postcolonialisme et immigration », Contretemps, n° 16, janvier 2006 ; « Pour comprendre la pensée postcoloniale », Esprit, décembre 2006 ; « Empire et colonialité du pouvoir », Multitudes, n° 26, automne 2006 ; « Relectures d’histoires coloniales », Cahiers d’histoire, n° 99, avril-mai-juin 2006 et « Qui a peur du postcolonial ? Débats et controverses », Mouvements, n° 51, octobre/novembre 2007.
[16] Je pense ici à la réception négative de la thèse quelque peu sensationnaliste de l’ouvrage du politologue Olivier Le Cour Grandmaison, Coloniser/Exterminer, op. cit., dont les adversaires se sont empressés de signaler qu’il n’était pas formé en histoire coloniale. Il n’en reste pas moins que le lignage qu’il met au jour et qui va des « premiers » camps de concentration et de la politique d’extermination dans l’Algérie des années 1840 aux systèmes d’extermination et d’internement des immigrants sur le continent européen est un projet qui recoupe celui de nombreux historiens certifiés dans leur étude d’autres empires – comme aux États-Unis ou en Allemagne.
[17] Pour un « bilan » de la condamnation coloniale, voir Ferro M., Le Livre noir du colonialisme XVIe-XXIe siècle : de l’extermination à la repentance, op. cit., ainsi que la recension qu’en font Jane Burbank et Frederick Cooper dans les Cahiers d’études africaines, vol. 44, n° 1-2, p. 455-463. Sur les étiologies coloniales des camps, voir Bernadot M., Camps d’étrangers, Terra, Paris, 2008, ainsi que Le Cour Grandmaison O., Lhuilier G. et Valluy J., Le Retour des camps ? Sangatte, Lampedusa, Guantanamo, Autrement, Paris, 2007.
[18] Pour une discussion détaillée de la politique de la mauvaise foi chez Sartre, voir Stoler A. L., « The Imperial Politics of Dis-regard », in Id., Along the Archival Grain : Epistemic Anxieties and Colonial Commonsense, Princeton University Press, Princeton, 2008.
[19] Lebovics H., True France. The Wars over Cultural Identity, 1900-1945, Cornell University Press, Ithaca, 1992, p. 57.
[20] Noiriel G., Le Creuset français. Histoire de l’immigration xixe-xxe siècles, Seuil, Paris, 1988.
[21] Green N., « Le Melting-Pot : Made in America, Produced in France », Journal of American History, décembre 1999, p. 1188-1208.
[22] Duquesne , « Torture en Algérie : un témoignage inédit », L’Express, 30 novembre 2000, p. 56-61.
[23] T. Maschino M., « L’Histoire expurgée de la guerre d’Algérie », Le Monde diplomatique, février 2001, p. 8-9. Thomas Bowdler : médecin britannique, auteur d’une version expurgée des œuvres de Shakespeare tenant compte de la bienséance et des mœurs du début du xixe siècle [N.d.T.
[24] Parmi les nombreux efforts de Stora visant à redonner à cette histoire sa place centrale, voir La Gangrène et l’Oubli. La mémoire de la guerre d’Algérie, La Découverte, Paris, 1991 ; Le Transfert d’une mémoire. De l’« Algérie française » au racisme anti-arabe, La Découverte, Paris, 1999 et La Guerre invisible : Algérie, années 1990, Presses de Sciences Po, Paris, 2001.
[25] Nietzsche F., Considérations inactuelles, Gallimard, coll. « La Pléiade », Paris, 2000.
[26] Dirks N. (dir.), Colonialism and Culture, University of Michigan Press, Ann Arbor, 1992, p. 5.
[27] Noiriel G., The French Melting-Pot. Immigration, Citizenship, and National Identity, University of Minnesota Press, Minneapolis, 1996, en particulier p. 1-9. Voir l’excellente étude de Sheppard T., The Invention of Decolonization. The Algerian War and the Remaking of France, Cornell University Press, Ithaca, 2006, et notamment le chapitre intitulé « Forgetting French Algeria », ainsi que L’Estoile B. de, « L’oubli de l’héritage colonial », Le Débat, 2007, p. 91-99.
[28] Ross K., Fast Cars, Clean Bodies. Decolonization and the Reordering of French Culture, MIT Press, Cambridge, 1995, p. 8-9.
[29] Pour un usage du terme d’« aphasie » dans un contexte très différent, voir Ouchakine S., « In the State of Post-Soviet Aphasia. Symbolic Development in Contemporary Russia », Europe-Asia Studies, vol. 56, n° 6, 2000, p. 991-1016.
[30] Swinney D., « Aphasia », The MIT Encyclopedia of Cognitive Science, MIT Press, Cambridge, 2001, p. 31-32.
[31] Jakobson R., « Two Aspects of Language and Two Types of Aphasic Disturbances », in Id., Selected Writings II. Word and Language, Mouton, La Haye, 1971, p. 121.
[32] Noiriel G., The French Melting-Pot, op. cit., p. 3.
[33] Nora P., Les Lieux de mémoire, vol 1. : La République ; vol. 2 : La Nation, Gallimard, Paris, 1984-1986. À la suite d’un échange public entre Noiriel et Nora à ce sujet, ce dernier a invité Noiriel à écrire une contribution au troisième volume (une décennie après la parution des deux premiers). Voir Noiriel G., « Français et étrangers », Les Lieux de mémoire, vol. II, p. 2433-2465 dans l’édition condensée de 1997.
[34] Nora P., Les Français d’Algérie, Julliard, Paris, 1961.
[35] Ibid., p. 8-9.
[36] Ibid., p. 83 et 85.
[37] Ibid., p. 83.
[38] Freud S., Contribution à la conception des aphasies, PUF, Paris, 1987 [1891], p. 51 et 61. Je remercie Richard Rechtmann qui a bien voulu discuter de cet essai avec moi. Pour un usage incisif de la notion freudienne de « déni » appliqué à la notion de « race » en France, voir Fassin D., « Du déni à la dénégation : psychologie politique de la représentation des discriminations », in Fassin D. et Fassin E. (dir.), De la question sociale à la question raciale ? Représenter la société, La Découverte, Paris, 2006, p. 133-157.
[39] Un argument similaire, selon lequel les colons n’étaient pas réellement français, structure l’introduction de Charles-André Julien à l’ouvrage de Césaire A., Toussaint Louverture. La Révolution française et le problème colonial, Présence africaine, Paris, 1961, publié la même année que Les Français d’Algérie. L’historien y observe que les « préjugés racistes » des habitants de Saint-Domingue appartenaient à des hommes qui « n’[avaient] pas emporté leur patrie à la semelle de leurs souliers », des hommes qui parlaient de Louis XVI non comme de « leur souverain » mais « avec la même indifférence qu’ils auraient témoignée à un prince étranger » (p. 9).
[40] Ko H., « Nazis in the French-Indochina War : the Vichy Syndrome and the Politics of Memory », intervention à la conférence « Mass Political Violence politique in Southeast Asia », University of California, Berkeley, mars 2001. Je remercie Mlle Ko de m’avoir fait lire sa thèse en cours de rédaction.
[41] Sur le rôle qu’a joué Vichy dans la politique coloniale, voir Cooper F., Decolonization and African Society. The Labor Question in French and British Africa, Cambridge University Press, New York, 1996, notamment p. 141-149. Au sujet de la politique de main-d’œuvre dans l’Afrique coloniale française, Cooper note que l’idéologie vichyste « a eu une vie plus longue que les quatre années du régime de Vichy » et qu’elle se caractérisait « par une identité considérable des personnels et des idées » (p. 142). Pour une étude plus exhaustive de la politique coloniale de Vichy, voir Jennings E., Vichy in the Tropics. Petain’s National Revolution in Madagascar, Guadeloupe, and Indochine 1940-1944, Cambridge University Press, New York, 2001. Pour un effort antérieur visant à établir ce lien, et notamment sur le projet inachevé de Vichy pour mener à bien « une renaissance de la France à partir des ressources maritimes et coloniales, aux côtés d’une grande Allemagne continentale », voir Paxton R. O., Vichy France. Old Guard and New Order 1940-1944, Norton, New York, 1972, p. 114. Au sujet de la mise en œuvre du système des quotas anti-Juifs en 1941, à propos duquel le ministère des Colonies, comme tant d’autres, ne « fit aucune objection », voir Marrus M. R. et Paxton R., Vichy France and the Jews, Schocken, New York, 1983, p. 125.
[42] Voir Stoler L. A., Race and the Education of Desire. Foucault’s History of Sexuality and the Colonial Order of Things, Duke University Press, Durham, 1995, et notamment « Toward a Genealogy of Racisms : the 1976 Lectures at the Collège de France ».
[43] Cf. Foucault M., « Faire vivre et laisser mourir : la naissance du racisme », Les Temps modernes, février 1991, p. 37-61.
[44] Foucault M., « Il faut défendre la société » : Cours au Collège de France, 1976, Gallimard/Seuil, Paris, 1997.
[45] « Michel Foucault : de la guerre des races au biopouvoir », Cités, n° 2, 2000, p. 9-96.
[46] Granjon M.-C. (dir.), Penser avec Michel Foucault. Théorie critique et pratiques politiques, Karthala, Paris, 2005, p. 53.
[47] Foucault M., Les Mots et les choses, Gallimard, Paris, 1966, p. 10.
[48] Coronil F., « After Empire : Reflections on Imperialism form the Americas », in Stoler A. L., McGranahan C. et Perdue P. (dir.), Imperial Formations, SAR, Santa Fe, 2007, p 241-274.
[49] Voir Mbembe A., « Décoloniser les structures psychiques du pouvoir », Mouvements, n° 51, septembre-octobre 2007, p. 142-155, ainsi que Stoler A. L., « Imperial Debris : Reflections on Ruins and Ruination », Cultural Anthropology, printemps 2008.
[50] BAYART J.-F., « LES CHEMINS DE TRAVERSE DE L’HEGEMONIE COLONIALE EN AFRIQUE DE L’OUEST FRANCOPHONE : ANCIENS ESCLAVES, ANCIENS COMBATTANTS, NOUVEAUX MUSULMANS », IN « LEGS COLONIAL ET GOUVERNANCE CONTEMPORAIN », VOL. II, LES RAPPORTS DU FASOPO, DECEMBRE 2006, P. 254-55. TEXTE EN LIGNE SUR HTTP ://WWW.FASOPO.ORG/PUBLICATIONS.... ;
[51] BLANCHARD P. ET BANCEL N. (DIR.), CULTURE POSTCOLONIALE, 1961-2006. TRACES ET MEMOIRES COLONIALES EN FRANCE, AUTREMENT, PARIS, 2005, P. 7.
[52] BAYART J.-F. ET BERTRAND R., « DE QUEL “LEGS COLONIAL” PARLE-T-ON ? », ESPRIT, DECEMBRE 2006, P. 27.
[53] Cooper F.et Stoler A. L. (dir.), Tensions of Empire. Colonial Cultures in a Bourgeois World, University of California Press, Berkeley, 1997.
[54] Barbier C. et Mandonnet E. « Colonisation, le mal de la repentance », L’Express, 15 décembre 2005 ; Evariste, « La lepénisation des esprits des Indigènes de la République », Respublica, journal de la gauche républicaine, février 2007 et Darras F. (pseudonyme de Jean-François Kahn), « Et maintenant les nouveaux racistes ! », Marianne, 21 décembre 2005.
[55] Merle I. et Sibeud E., « Histoire en marge ou histoire en marche ? La colonisation entre repentance et patrimonialisation », présentation au colloque « La politique du passé », 25 et 26 septembre 2003, p. 4 et 5. Texte en ligne sur http://histoire-sociale.univ-paris1....
[56] Voir comment Jean-François Bayart parle de la « conversion » d’Achille Mbembe aux études postcoloniales, in Smouts M.-C. (dir.), La Situation postcoloniale, op. cit., p. 270.
[57] Voir le récent texte de Bayart J.-F., « Les études postcoloniales : une invention politique de la tradition ? », Sociétés politiques comparées, n° 14, avril 2009, p. 1-46, disponible sur http://www.fasopo.org.
[58] Dulucq S. et Zytnicki C. (dir.), Décoloniser l’histoire. De l’histoire coloniale aux histoires nationales en Amérique latine et en Afrique, xixe-xxe siècles, Société française d’histoire d’outre-mer, Saint-Denis, 2003.
[59] Sur le Fasopo et la composition de son bureau directeur, voir
[60] Le reproche de simplification abusive contredisant la tendance prêtée aux postcoloniaux de faire dans le délire précieux et de multiplier les facettes explicatives sur le « fragment » et la prolifération.
[61] Bertrand R., « Faire parler les subalternes ou le mythe du dévoilement », in Smouts M.-C. (dir.), La Situation postcoloniale, op. cit. , p. 278-279.
[62] La tendance au « textualisme », la propension au « textualisme-synecdoque », le « subjectivisme », l’« absence de réflexivité sociologique » et enfin le « misérabilisme sociologique » que les postcoloniaux cacheraient sous la posture du « dévoilement savant » (Bertrand R., « Faire parler les subalternes… », loc. cit.) Le « textualisme synecdoque » (ou l’erreur qui consiste à prendre la partie pour le tout) donne l’occasion au politiste de montrer son ignorance des méthodes de recherche et de reconstruction historiques par le biais d’une laborieuse chevauchée sur le livre de Geoffey Lloyd, Pour en finir avec les mentalités (La Découverte, Paris, 1993). Les historiens ont d’autres tours dans leur sac qu’un herbier magique.
[63] Outil forgé à la fin des années 1970 par Jean-François Bayart comme intrument d’analyse des sociétés politiques africaines. Voir Bayart J.-F., L’État au Cameroun, Karthala, Paris, 1979.
[64] Bayart J.-F., « La novlangue d’un archipel universitaire », in Smouts M.-C. (dir.), La Situation postcoloniale, op. cit. Il est difficile de rendre compte de l’effet de surprise du public à l’audition des critiques de Romain Bertrand et de Jean-François Bayart, mais on en aura un aperçu en lisant les premières lignes de la réaction de Georges Balandier, p. 272. De passage à Paris, j’assistais aux débats du 5 mai 2006.
[65] Pour une analyse plus éclairante sur le rôle de la French Theory dans la naissance des postcolonial studies simultanément à sa relative marginalisation en France, voir Mbembe A. et Bancel N., « De la pensée postcoloniale », loc. cit. Sur l’idée que les postcolonial studies, loin d’être anti-européennes, sont filles de la rencontre entre l’Europe et les mondes que celle-ci subjugua, voir Mbembe A., « Postcolonialisme : une autre modernité », Esprit, novembre 2006.
[66] Bayart J.-F., « La novlangue d’un archipel universitaire », loc. cit., p. 270.
[67] Ibid., p. 268.
[68] Bayart J.-F., « Les études postcoloniales, une invention politique de la tradition ? », op. cit., p. 8.
[69] Bertrand R., « Vérités d’empire(s). La question des continuités du colonial au prisme de l’histoire impériale comparée », in « Legs colonial et gouvernance contemporaine », vol. II, Les Rapports du Fasopo, décembre 2006, p. 66.
[70] Expression copiée du concept de « second colonial occupation », formulé pour la première fois par Low D. A. et Lonsdale J., « Introduction », in Low D. A. et Smith A. (dir.), History of East Africa, Oxford University Press, Oxford, 1976, vol. III. Voir Bertrand R. « L’enjeu politique de la mémoire impériale : le débat français », in « Legs colonial et gouvernance contemporaine », vol. I, Les Rapports du Fasopo, décembre 2005, p. 127 et 135 (note 145). Même référence unique dans son Mémoires d’empire, op. cit., p. 195. Dans l’article « Vérité d’empire(s)... », loc. cit., note 26, p. 15, il ajoute Frederick Cooper et Alice Conklin.
[71] Et dans lequel nous cherchâmes son nom, mais en vain,. Voir « L’État colonial », Politix, vol. 17, n° 66, 2004.
[72] Un volume ne suffirait pas à citer les travaux qui réfutent l’assertion de Romain Bertrand. Pour une présentation des travaux français sur les sociétés « indigènes », voir Coquery-Vidrovitch C., Les Enjeux politiques de l’histoire coloniale, Agone, Paris, 2009.
[73] Bertrand R., « Vérités d’empire(s) », loc. cit., p. 13. La discipline est neuve et vient d’être officiellement constituée en France dans la mouvance de Sciences Po, semble-t-il, par le croisement de la sociologie historique et de la sociologie politique. Cf. Déloye Y., Sociologie historique du politique, La Découverte, Paris, 2003, qui la décrit comme « une histoire sociale du politique, mais aussi une histoire politique du social ».
[74] Inspiré librement de Bayart J.-F., « Les études postcoloniales, une invention politique de la tradition ? », loc. cit., p. 17.
[75] Ibid.
[76] Bayart J.-F., « Les chemins de traverse de l’hégémonie coloniale en Afrique de l’Ouest francophone », loc. cit., p. 259.
[77] Chrétien J.-P., « Le passé colonial : le devoir d’histoire », Politique africaine, n° 98, juin 2008, p. 142, 144 et 148. Sur la « demande sociale », voir aussi Rioux J.-P., La France perd la mémoire. Comment un pays démissionne de son histoire, Perrin, Paris, 2006, p. 181.
[78] Bayart J.-F., L’État en Afrique. La politique du ventre, Fayard, Paris, 1989.
[79] Bayart J.-F., « L’extraversion de l’Afrique », Critique internationale, n° 5, automne 1999 et « Africa in the World : a History of Extraversion », African Affairs, n° 99, 2000. Que penser enfin de ceux qui, pour affronter les postcolonial studies, parlent sans complexe de « République », de « France contemporaine » et autres « nation » ? Quelle expertise inquestionnable et quelle immunité méthodologique autorisent l’un à personnifier le pays sous les traits d’une vieillarde gaga, l’autre à la peindre sous les traits d’un vieux corps « tiraillé entre les minorités », un troisième à comparer l’Occident à un navire en perdition ? (Rioux J.-P., La France perd la mémoire, op. cit. ; Nora P., « La France est malade de sa mémoire », Le Monde 2, 16 février 2006 et Amselle J.-L., L’Occident décroché. Enquêtes sur les postcolonialismes, Stock, Paris, 2008, p. 7).
[80] Les textes pionniers en la matière soulignent comment le remaniement mutuel des métropoles et des colonies, depuis le xixe siècle au moins, fut d’abord marqué par la contingence et l’indétermination (« Between Metropole and Colony : Rethinking a Research Agenda », in Cooper F. et Stoler A. L. (dir.), Tensions of Empire, op. cit., p. 1). Voir aussi les conclusions nuancées d’Alice Conklin sur la relation entre républicanisme, racisme et libéralisme in Conklin A., A Mission to Civilize. The Republican Idea of Empire in France and West Africa, 1895-1930, Stanford University Press, Standford, 1997, p. 246-256. Ces évidences rappelées mille fois l’ont été récemment encore dans l’introduction au volume dirigé par Blanchard P. et Bancel N., Culture postcoloniale, op. cit, p. 7 et 11-12.
[81] Bertrand R., « Vérités d’empire(s) », loc. cit., p. 22.
[82] Bayart J.-F. et Bertrand R., « De quel “legs colonial” parle-t-on ? », loc. cit., p. 11, 13, 19, 20 et 24. Les trois dernières expressions sont tirées de la version publiée antérieurement sous le titre « La problématique du legs colonial », in « Legs colonial et gouvernance contemporaine », vol. I, Les Rapports du Fasopo, décembre 2005, p. 16-17.
[83] Le même texte, inquiet peut-être de la profusion des règles édictées, propose une liste de « neuf ordres de continuités ». On doute que cette pointilleuse mécanique théorique remplace les avancées empiriques des nouvelles études coloniales et postcoloniales. Voir ibid., p. 39.
[84] Hunt N. R., A Colonial Lexicon of Birth Ritual, Medicalization and Mobility in the Congo, Duke University Press, Durham, 1999 et Cooper F., Colonialism in Question, Theory, Knowledge, History, University of California Press, Berkeley, 2005 ont repris cette idée récemment, mais elle date des premiers travaux sur l’histoire impériale (Hobsbawn), et a été explorée par les penseurs de la globalisation, en particulier A. Appadurai.
[85] Bertrand R., « Vérités d’empire(s) », loc. cit., et Bayart J.-F., « Les études postcoloniales, une invention politique de la tradition ? », loc. cit., p. 31-32.
[86] École que Jean-François Bayart rejoint avec son premier livre L’État au Cameroun (1979), puis avec l’ouvrage Bayart J.-F., Mbembe A. et Toulabor C., Le Politique par le bas en Afrique noire, Karthala, Paris, 1992.
[87] Bayart J.-F. et Bertrand R., « La problématique du legs colonial », loc. cit., p. 26.
[88] Bayart J.-F. et Bertrand R., « De quel “legs colonial” parle-t-on ? », loc. cit. Outre la phrase isolée citée au début de ce chapitre, les auteurs consacrent à peine une page et demie aux métropoles contemporaines en alertant surtout sur le risque d’y surestimer l’impact des héritages coloniaux (p. 3-4 et 11).
[89] Sur la capture et utilisation des concepts postcoloniaux par le corps social, et en particulier les minorités mobilisées depuis 2005 contre la discrimination raciale, voir Bernault F., « Colonial Syndrome : French Modern and the Deception of History », in Tshimanga C., Gondola D. et Bloom P. (dir.), Frenchness and the African Diaspora, Indiana University Press, Bloomington, 2009.
[90] L’opinion procède de l’idéal gréco-romain de la démocratie et de la croyance magique au contrat qui a influencé la pensée républicaine française depuis 1789, et qui opposent la domus à la res publica, l’ethnos au peuple constitué, la sphère publique au domaine privé. Le contrat, acte rationnel et volontaire, est imaginé comme l’antithèse de l’appartenance liée au sang et au sol (ethnique, raciale, géographique), la loi comme l’élévation du bien collectif contre les intérêts particuliers. La perspective récente la plus pénétrante sur ces idéaux s’appuie sur la critique des présupposés de l’intégration républicaine et ses applications politiques. Voir, entre autres, les travaux de N. Guénif-Souilamas, S. Bouamama, S. Beaud ou A. Hajjat.
[91] Badie B., « Quelles citoyennetés à l’heure de la mondialisation ? », entretien publié dans la revue Hommes et Migrations, n° 1206 (mars-avril 1997).
[92] Schnapper D., La Communauté des citoyens, Gallimard, Paris, 2003, p. 21 et Wievorka M., Raison, conviction : l’engagement, Textuel, Paris, 1998, p. 9-10. Il est frappant de voir que ces textes sont fondés sur des constructions logiques et philosophiques plutôt que sur de réelles recherches empiriques.
[93] Bayart J.-F., « Les chemins de traverse de l’hégémonie coloniale en Afrique de l’Ouest francophone », loc. cit., p. 256-258. Yves Déloye rappelle de son côté que la nouvelle discipline « est centrée sur l’évolution des modes de gouvernement et le destin des groupes de gouvernés » (Déloye Y, Sociologie historique du politique, op. cit.).
[94] Jean-François Bayart souligne avec raison que la vision positiviste et téléologique du progrès, du social et du rôle de l’État qui subsiste aujourd’hui en Europe est un héritage de l’État colonial (Bayart J.-F. et Bertrand R., « « De quel “legs colonial” parle-t-on ? », loc. cit., p. 5-6).
[95] Cf. les critiques sur la patrimonialisation du passé colonial, par exemple in Merle I. et Sibeud E., « Histoire en marge ou histoire en marche ? », loc. cit. Et sur la possession des dépossédés par le désir de posséder, Bourdieu P., Raisons pratiques. Sur la théorie de l’action, Seuil, Paris, 1994.
[96] Lapeyronnie D., L’Individu et les minorités. La France et la Grande-Bretagne face à leurs immigrés, PUF, Paris, 1993, voir en particulier le chapitre sur la décomposition nationale, et Mauger G., L’Émeute de novembre 2005. Une révolte protopolitique, Le Croquant, Bellecombe-en-Bauges, 2006.
[97] À propos de ce terme, voir Le Pors A., Le Nouvel Âge de la citoyenneté, L’Atelier, Paris, 1997, p. 33. Sur son emploi par les anti-postcoloniaux (la loi du 23 février 2005 « légalise un communautarisme nationaliste suscitant en réaction le communautarisme de groupes »), voir Liauzu C., Meynier G. et alii, « Non à l’enseignement d’une histoire officielle », Le Monde, 25 mars 2005.
[98] En 1997, Bertrand Badie s’affolait du fait que l’État français, « [était], lui aussi, sur la pente ethniciste : pensons à [... ] la concession qui est faite aux liens du sang », et n’hésitait pas à nommer la progression de l’« identitarisme » en France et ailleurs comme un « primordialisme » (Badie B., « Quelles citoyennetés », loc. cit., p. 5-7). Voir aussi son ouvrage, La Fin des territoires. Essai sur le désordre international et sur l’utilité sociale du respect, Fayard, Paris, 1995. Cf. également le vocabulaire utilisé par D. Schnapper sur le futur apocalyptique des nations démocratiques de l’Europe « constituées par la désagrégation des empires [l’idée de R. Bertrand ne serait donc pas si neuve ? ] et la transcendance des ethnies, elles [risqueraient] de redevenir des ethnies [... ] [et] ne survivraient pas longtemps » (Schnapper D., La Communauté des citoyens..., op. cit., p. 277).
[99] Le Monde avertit, par exemple, que « rien ne serait plus dangereux » que d’enfermer les jeunes issus de l’immigration dans le statut de victimes ou d’héritiers des violences coloniales (Cf. Courtois G., « Les blessures de la colonisation », Le Monde, 21 janvier 2006).
[100] Rioux J.-P., La France perd la mémoire, op. cit., p. 170-171.
[101] Chrétien J.-P., « Le passé colonial : le devoir d’histoire », Politique africaine, n° 98, juin 2005, p. 147 et Amselle, J.-L., L’Occident décroché, op. cit., p. 244 filent la métaphore de la guerre des races. La panique gagne les rangs des spécialistes internationaux. Tel colloque de l’Institut de recherches pour le développement (IRD) sur « Les nouveaux essentialismes » (mai 2007) propose une session intitulée, sans autre forme de procès, « Mouvements religieux et violences identitaires ».
[102] Les « Blancs » étant par le même processus institués comme tels à partir de critères raciaux, biologiques, légaux, culturels et politiques (voir Saada E., Les Enfants de la colonie. Les métis de l’empire français entre sujétion et citoyenneté, La Découverte, Paris, 2007).
[103] Ce qui va beaucoup plus loin que l’antienne récente des « regards croisés ».
[104] Cf. Chakrabarty D., « Postcoloniality and the Artifice of History », in Guha R. (dir.), Subaltern Studies. A Reader, 1986-1995, University of Minnesota Press, Minneapolis, 1997, p. 264, où il est rappelé que, si le chercheur occidental peut ignorer la pensée locale, la réciproque est impossible.
[105] Sur l’invention de la nation par les bourgeoisies créoles d’Amérique du Sud, voir Anderson B., Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, Verso, Londres, 1983. Sur le rôle des vaincus des luttes nationalistes, qui concerne toute l’école des subaltern studies, et la recherche récente sur celui des exilés politiques, voir Terretta M., « God of Peace, God of Independence », Journal of African History, 46.1, 2006. Sur l’imaginaire national des réfugiés, voir Malkki L., Purity and Exile, University of Chicago Press, Chicago, 1995.
[106] Sur cette idée et le renversement des perspectives analytiques Nord-Sud, voir Bernault F., « L’Afrique et la modernité des sciences sociales », Vingtième Siècle, n° 70, 2001.
[107] Steve Feierman, anthropologue et historien de la Tanzanie, qui ne se reconnait pas comme faisant partie des postcolonial studies, va très loin dans ce sens en suggérant comment la production du savoir sur l’Afrique repose sur une faillite (Feierman S., « African Histories and the Dissolution of World History », in Bates R. H., Mudimbe V. Y. et O’Barr J. [dir.], Africa and the Disciplines, University of Chicago Press, Chicago, 1993).
 Fil des publications
Fil des publications
 liste des ouvrages
liste des ouvrages
