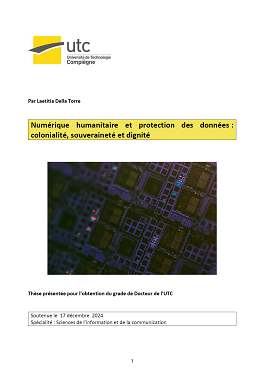février 2025
Laetitia Della TorreNumérique humanitaire et protection des données : colonialité, souveraineté et dignité
résumé
Exploitation de données par des multinationales, cyberattaques, multiplication d’opérations de désinformation, l’espace numérique contemporain est agité par un nombre croissant de tensions qui n’épargnent pas les humanitaires, d’autant que le secteur a entamé depuis une dizaine d’années une numérisation de ses opérations. Les ONG ont en effet adopté progressivement une série d’outils numériques, que ce soient des logiciels de traitement de données géographiques, des drones, des dispositifs biométriques, des agents conversationnels, voire des blockchains ou des intelligences artificielles. Ces organisations sont donc particulièrement vulnérables aux dérives du capitalisme de surveillance et des tensions géopolitiques traversant l’espace numérique. Les bénéficiaires en sont les premières victimes. Et l’on en vient à la contradiction suivante : les humanitaires — des acteurs engagés dans la protection de victimes de crises — ont adopté des outils numériques qui peuvent porter atteinte à leur vie privée, voire les mettre en danger.
L’objectif de cette thèse est de tenter de comprendre la nature de ce paradoxe, ce qui nécessite de creuser les différentes dynamiques et tensions accompagnant la numérisation de l’humanitaire. Cette dernière découle tout d’abord de la quantification de l’aide, elle - même liée à l’exigence des bailleurs d’améliorer la redevabilité des ONG et la traçabilité des fonds. La numérisation de l’humanitaire s’inscrit en outre dans un rapprochement plus général du milieu de la solidarité internationale avec le secteur privé. Ce mouvement s’accompagne de la diffusion d’un impératif d’innovation ainsi que par un imaginaire solutionniste des nouvelles technologies. Mais cet impératif d’innovation relèverait plutôt pour des chercheuses comme Kristin Sandvik ou Mirca Madianou d’une forme de « technocolonialisme ». Des dynamiques de pouvoir résultant de legs coloniaux participent en effet à la construction des bénéficiaires comme de potentiels « sujet » passifs d’expérimentation, et ce aux dépens du respect de leur vie privée. Les crises relèvent en outre de régimes d’exception facilitant l’expérimentation de technologies dans un contexte de suspension du cadre juridique en vigueur. Toutefois, ce tableau peut être nuancé. On assiste en effet à une échelle plus générale à un mouvement de régulation de l’innovation, qui se traduit par une série de lois comme le règlement sur la protection des données (RGPD), le Digital Markets Act, l’Artificial Intelligence Act, etc. Et ces dernières concernent aussi l’humanitaire. Une partie de notre thèse est donc consacrée au travail des délégués à la protection des données intervenant dans les ONG humanitaires. On se demandera comment ils se sont emparés des différents outils de régulation du risque numérique imposés par le RGPD. Or ce dernier repose sur une démarche de compliance qui n’est pas sans limites.
On étudiera ensuite une deuxième dynamique contribuant à renforcer les risques liés à la numérisation du milieu de la solidarité internationale. Elle concerne le resserrement de l’espace humanitaire, en lien avec l’exercice des souverainetés étatiques, et sa traduction sur le plan informationnel et numérique. Dans un premier temps, on reviendra donc sur la façon dont les échanges de données entre ONG et États hôtes sont perçus et encadrés, ces derniers pouvant être considérés comme étant légitimes, mais aussi comme facteur de risque, surtout s’ils sont associés à des formes de violence d’État et à une criminalisation des bénéficiaires de l’aide. Dans un second temps, on prendra en compte le fait que le processus de numérisation de nos sociétés accompagne et renforce aussi un phénomène au long cours de recompositions des souverainetés. Ce phénomène est aussi lié à l’entrée en scène d’une série d’acteurs non étatiques, des entreprises évidemment, comme les GAFAM, mais aussi d’autres groupes plus informels, comme des hackers. L’implication de cybercombattants dans des conflits contemporains s’inscrit dans un long mouvement de contestation du monopole de la violence des États du fait de la multiplication de conflits intraétatiques — à l’encontre de groupes terroristes par exemple — et l’implication d’acteurs privés dans la conduite de la guerre, comme des hackers donc. On s’intéressera aux impacts en matière de vie privée liés à deux sujets s’y rattachant : le contre-terrorisme ainsi que les cyberopérations touchant les ONG. Or ces dernières, en protégeant les bénéficiaires contre ces différentes menaces, courent le risque de réduire ces derniers à être de simples « objets de protection » et des victimes passives. Mais on verra que les humanitaires s’efforcent aussi de prendre en compte leurs droits garantis par le RGPD (notamment relatifs à leur autodétermination informationnelle) et de défendre ainsi leur dignité.
Mots clés : Humanitaire, numérique, protection des données, cybersécurité, innovation, souveraineté
à propos
Thèse de Doctorat soutenue à l’Université de Technologie de Compiègne le 17 décembre 2024.
Mots clefs
citation
Laetitia Della Torre, "Numérique humanitaire et protection des données : colonialité, souveraineté et dignité", Recueil Alexandries, Collections Etudes, février 2025, url de référence: http://www.reseau-terra.eu/article1491.html
 Fil des publications
Fil des publications