Minamata et Fukushima. De la nature des catastrophes. Jean Lagane, 2016, Editions Gaussen
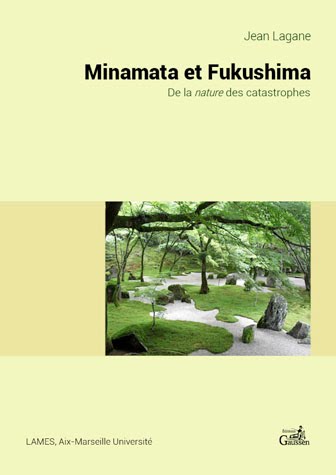
Editions Gaussen & Lames AMU, ISBN : 978-2-356981-00-4 Mise en vente : 24 mars 2016. Prix : 25 euros TTC 280 pages, 17 x 24 cm
| https://www.placedeslibraires.fr/livre/9782356981004-minamata-et-fukushima-de-la-nature-des-catastrophe-jean-lagane/ |à lire sur Terra
Texte de l’introduction et du chapitre 7.
présentation de l'éditeur
Quatrième de couverture : L’ouvrage propose de considérer l’interprétation des catastrophes environnementales japonaises sous un jour nouveau à travers une analyse comparative des relations homme/nature en Occident et au Japon, soit une forme de « communication internaturelle ». Le concept de médiance fournit ici une clé de lecture pour dépasser une logique disruptive de la catastrophe de celle de « l’être vers la mort » (conception matérialiste et anthropocentrée occidentale) vers une logique de « l’être vers la vie » (conception japonaise qui laisse la prééminence au milieu [fūdo] et permet d’établir la survie du corps animal [humain]à travers le champ existentiel dans lequel ce dernier s’insère : un corps médial pérenne constitué d’une conjonction de deux milieux, l’un naturel et l’autre techno-symbolique). (présentation de l’éditeur)
Jean Lagane est sociologue, maître de conférences en sciences de l’information et de la communication à Aix-Marseille Université, habilité à diriger des recherches. Membre du Laboratoire méditerranéen de sociologie (LAMES) à la Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme à Aix-en-Provence, ses recherches portent sur l’écologisation des territoires et les relations homme/nature ainsi que sur les configurations d’acteurs des environnements à risques autour de la Méditerranée et au Japon.
Mots clefs
© éditions Gaussen & LAMES AMU - Extrait du livre publié avec l’aimable autorisation de l’auteur et de l’éditeur.
TABLE DES MATIÈRES
Avant-propos, 11
Introduction, 13
La forte prégnance des enjeux environnementaux, 13
Dialogue internaturel avec la philosophie de la nature et l’anthropologie de la nature, 15
Nature en Occident et au Japon, 16
De Minamata à Fukushima : les clefs de la communication internaturelle, 18
Dépasser la vision européocentrée sur les questions environnementales, 19
Contourner les chausse-trappes du culturalisme, 20
1. Catastrophe et nature : quelques apports notionnels, 23
Chapitre 1 – Les catastrophes au prisme des sciences humaines et sociales, 25
Chapitre 2 – La philosophie de la nature : une nature avec ou sans les hommes ?, 31
Débats fondateurs (Préservation versus Conservation), 31
La préservation de la nature, 32
Le mouvement conservationniste, 34
Chapitre 3 – Les courants théoriques majeurs de la philosophie de la nature, 37
L’éthique anthropocentrique, 37
L’éthique biocentrique, 39
L’éthique écocentrique, 43
Vers un pragmatisme durable, 46
Chapitre 4 – L’anthropologie de la nature : une tentative de contourner l’anthropocentrisme des sciences humaines et sociales, 49
Pour une anthropologie de la nature : entre ontologies animiste, totémiste, analogiste et naturaliste, 50
L’animisme, 54
Le totémisme, 58
L’analogisme, 59
Du naturalisme au multinaturalisme, 61
2. Regards croisés sur les relations homme/nature en France et au Japon, 69
Chapitre 5 – Analyse diachronique des relations homme/nature en Occident, 71
L’Antiquité, les liens entre physique et éthique, 71
Tradition biblique et dévalorisation de la nature, 75
Des humanistes de la Renaissance à la modernité, 76
De la natura naturans à une posture d’extériorité de l’être humain, 85
L’homme en dedans ou en dehors de la nature ?, 93
Chapitre 6 – La nature dans la pensée moderne, 96
Nature et industrialisation, 96
Du Nature Writing à l’écologisme, 96
Essor de l’environnementalisme et de l’écologisme en France, 99
Des principes aux applications, 108
Formes urbaines en France : des rapports nature/culture et ville/campagne, 111
Représentations rurales : séparation spatiale et marchandisation, 113
Chapitre 7 – Les représentations de la nature au Japon, 115
De la terminologie de « nature » en japonais : vers un « sentiment de nature », 115
Croyances et respect de la nature, entre animisme et analogisme, 123
Le Shintō et la nature, 124
Nature et esthétique, 128
De l’intériorisation de la nature : l’esthétique du chanoyu, 134
Chapitre 8 – Nature et spatialité au Japon, 139
La « médiance » (fūdosei) : vers une herméneutique du milieu, 139
Entre écoumène et érème, 142
La nomenclature mésologique, 144
La nature (shizen), entre monde inhabité (yama) et monde habité (sato) : vers la prévalence d’un mode diffus de relations homme/nature, 150
L’urbanisation japonaise, 154
Les communautés rurales, 157
L’espace de voisinage (chōnaikai), 159
L’espace domestique : l’exemple de l’habitat résidentiel traditionnel, 161
Les résidences des marchands de Kyōto et la quintessence des jardins intérieurs, 165
3. Catastrophes environnementales au Japon, vers un décloisonnement des regards, 169
Chapitre 9 – Le Japon contemporain : entre célébration et détérioration de la nature, 171
La Haute Croissance, les années de plomb de l’environnement nippon, 172
Une attitude schizophrénique vis-à-vis de la nature, 175
Chapitre 10 – Minamata, mer d’amertume…, 179
Contexte et rappel des faits, 179
Savoir expert versus savoir profane, 182
De la survivance des coalitions paysannes médiévales (ikki) aux mouvements citoyens (shimin undō), 184
Du whistle-blowing aux partenariats solidaires (teikei), 187
Analyse de la communication des teikei : vers une forme de résilience civile, 188
Les teikei : une communication fondée sur la confiance interpersonnelle, 191
Approche éthique et anthropologique et médiance : des clés interprétatives de l’action des teikei, 194
Chapitre 11 – Fukushima, la triple catastrophe, 199
Le rappel des faits, 201
Les accidents à la centrale de Fukushima Daiichi, 203
Communication de crise et interprétations contradictoires, 206
Un discours « made in Japan » du président de la Commission d’enquête, 208
Une contamination radioactive avérée, 209
Plan d’urbanisme et catastrophe, 211
Les lendemains de Fukushima : de la société du risque planétaire, 212
Au-delà du culturalisme et des médias gestionnaires de la crise, 216
Recoudre le tissu social après la rupture…, 220
Chapitre 12 – Regards sur la catastrophe de Fukushima : Pour une communication environnementale internaturelle, 223
« Japon : terres souillées » : un regard sur la catastrophe, 223
De l’analyse mésologique de la catastrophe de Fukushima, 230
Le désastre de Fukushima : entre médiance et co-suscitation, 235
Être vers la vie (sei e no sonzai) : une question ontologique, 238
CONCLUSION, 241
Bibliographie, 247
Index thématique, 263
Annexe 1 : Carte du Japon, 265
Annexe 2 : Carte de Fukushima, 266
Annexe 3 : Glossaire, 267
Annexe 4 : Résumé, 273
Annexe 5 : Abstract, 275
Note
Les transcriptions des mots japonais sont effectuées selon le système Hepburn modifié. Les voyelles se prononcent un peu comme en italien et se prononcent toutes ; e se prononce é. Les voyelles longues sont indiquées avec un trait horizontal (ū, ō, etc.). Les consonnes [1] se prononcent à peu prés comme en anglais. Attention à g toujours dur, à s jamais voisé, à h toujours aspiré, à r proche de notre l. Les noms propres japonais sont également transcris selon l’ordre traditionnel, le nom de famille précédant le prénom.
Avant-propos
L’objectif de cet ouvrage consiste à instaurer un espace de dialogue interdisciplinaire au sein des sciences humaines et sociales [2] pour appréhender la complexité des catastrophes environnementales extra-occidentales [3]. À partir d’un ensemble d’observations sur les enjeux de société que représentent les questions environnementales, mon regard s’est porté sur deux catastrophes environnementales japonaises – celles de Minamata et de Fukushima – qui traduisent le paradoxe environnemental nippon analysé par le géographe et philosophe orientaliste Augustin Berque [4]. Ce paradoxe est étayé par la juxtaposition quasi schizophrénique de deux langages inconciliables : « d’une part, la dénonciation des nuisances et de leurs causes techno-socio-économiques ; d’autre part, la veine toujours nourrie de la célébration éthico-esthétique du sentiment japonais de la nature » (Berque, 1986 : 203).
Fort d’une expérience personnelle de trois décennies de voyages et de missions de recherche dans les confins de ce Finistère de l’Asie sinisée, j’ai souhaité contourner les discours culturalistes diffusés par les médias occidentaux après de tels désastres en vue de proposer une analyse fondée sur un dialogue internaturel. Il s’agit, en d’autres termes, d’endosser le rôle de passeur entre les représentations distinctes de la nature telles qu’elles apparaissent en Occident et au Japon. Au-delà d’une simple vision comparative de ces représentations (qui serait par là-même essentialiste), l’analyse cherche à mettre en discussion des domaines scientifiques connexes et complémentaires tels que ceux de la philosophie et de l’anthropologie de la nature, tout en portant une attention accrue au concept de médiance [5]. La médiance, qui sous-tend une relation d’indissociabilité entre l’être et son milieu, offre ici la base d’un axe de réflexion sur les relations homme/nature.
INTRODUCTION
Penser comme une montagne
« Un hurlement surgi des profondeurs résonne entre les parois rocheuses, dévale la montagne et s’évanouit dans le noir. C’est un cri de douleur primitive, plein de défi, et plein de mépris pour toutes les adversités du monde.
Chaque être vivant (et bien des morts aussi, peut-être) prête l’oreille à cet appel. Pour le cerf, c’est un rappel du destin de toute chair ; pour le pin, c’est un pronostic de rixes nocturnes et de sang sur la neige ; pour le coyote, c’est une promesse de glanures à venir ; pour le vacher, une menace de découvert à la banque et pour le chasseur, c’est un défi, crocs contre poudre. Pourtant, derrière ces espoirs et ces craintes évidentes et immédiates se cache une signification plus profonde, que la montagne est seule à connaître. Seule la montagne a vécu assez longtemps pour écouter objectivement le hurlement du loup ».
Aldo Leopold, 2000 [1948], Almanach d’un comté des sables suivi de quelques croquis, p. 168.
La forte prégnance des enjeux environnementaux
Logique incontournable des sociétés humaines au sein desquelles elle a progressivement étendu son emprise au cours de la seconde moitié du XXe siècle, la thématique de l’environnement, qui allie diverses formes de respect et de sensibilité de l’homme vis-à-vis de la nature ainsi que des modes de pensée et pratiques écologiques distincts, cristallise aujourd’hui une vaste combinatoire d’enjeux. Ceux-ci émargent dans les domaines politiques, économiques, médiatiques et sociétaux autour de ce qu’il est fréquemment admis de qualifier de « situation de crise environnementale globale » [6].
Qu’il s’agisse de crises ou de catastrophes environnementales, l’humanité est en proie à une multitude de dommages, de dangers identifiés, de phénomènes de contamination industrielle de l’environnement. Ceux-ci induisent des perturbations de l’environnement qui remettent en question les capacités de reconstitution des stocks naturels et de restauration des équilibres de la nature. Un tel constat est étayé par les interventions humaines, de plus en plus massives, qui menacent d’interrompre les cycles naturels et d’acheminer l’humanité vers des seuils d’irréversibilité. Il est possible de citer certains de ces seuils les plus emblématiques comme les catastrophes industrielles et environnementales dues au déversement de biocides dans les milieux naturels (air, eau, terre) de Minamata, Seveso, Bhopal, Bâle ; les marées noires successives provoquées par les avaries de pétroliers et/ou plateformes pétrolières (Exon Valdez, Amoco Cadiz, Erika, Prestige, Deep Water Horizon… ) ; les pollutions occasionnées par les boues rouges (Méditerranée, Danube, Brésil) ; enfin, les catastrophes d’origine nucléaire de Three Mile Island, Tchernobyl et plus récemment celle survenue à la centrale de Fukushima Daiichi, dans le Nord-Est du Japon (Tōhoku), le 11 mars 2011 suite à un séisme de magnitude 9.0 et à un tsunami dévastateur.
Au sein de cette liste non exhaustive des dommages qui menacent directement l’environnement des sociétés humaines et les ressources naturelles dont elles dépendent, l’importance croissante que revêt l’anthropisation des espaces naturels mérite d’être mentionnée. Celle-ci est caractérisée par un taux accéléré d’urbanisation lors de la seconde moitié du XXe siècle. Le déplacement massif des lieux et styles de vie des populations rurales vers des lieux et styles de vie urbains ou périurbains ne cesse de s’accroître et ravive les questions environnementales. La population urbaine mondiale a dépassé la population rurale au cours de l’année 2007. À cela, il faut ajouter le fait que sur les neuf milliards d’individus qui peupleront la planète en 2050, la population urbaine représentera plus du double de la population rurale et entraînera dans sa course un phénomène de métropolisation, d’une part, et de vulnérabilité croissante des territoires due au dérèglement climatique, d’autre part. L’urbanisation intensive constitue, à cet égard, un défi majeur pour l’humanité avec pour conséquences marquantes sur l’environnement l’étalement urbain, l’émergence de nouvelles mobilités qui amplifient les empreintes écologiques et énergétiques des espaces citadins, la disparition et/ou l’éloignement des espaces agricoles qui accroissent les distances et circuits d’approvisionnement alimentaire, l’augmentation exponentielle de la demande en eau et en énergie, la gestion problématique du métabolisme urbain [7], la fragmentation sociale de l’hyperdensité des espaces urbains… autant de processus qui menacent l’être humain et, de manière plus globale, l’ensemble des communautés de vie – les communautés biotiques.
Or, cette anthropisation des espaces naturels provoque également la destruction massive des forêts tropicales, la désertification croissante de certaines terres, l’assèchement des espaces maritimes (disparition programmée de la mer d’Aral), l’érosion de la biodiversité, etc. De telles conséquences contribuent à l’accroissement de l’effet de serre et à la déchirure et/ou à l’amenuisement de la couche d’ozone. Le sociologue Bruno Latour classe ces dommages environnementaux dans une catégorie dite « hybride ». Comme le résume très schématiquement et succinctement François Jarrigue dans son compte rendu de l’ouvrage de l’historien de l’environnement états-unien, Michael Bess [8] :
pour Latour, le discours de la modernité procède à une série de « Grands partages » séparant et opposant en permanence technique et nature, science et sociétés, savant et politique. Or, au contraire, le monde est constitué d’objets hybrides proliférant et n’appartenant pas exclusivement au monde scientifique ou technique, mais participant à la fois du politique, du culturel ou de l’économique. Pour penser ces objets « hybrides », Latour et les Science Studies, proposent de fonder une anthropologie « symétrique » qui serait capable de traiter symétriquement – c’est-à-dire sur un même pied d’égalité – les différents éléments le composant. Initialement, c’est l’étude des innovations techniques – symbole de l’objet hybride condensant du social, du culturel, du naturel, etc., – qui a été au cœur de l’analyse (Jarrigue, 2011 : 7).
Certes, un nombre croissant de chercheurs en SHS prétend que cette tendance au « retrait » de la nature ne serait qu’une représentation sociale alors qu’en réalité il s’agirait de l’appréhender à travers l’intérieur de la société – en témoignent les approches de sociologie urbaine et d’agriculture urbaine qui analysent la réappropriation des liens ville/campagne et les traces de nature en ville.
Dialogue internaturel avec la philosophie de la nature
et l’anthropologie de la nature
La première partie de cet ouvrage aborde de manière succincte le regard critique porté par les SHS sur les catastrophes, et notamment celui de la sociologie du risque pour ce qui a trait aux catastrophes environnementales.
Fort du postulat qu’il est nécessaire d’instaurer un espace de discussion interdisciplinaire entre des sous-domaines qui traitent de problématiques environnementales connexes afin de tendre vers une restitution de la globalité du phénomène étudié, il s’agit d’analyser les référentiels théoriques des sous-domaines de la philosophie de la nature [9] et de l’anthropologie de la nature. En effet, ces champs théoriques se distinguent par leur vocation à rendre compte des relations et représentations homme/nature et à les analyser.
Le premier champ, celui de la philosophie de la nature, s’est développé en Amérique du Nord de manière féconde et bénéficie de près de six décennies de travaux ininterrompus. Ceux-ci ont exercé une influence prépondérante sur l’émergence de questionnements critiques en matière de considérabilité morale attribuée ou non à la nature et définissent par là-même une matrice conceptuelle quant aux relations que tissent les êtres humains avec leur environnement naturel. L’histoire récente de la philosophie de la nature anglo-saxonne est marquée par l’apparition de courants théoriques majeurs comme ceux de l’anthropocentrisme, du biocentrisme, de l’écocentrisme. Ces deux derniers courants ont parfois été indirectement associés à la tradition littéraire nord-américaine du Nature Writing [10], dont Henry D. Thoreau (1817-1862) fut l’instigateur, et, se rapportent communément à la parution en 1962 de l’ouvrage Silent Spring (Printemps silencieux) de la biologiste Rachel Carson [11], qui joua un rôle capital dans l’éveil de la conscience écologique (environment awareness) aux États-Unis.
Le second champ, le domaine émergent de l’anthropologie de la nature, est présenté à la fin de la première partie de l’ouvrage dans la lignée des travaux de Philippe Descola et d’Eduardo Viveiros de Castro [12] et vise à passer outre les pièges d’une pensée majoritairement anthropocentrique et naturaliste occidentale dans l’appréhension des relations homme/nature. Par contigüité, cela renvoie à la prise en considération d’ontologies complémentaires comme celles de l’animisme, de l’analogisme et du totémisme afin d’ouvrir la voie à des perceptions et interprétations extra-occidentales des catastrophes environnementales.
Nature en Occident et au Japon
La deuxième partie de l’ouvrage analyse, de manière diachronique, les notions et représentations de nature et les rapports homme/nature que celles-ci ont engendrés en Occident (et plus précisément en France) et au Japon. En toile de fond, l’objectif de cette présentation est associé au postulat que des définitions et considérations distinctes de la notion de nature se traduisent par des manières différentes de percevoir et d’appréhender les catastrophes environnementales.
Ainsi s’agit-il, d’une part, de situer, de manière succincte et selon une perspective héritée de la philosophie morale, l’histoire de la notion de nature en France et en Occident. Tour à tour, la notion de nature est déclinée sous la forme de périodisations : de l’Antiquité, en passant par la Renaissance, les Lumières, la Modernité et l’avènement des approches de l’écologie contemporaine.
D’autre part, pour ce qui a trait à la même démarche concernant la société japonaise, l’analyse de la notion de nature prend la forme d’un examen terminologique suivi par trois entrées analytiques : la survivance de croyances animistes du Shintō populaire ; la prégnance d’une esthétique de la nature ; l’analyse des usages culturels de l’espace, i.e. celle de la spatialité nipponne.
Ce dernier élément de la présentation complète l’approche théorique de la première partie en exposant le concept de médiance. En effet, il s’agit d’initier le lecteur à l’appareil théorique de la mésologie et au concept de médiance (fūdosei) traduit par Berque à partir des travaux du philosophe et géographe japonais Watsuji Tetsurō. Ce chercheur a établi que « l’histoire ne prend chair qu’à travers le milieu, notion qu’il distingue de l’environnement (kankyō), car dans le milieu intervient la subjectivité humaine » et, dans ce sens, la médiance « est au milieu ce que l’historicité [et plus exactement “l’historialité” heideggérienne en tant que “moment structurel de l’existence”] est à l’histoire » (Berque, 1993b : 301). Or, quand Berque [13] propose le terme de médiance pour traduire fūdosei, il rattache cette notion au « sens, à la fois subjectif et objectif (une signification, une sensation, une tendance), de la relation d’une société à l’étendue terrestre (relation qui est un milieu) ». Le géographe français associe à ce sens trois niveaux d’articulation : « celui de l’en-soi des choses et de la nature (l’étendue du monde physique et objectif) ; celui des relations écologiques liant l’espèce à son environnement ; et celui de paysage, où jouent les relations d’ordre symbolique par lesquelles une culture fonde en nature la subjectivité collective » (ibid.).
La démarche analytique transdisciplinaire et interculturelle des relations homme/nature en France et au Japon, exposée au cours de la deuxième partie de l’ouvrage, est animée par la volonté d’instaurer un « dialogue internaturel » entre ces deux sociétés. Le développement proposé vise à se départir de la dichotomie déterministe nature/culture [14].
Il est toutefois utile de préciser, qu’au-delà du choix des entrées thématiques concernant la société japonaise (terminologie, croyance, esthétique, spatialité), il ne s’agit pas d’effectuer au cours de cette deuxième partie de l’ouvrage une approche strictement comparatiste concernant l’étude des représentations et des rapports homme/nature avec les usages français sur ces sujets, ni même d’étaler un compendium de références à prétention exhaustive. En revanche, tout en déroulant l’écheveau parfois détaillé et fastidieux [15] de ces diverses thématiques, l’objectif demeure d’appréhender, comme le traduit Berque [16], le fait que « la nature peut s’exprimer dans le langage de la culture, et, de nature sauvage, devenir nature construite » (Berque, 1986 : 16-17).
De Minamata à Fukushima :
les clefs de la communication internaturelle
La visée applicative de l’ensemble de ces considérations sur le contraste des rapports homme/nature en France et au Japon trouve un espace d’expression et d’analyse au sein de la troisième partie de l’ouvrage. Celle-ci met en exergue un constat paradoxal ayant trait à la société japonaise : d’une part, celui d’un sentiment exalté de nature, et d’autre part, celui de l’exemple d’une des sociétés où la nature a été, sans vergogne, la plus mise à mal par l’industrialisation et l’urbanisation lors de la seconde partie du XXe siècle.
Ce constat est suivi de la présentation des contextes et faits de deux catastrophes environnementales japonaises emblématiques – celles de Minamata et Fukushima. La troisième partie de l’ouvrage se termine par l’analyse de trois exemples de communication environnementale en rapport avec ces catastrophes selon une perspective qui associe les étayages de la philosophie de la nature et de l’anthropologie de la nature :
une analyse anthropologique de la communication sur les partenariats agricoles solidaires entre producteurs ruraux et consommateurs urbains (teikei) – qui montre le processus de construction progressive, au cours de la seconde moitié du XXe siècle au Japon, d’une anthropologie de la responsabilité qui se doit d’articuler fragilité et vulnérabilité, d’un côté, et résilience, de l’autre ;
une analyse de contenu d’un documentaire diffusé sur la chaine Arte concernant le portrait de trois familles d’agriculteurs de Fukushima ;
une analyse mésologique, à partir des travaux de Berque sur la médiance, étayée par le fait que l’homme contemporain, en faisant abstraction de son milieu, s’inscrit de plus en plus dans un processus d’« a-médiance », ce qui ne fait qu’accroître les déséquilibres et la distance entre l’homme et son environnement naturel.
Dépasser la vision européocentrée
sur les questions environnementales
La rédaction de cet ouvrage et le choix de porter un regard critique sur des objets extra-occidentaux, comme ceux des catastrophes de Minamata et de Fukushima, expriment la volonté de dépasser une logique de gallocentrisme, voire d’européocentrisme quant à l’appréhension des enjeux environnementaux.
La catastrophe de Minamata – et l’effervescence des études (minamata gaku) qui lui a été dédiée – illustre les dérives de l’idéologie du progrès social lors de la période de Haute Croissance au Japon (1955-1973). Ces années ont été marquées par l’implantation de complexes industriels pétrochimiques dans les petites et moyennes agglomérations des régions côtières. La catastrophe de Minamata est aujourd’hui reconnue comme l’épiphénomène des rejets de mercure en milieu marin par l’usine Chisso [17] entre 1932 et 1966 près de la petite ville de pêcheurs de Minamata dans le Sud de l’archipel, dans l’île de Kyūshū. Cette contamination a engendré de graves conséquences – résumées par l’appellation de « maladie de minamata » (minamata byō) : névropathie, paralysie, urémie, malformations congénitales diverses, décès [18]. Il est estimé, comme le relate le sociologue Paul Jobin, que « près de 2 300 personnes ont été officiellement reconnues atteintes de la maladie de Minamata, plus de mille sont déjà mortes et plus de 17 000 personnes ont demandé à être reconnues comme malades [et selon le sociologue (2012a), ce chiffre n’a cessé de croître depuis pour atteindre en 2012 le nombre de 3 000 victimes et 50 000 demandes de reconnaissance] » (Jobin, 2005 : 165 ; 2012a). Néanmoins, portée par le scandale de la maladie de Minamata, la question environnementale va peu à peu émerger au sein de la sphère sociétale japonaise, comme en atteste la création de l’Agence de l’Environnement (kankyōchō) (ibid.).
L’analyse des rapports entre modernisation de la société et généralisation de la pollution environnementale est également applicable à la situation française. L’historienne Gabrielle Hecht [19] rappelle que la France a connu une accélération de sa modernisation et de sa transformation dès l’après-guerre grâce à l’engagement successif des divers gouvernements (de droite comme de gauche) et grâce à la conversion massive des élites à l’idéologie du progrès technique. Celui-ci était appréhendé en tant que condition du redressement et de la grandeur nationale et a consisté en de grandes épopées technologiques de l’après-guerre (comme le Concorde, le TGV, le nucléaire…). Ces avancées ont ainsi pris les atours de ces « machines symboles » de l’identité nationale durant les Trente Glorieuses. Or, selon les chercheurs Céline Pessis, Sezin Topçu, Christophe Bonneuil (2013) [20], tout indique que la France a connu, après 1945, « une accélération sans précédent de l’utilisation des énergies fossiles, d’espace et de ressources, qui a imposé son tribut de pullutions et de maux plus ou moins cachés non seulement aux générations qui l’ont vécue, mais à celles qui l’ont suivie » (Audier, 2013).
Le second exemple japonais concernant l’irréversibilité des nuisances environnementales correspond à celui de la triple catastrophe du Tōhoku (séisme de magnitude 9.0 sur l’échelle de Richter, tsunami et contamination radioactive durable suite à la détérioration d’un des réacteurs de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi) survenue dans le Nord-Est du Japon le 11 mars 2011. Cet événement a rappelé brutalement le fait que territoires et sociétés sont confrontés à l’urgence de la question du respect de l’environnement et du « vivre-ensemble » et a fait l’objet d’abondantes analyses de la part des diverses composantes de la communauté scientifique internationale.
Les autorités de Fukushima, à l’instar de celles de Minamata, ont tardé pour transmettre des informations sécuritaires et sanitaires aux populations locales. Face à l’inertie, voire la défaillance des savoirs experts locaux, les médias nationaux et internationaux ont proposé une forme de maîtrise gestionnaire de la crise et le rôle organisateur des nouveaux médias a également été décrit comme déterminant. Mais ne s’agit-il pas ici d’une interprétation culturaliste des faits ? En effet, la production de tels discours et analyses sur les catastrophes environnementales de Minamata et de Fukushima pourrait être associée à des gloses de nature culturaliste qui ont, certes, été initialement diffusées par les médias occidentaux mais qui ont également été réutilisées par certains analystes des SHS. Ces derniers ont continué à produire les mêmes analyses essentialistes qui semblent ne pas entrer en résonance avec la réalité japonaise. Ceci s’est traduit par la tendance, énoncée plus haut, à interpréter le rôle des médias en tant que « gestionnaires de la crise », voire « amplificateurs », ce qui a, par la même occasion, contribué au renforcement de l’essentialisme.
Contourner les chausse-trappes du culturalisme
Le parti pris d’adopter, tout au long de cet ouvrage, une posture qui croise les regards sur l’environnement de deux sociétés distinctes et culturellement contrastées – la France et le Japon – questionne en creux les mécanismes sociocognitifs à l’œuvre lors du contact à l’altérité culturelle et les stéréotypes et catégorisations qui leurs sont associés. Selon le sociologue Denys Cuche [21], « l’homme est essentiellement un être de culture » (Cuche, 2004 : 10) et la culture apparaît comme un concept de plus en plus mobilisé lors de l’appréhension des enjeux environnementaux – en matière de résistance face aux crises et catastrophes. Aussi le recours à la notion de culture peut-il être présenté sous des traits dépréciatifs ou mélioratifs. Bien souvent, la notion de culture s’avère instrumentalisée, voire simplement réduite à son acception culturaliste [22]. Il convient alors d’établir un catalogue de traits culturels par pays, qui correspond parfois à une forme d’exotisme revivifié, soit une idéalisation de l’autre, qui prend la forme d’un éloge de la méconnaissance. Dans ce cas, la notion de culture se trouve restreinte à un simple outil d’analyse qui s’avère ni heuristique, ni opératoire.
L’exemple de la réponse sociétale à une crise environnementale d’ampleur exceptionnelle comme celle de Fukushima n’a pas échappé aux discours essentialistes de la communauté internationale. Or, la société japonaise, comme tout autre société, se donne à voir elle-même dans le regard qu’elle porte sur la nature. En partant de l’environnement et des relations homme/nature, il apparaît possible d’atteindre le cœur de la société, d’en proposer une interprétation, une herméneutique. Et c’est tout l’enjeu des pages qui vont suivre.
En effet, l’analyse éthique et anthropologique des catastrophes de Minamata et de Fukushima, présentée dans la troisième partie de l’ouvrage, rappelle que la réalité telle qu’elle se donne à voir est sociale (et on la décrit par le terme de « construit » en SHS [23]) aussi bien que naturelle. Comme le distingue le linguiste japonais Araki Hiroyuki [24], la préséance que la culture japonaise accorde au milieu sur l’individu peut être condensée dans le terme d’allonomie (taritsusei) par opposition à l’autonomie (jiritsusei) du sujet occidental. Aussi la prétendue résignation de l’individu japonais devant les désastres – comme cela a été décrit, voire décrié de manière insistante après la catastrophe de Fukushima – pourrait-elle être en lien avec cette forme d’allonomie : « le fait que l’individu qui abandonne tout jugement personnel pour assurer la norme du milieu » s’en remette à la « sur-nature » pour réguler les excès de sa civilisation moderne non-occidentale. Il ressort de cette analyse, comme le résume Berque [25], tout une gamme de formes d’« atténuation du faire », de valorisation du « devenir spontané » et du « naturel » telle qu’elle est détaillée, dans la deuxième partie de l’ouvrage, à travers l’appréciation du sentiment de nature et la prégnance de ce sentiment dans le rapport japonais à la croyance, à l’esthétique et à la spatialité.
L’ambition critique de cet ouvrage invite le lecteur à décloisonner son regard sur les thématiques environnementales en lui proposant d’explorer une perspective nouvelle : une approche qui dépasse l’ethnocentrisme et interroge la complémentarité des perceptions de la nature par rapport à celles qui prévalent dans les sociétés occidentales et demeurent majoritairement anthropocentriques. En d’autres termes, il s’agit de faire retour à la question du sens qui empreint la relation d’une société à la nature [26]. Qu’est-ce qui produit ce sens ? Par quels mécanismes ? Quels sont les mots et les expressions qui permettent de qualifier les relations d’une société à son environnement ? Comment penser la nature dans la société, et la société dans la nature ?
Chapitre 7
Les représentations de la nature au Japon
De la terminologie de « nature » en japonais :
vers un « sentiment de nature »
Dans les pages suivantes, quelques entrées thématiques ont été privilégiées pour illustrer les rapports homme/nature au Japon et pour rendre compte de l’inclusion des extériorités naturelles dans le social : rapports à la croyance et au sacré ; esthétique, spatialité. Or, il semble opportun de procéder, en premier lieu, à une analyse terminologique du mot nature, des origines de son acception, de ses caractéristiques qui reflètent l’empreinte de l’homme dans son milieu. Afin de ne pas occulter la richesse des correspondances entre la définition de ce « sentiment de nature », qui appelle à des croisements avec la phénoménologie, il sera largement fait référence aux écrits et analyses mésologiques (étude des interactions entre l’homme et son milieu) d’Augustin Berque, elles-mêmes inspirées par les théoriciens de l’École de Kyōto tels que Nishida Kitarō et Watsuji Tetsurō.
Néanmoins, il importe également de préciser qu’un ensemble des hypothèses entourant l’évolution de la perception du terme de nature au Japon prennent les traits chez Berque de la polarisation. Certes, ces précisions reflètent la construction du langage qui est constitué sur des termes polarisés et opposés, sur des classifications qui s’excluent mutuellement. Il est parfois complexe d’appréhender la richesse de certaines nuances et la polarisation tend à ne pas refléter pleinement la réalité de l’environnement. Ainsi, et aussi paradoxalement que cela puisse paraître, certaines catégories taxinomiques pour définir la complexité des relations homme/nature au Japon semblent participer au sein même de cette axiologie berquienne du paradoxe du dualisme de la pensée que son auteur souhaite dénoncer [27]. En attestent les usages des paires suivantes : physicophile/physicophobe (Berque, 1986 : 173) ; anabase (montée)/catabase (descente) (ibid. : 181) ; patent/latent ; de même qu’en japonais comme celle de tatemae (apparence, forme, superficialité) /honne (contenu, sincérité) ; miyabi (élégance raffinée de la cour)/hinabi (rusticité) (ibid. : 183), etc.
L’analyse d’un ensemble de textes de Berque prend toute son importance ici étant donné que cet orientaliste s’attache à comprendre le rapport de la société japonaise à la nature et à l’espace, selon une approche phénoménologique et géographique. Ce dernier a été conduit à s’intéresser à l’« écoumène [28] », c’est-à-dire à la terre en tant qu’elle est habitée par les hommes, soit un espace d’analyse de lien logique avec la dernière partie de ce volume.
Dans son ouvrage Le sauvage et l’artifice, Berque part d’un premier constat qui est lié au fait de la personnification de la nature humide [29]. Ce fait même, commente le géographe phénoménologue, pourrait être à l’origine du premier kami (divinité) et du devenir japonais. Cela reflèterait l’opposition entre les hommes de l’époque Yayoi (- 300 avant J.-C. ; 300 après J.-C.) et le début de la riziculture à leurs prédécesseurs (pêcheurs-chasseurs-cueilleurs [et peut être essarteurs]) de l’époque Jōmon (- 6 000 avant J.-C. ; - 300 avant J.-C.). Ceci aurait également engendré la particularité du shintō dont le principe fondateur serait caractérisé par la notion d’« engendrement/devenir du monde » et non par l’idée d’une « création première » comme cela est le cas dans la pensée chrétienne.
Puis, Berque poursuit son propos, fort d’un deuxième constat quant au fait que la cosmogonie japonaise se départ de la cosmogonie chinoise. En effet, cette dernière a développé les récits de ses « empereurs-civilisateurs » qui se distinguent par de grandes actions d’aménagement (fleuves, routes, champs), ce qui sous-tend une distinction entre naturel et humain, et entre nature et culture avec une certaine rationalité.
Cette distinction ne prend pas la forme d’une opposition franche avec la conception de nature héritée de la tradition judéo-chrétienne, une nature à laquelle l’homme ne doit pas être assujetti, mais qu’il se doit de maîtriser en tant qu’être supérieur (et dont il a été principalement question dans les pages 75 et 76).
En revanche, la cosmogonie japonaise, telle qu’elle est décrite dans le Kojiki (Recueil des choses anciennes), parle de « l’engendrement/devenir du monde » et pose par ce biais « l’inséparabilité de l’homme et de la nature » au sein des mythes fondateurs de l’État. La position défendue est celle d’un « surgissement de la nature » et de l’acceptation des événements tels qu’ils sont, tels qu’ils se produisent en engendrant l’avenir. Dans le but d’effectuer certains rapprochements entre la conception de la nature (feu, mer, plaine, rizière, caverne…), la présence des divinités et le mythe fondateur du Japon, un bref extrait du Nihon Shoki [30] (Chronique du Japon) sera cité, qui tout autant que le Kojiki, traite de l’ère des dieux qui sont aux cœurs des mythes de la monarchie ancienne [31] :
à l’origine, la terre et les divinités qui l’habitaient étaient nées de l’union de deux divinités, mâle et femelle, Izanaki et Izanami. Mais en donnant naissance au dieu du feu, la déesse Izanami se brûla les entrailles et mourut. Elle s’en fut alors dans le monde des morts (…). Ne pouvant supporter la perte de son épouse bien-aimée, Izanaki se rendit au pays des morts pour la retrouver mais il n’obtint que d’avoir son propre corps souillé. De son côté, ne supportant pas que son époux puisse la voir dans un pareil état de putréfaction, Izanami avait envoyé une armée pour le repousser et il finit par regagner le monde. Il se purifia de nombreuses fois dans l’eau de la mer. C’est lors de cette purification que naquirent les nombreuses divinités qui devaient lui succéder. Il faut ajouter qu’à Amaterasu, la déesse solaire qui gouverne la Haute Plaine Céleste, née de son œil gauche et héritière de sa pureté, s’oppose Susanowo son frère cadet (…) [qui] reçut en partage la domination de la mer. Par la suite, Susanowo montera dans la Haute Plaine Céleste pour tenter d’enlever à sa sœur aînée le pouvoir qu’elle détient. Sorti vainqueur du combat qui les oppose, il détruit les rizières sacrées de la déesse (…). Amaterasu, qui chérissait son frère, ne retiendra aucune sanction contre lui mais s’enfermera dans une caverne, plongeant ainsi la Haute Plaine Céleste dans les ténèbres et la transformant d’un seul coup en un monde effrayant empli de souillures, de crimes et de calamités. Face à de pareils désordres, les divinités de la Plaine, nées d’Izanaki et d’Izanami, tinrent une assemblée et après avoir délibéré parvinrent à faire revenir la déesse. Susanowo fut jugé en sa présence et, les rituels de purification exécutés, fut expulsé hors de la Haute Plaine Céleste (Yoshie, Macé, 1995 : 287-288).
Berque veut également pour preuve de cette distinction de la conception de nature, l’absence dans la langue japonaise originelle (en amont de l’introduction de la langue chinoise), dans ce qu’il est convenu de dénommer yamato kotoba, du terme « nature ». Celui-ci sera introduit par le chinois, terme de ziran, qui deviendra shizen. Le terme ziran signifie « affirmation de soi » et s’approche ainsi du concept de nature dans la pensée aristotélicienne, à savoir « ce qui possède en soi le principe de son autonomie motrice » [32].
Certes, rappelle Berque : « l’important n’est pas la notion de nature en soi-même mais la place que la culture japonaise réserve au naturel en tant qu’il surgit à la perception, immédiatement et antérieurement à toute détermination ; (…) il en résulte en effet des façons de voir et d’agir (…) qui peuvent différer profondément des nôtres » (Berque, 1982 : 49).
Enfin, un troisième constat a trait à la distinction entre les notions d’appréhension du réel, telle qu’elle s’impose sous les formes du logos en Occident, et, l’« expérience sensible du lieu », telle qu’elle permane au Japon (Berque, 1986 : 170).
Ce dernier constat a non seulement influencé l’orientation et la cohérence des parties de cet ouvrage mais il éclaire, en complément des approches philosophique et anthropologique de la nature, l’essence des rapports que les Japonais développent avec leur environnement. En fait, les traductions du terme japonais « nature » par shizen, qui ont cours depuis près d’un siècle, occultent en grande partie les ambiguïtés sémantiques de cette notion. Le géographe orientaliste cite le fait que deux acceptions apparaissent fréquemment dans les dictionnaires japonais du terme « nature », l’une shizen renvoyant aux termes « cosmos, environnement, paysage » ; l’autre honshitsu se référant à l’essence et à la nature propre, voire le caractère, la disposition. Si le premier sens semble ici guider le propos, il n’en est pas si sûr tant les deux acceptions du terme sont liées (ibid. : 171). Le terme « nature » (shizen [33]) reproduit la prononciation du terme chinois ziran par la suite de l’adoption du modèle de civilisation chinois aux VIIe et VIIIe siècles. Or, son usage a très rapidement été corrélé à la pensée bouddhiste davantage qu’à la pensée confucianiste à laquelle on se référait à l’époque par le terme de kangaku, études chinoises.
Toutefois, il semblerait que plusieurs commentateurs japonais fassent remonter l’usage du terme « nature » à la pensée taoïste de Laozi [34] au VIe siècle avant J.-C. (ibid. : 172), soit une forme d’équivalent de non-agir (wu wei), qui, par opposition aux inclinations du moi (wo), aurait donné naissance à l’expression wu wei ziran : « rejeter tout artifice et laisser le naturel jaillir de soi ». Les confucianistes posaient pour antonyme de la notion de nature, le terme wen (l’écrit, ce qui est produit par l’effort et qui se rapportera à la notion de culture).
Plus tard, commente Berque, le philosophe chinois Zuangzhi (IVe /IIIe siècles avant J.-C.) inclura dans le terme ziran, le sens de « monde en tant que monde distinct de l’homme » (tian) et la « nature humaine » (xing). Ainsi, le terme recouvrera une valence morale positive en tant que terme proche de la conception écologique de l’environnement (plantes, rivières, etc.) et constituera une source d’inspiration, voire de régénération du genre poétique et de la peinture de paysage.
Mengzi [35] (377-288 avant J.-C.) proposera également de relier le tian avec la notion de xing (nature humaine), le respect du Ciel inclinant à la vertu, la nature de l’homme apparaît ainsi intrinsèquement « bonne ».
L’optimisme de ces différentes conceptions taoïstes ou confucianistes valorise le fait pour l’homme de « suivre la nature » afin de ne pas rompre avec la relation organique qui l’insère dans l’univers [36], un idéal qui sera repris par le terme de zaohua et donnera naissance à l’appellation de zōka en japonais.
Les emprunts japonais aux vocables chinois désignant le terme « nature » ont été accompagnés d’une tendance qualifiée de « physicophile », car elle entrait en harmonie avec des pratiques autochtones de vénération des éléments naturels. Berque oppose ce point de vue à la vision « physicophobe » de la pensée chrétienne, celle d’une nature créée – dont il a été question au chapitre cinq –, souvent dite mauvaise (en lien avec l’image du péché originel), païenne et qu’il fallait conquérir et évangéliser. Aussi le plus vieux recueil de poème japonais, le Manyōshū, compilé au VIIIe siècle après J.-C., fait-il état d’une relation amicale et fraternelle entre l’homme et la nature.
Certes, il y a matière à étonnement dans le fait que l’adoption d’une civilisation technologique après Meiji (1868) ait conduit le Japon à rompre avec cette relation traditionnelle envers la nature. Cela sera débattu plus loin et participera de l’introduction de la troisième partie concernant l’appréhension des risques et catastrophes naturels au Japon.
Ainsi, en revenant à l’adoption par les Japonais du terme chinois ziran, on s’aperçoit qu’il se prononce en japonais shizen (en lecture on-yomi, lecture chinoise) mais onozukara shikari (en lecture japonaise, kun-yomi) [37]. L’origine étymologique de cette expression associe le terme de shikari (être ainsi) et de onozukara – « soi-même » (ono), la particule de liaison génitive (tsu), et, le terme de « naissance, genre, famille » (kara) –, soit une phraséologie proche de la notion d’autogénèse, voire d’homopoïesis : « être le sujet de son propre avènement au monde, « de sa propre surrection (Aufgehen, phusis) (…) ce qui ne laisse pas de place pour une objectivation réflexive de la nature, un retrait de l’homme par rapport à l’environnement écologique et au cosmos » (Berque, ibid. : 175-176).
En d’autres termes, on pourrait dire que l’étymologie japonaise du terme « nature » reflète une pensée majoritairement associée à une éthique biocentrique qui laisse ainsi peu de prise à l’anthropocentrisme.
Cependant, il serait inexact de cantonner la pensée japonaise de la nature jusqu’à l’ère de Meiji à celle d’un âge présocratique et de penser qu’elle n’aurait pas entrepris un certain travail de distanciation entre les notions de nature et de culture et notamment lors de l’époque féodale. En effet, Berque met en évidence l’apport du philosophe Sorai Ogyū (1666-1728) qui, dans le courant du néo-confucianisme en vogue lors du shogunat des Tokugawa (1603-1867), opposa l’essence sociale de l’ordre politique à un ordre cosmique (tenri), mettant par là-même en lumière l’artificialité (sakui) de l’ordre politique et son historicité :
en effet, en attribuant aux Sages de l’Ancien Temps (Sen.ō, i.e. les empereurs de la Chine Yao, Shun et Yu) et non pas à la nature (tennen shizen, chinois tianran ziran), l’institution de la culture (« La Voie », michi – même idéogramme que Tao – dans le vocabulaire néo-confucianiste), Sorai opérait une objectivation et une relativisation analogues dans leurs principes à celles du Descartes de la lettre à Mersenne du 15 avril 1630, laquelle pose les lois mathématiques comme instituées (par Dieu), et non point vraies par immanence (ibid. : 177).
Un autre analyste japonais et philologue de l’époque des Tokugawa, Norinaga Motoori (1730-1801), tentera d’affirmer l’origine de la culture japonaise en-deçà de l’institution féodale. Cependant, ces deux démarches resteront marginales et ne permettront pas pleinement à l’objectivation de la nature de s’épanouir au Japon comme cela avait été le cas en Europe occidentale et elle laisseront la conception « émotive » originale de la nature permaner dans l’archipel.
La poésie, et notamment l’art du haïkaï [38] magnifié par le poète Matsuo Bashō (1644-1694), qui fut un artiste pénétré de zen et de néo-confucianisme, enjoint à tout sujet présentant des velléités d’écriture « d’atteindre au naturel (…), de « retourner à la nature » (zōka ni shitagai) et le terme zōka signifie dans ce contexte précis la « création ». Berque propose une interprétation du voyage de Bashō comme une façon de « boucler la boucle », de retrouver la nature au bout de la culture et de lier voyage poétique également à « une montée, une anabase, un trajet de paysage qui ramène l’homme à la nature » (ibid. : 181).
Pendant l’époque d’Edo (1603-1868), la culture citadine atteint son apogée en matière de raffinement et d’esthétisme. Des dualismes taxinomiques se font jour entre, d’une part, l’élégance raffinée de la cour (miyabi), qui attribue une valeur excessive à la nature, et, d’autre part, la rudesse, la rusticité de la province et du peuple (hinabi). Il en va de même avec la culture citadine, une urbanité empreinte de snobisme (iki) et le monde paysan, rustique (yabo). Or, comme le rappelle Berque, c’est la nature qui oriente la culture citadine et esthétique dans les deux cas et la « nature que l’on invoque n’est nullement sauvage ; c’est une nature construite » (ibid. : 184). Ce trait d’une « nature construite » et de sa portée métaphorique sera illustré dans les chapitres qui suivent concernant les notions d’esthétique et de spatialité.
Berque pose une question cruciale quant au développement des rapports homme/nature et qui sera ici reformulée en les termes suivants :
« Se pourrait-il qu’il existe des failles dans le continuum de la culture et dont jaillisse de la nature ? ». En vue de répondre à un tel questionnement, le géographe allègue la possible intervention de la notion esthétique d’impermanence (mujō), comme une faille dans l’ordre des choses, et, portée aux nues par les créateurs japonais. Ainsi, les terrains vagues, traces de nature en ville, permettent ce jaillissement tout autant que la forêt sacrée du sanctuaire shintō, sise dans un univers citadin, qui « réfère l’urbain à la nature » (ibid. : 191).
Il semble, au regard des considérations précédentes, que ce soit l’interpolation du sujet (le changement de référent) qui permette de désigner ce qui est de l’ordre de la nature et de la culture dans la société japonaise.
Pour expliquer cette interpolation du sujet « interprétant », Berque forge la notion de « médiance » et appelle à la constatation d’un triple processus : l’illusion qui associe au naturel ce qui est d’ordre du culturel et/ou de l’historique ; la possibilité que l’action humaine « embraye » sur la nature ; la volonté de l’homme de dépasser la nature dans son domaine propre (le naturel), c’est-à-dire de créer la nature, de la remodeler. Pour étayer sa démonstration, le géographe emprunte aux réflexions de Tanaka Seidai, analyste reconnu de l’art des jardins japonais [39], et, étudie quelques préconisations sur le paysagisme extraites du Sakutei-ki, ouvrage de référence – et l’opposition nature/plastie dont les principes concordent avec cette perspective qu’il nomme « trajective ».
En effet, selon une des recommandations du Sakutei-ki, l’architecte [paysagiste] doit « suivre ce que la pierre demande » (sono ishi no kohan ni sagashite) et répond selon Berque à une « attitude trajective qui (…) exige la co-présence des deux sujets, c’est-à-dire de deux systèmes référentiels, l’un centré sur l’architecte, l’autre sur la pierre, et leur dépassement par un système plus général, dépassement dont l’œuvre (le jardin) sera l’expression matérielle » (ibid. : 195).
Un autre exemple abordé par Berque consiste à comparer les us et coutumes fonctionnels et décoratifs qui précèdent la cérémonie du thé (chanoyu) chez deux maîtres respectés, Sen no Rikyū (1522-1591) et son disciple Furuta Oribe (1543-1615), étant donné qu’il existe une propension au Japon à entrevoir dans le fonctionnel un côté naturel et dans l’artifice un aspect décoratif. Avant la cérémonie, Sen no Rikyū avait pour coutume d’attendre que quelques feuilles ou fleurs ne tombent sur le sol ou l’allée du jardin, exaltant les qualités esthétiques naturelles et rustiques. Célébré pour son goût rustique et sa « sobriété tranquille », Sen no Rikyū « goûtait ainsi la contingence des feuille épandues par la force naturelle du vent » (ibid. : 199). Son successeur, Furuta Oribe, recommandait, quant à lui, de répandre des aiguilles de pin sur l’allée menant au pavillon à thé. On aura tôt fait de comprendre que l’artifice vaut dans ce cas « de faire plus naturel que nature » et que Furuta Oribe a également conçu, de manière métaphorique, d’exprimer la quintessence du naturel par l’artifice, « c’est-à-dire que, dans une certaine mesure, Oribe ait incarné, en l’amplifiant, une tendance inscrite par la nature dans le cours des choses » (ibid. : 201). Et, le géographe de poursuivre son analyse sur le style d’Oribe en matière de pavage et d’alternance entre empierrement artificiel et naturel des allées menant au pavillon de thé Ennan à Kyōto : « Oribe comparé à Rikyū n’est pas qu’un maniériste : en cherchant à systématiser la contingence apparente de la nature, il lui arrive bel et bien de failler la culture et de livrer par là un passage au sens de la nature » (ibid. : 202).
Une autre caractéristique qui dénote le rapport distinct de ces deux maîtres de la cérémonie du thé avec la notion d’esthétique demeure présente dans le choix et l’usage des accessoires comme les bols de céramique. Sen no Rikyū a recours à des bols dont la sobriété et le « naturel » sont recherchés et s’efforce ainsi de « dompter l’artifice » ; Furuta Oribe, en revanche, recherche des expédients pour renforcer la naturalité via l’artifice – il conçoit, avec le tour, des bols qu’il déforme volontairement pour rehausser l’irrégularité des formes naturelles. Ainsi, souligne Tanaka Seidai (1967 : 149), alors que le premier maître tente d’estomper sa personnalité et de rendre l’artifice des accessoires non manifeste, le second exprime sa personnalité en s’investissant dans un travail d’artificialisation intense. Berque associe l’analyse de Tanaka Seidai à un positionnement de la personnalité du maître dans le registre de la culture alors que la nature revêt une qualité sociale. Des liens sont envisageables avec la gouvernance des Tokugawa (et notamment de Tokugawa Ieyasu [1543-1616]) qui imposait à l’époque un « ordre naturel » et réprimait les trop fortes personnalités qui auraient pu représenter une menace de cet « ordre naturel ». Il ressort de ce constat de Tanaka Seidai une forme d’éthique comportementale : les attitudes collectives sont étroitement associées au sein de la société japonaise au caractère naturel des faits et des choses alors que les attitudes individuelles se démarquent par leur coloration artificielle. Berque précise néanmoins que l’ordre naturel inspiré du « style Rikyū » est celui qui fera office de référentiel, de commande sociale lors du shogunat des Tokugawa, et, que le « style Oribe », qui exprime une déchirure dans cette « culture du naturel », n’y trouvera point sa place : « dans la mesure où la société fait de la nature un paradigme – un modèle que la culture reproduit –, la vraie nature ne peut en effet s’exprimer que par un écart créateur vis-à-vis de ce paradigme. Autrement dit, dans un contexte où la culture exalte le naturel, la nature, c’est de ne pas faire naturel » (Berque, 1986 : 202).
Il existe une opposition franche entre la logique topologique japonaise, logique du champ, et la logique prédicative aristotélicienne. Dans ce sens, cette logique topologique est l’apanage de la pensée nishidienne (Nishida Kitarō) et est étayée par l’analyse des structures linguistiques, architecturales et de la conception de l’esthétique dans l’archipel. Elle pose, comme principe d’appréhension du réel, la logique du lieu (basho), siège de l’expérience pure (jinsui keiken) et héritée de l’expérience du bouddhisme zen, notion qui apporte un éclairage à certaines interprétations sociétales japonaises. La conception du lieu s’offre à une interprétation phénoménologique, on parlera plus tard d’herméneutique du lieu. Berque (1982 : 50) le définit ainsi : « le lieu n’est fondamentalement rien autre que ce qui s’offre à la perception de manière contingente, à un moment donné et en fonction de quoi le sujet s’adapte ». Historien de la pensée orientale, Nakamura Hajime, montre que la pensée japonaise pose « le phénoménal comme seul absolu et ne reconnaît l’existence d’aucun principe qui le transcenderait ».
Selon cette perception, la philosophie japonaise joint réel et phénoménal. Elle s’oppose en ces termes avec l’idéal kantien selon lequel « la seule réalité irréductible est la conscience du sujet » (ibid.).
Aussi, pour résumer, est-il loisible d’énoncer que « pour les Japonais, le sentiment de nature est dicté par l’appréhension phénoménologique du réel », conception qui, selon Berque, « procède sans doute en partie de l’animisme shintoïque » (ibid. : 51).
Ces mêmes conceptions ont « japonisé » la pensée bouddhique, l’isolant ainsi du bouddhisme indien et chinois. On pensera au bouddhisme zen et à la célèbre maxime de Dōgen (1200-1253) : « l’aspect réel est toute chose. Toutes choses sont cet aspect, ce caractère, ce corps, cet esprit, ce monde, ce vent et cette pluie (…), ce pin toujours vert et ce bambou qui jamais ne rompt » (ibid. ).
Ce courant qui prône que la réalité des choses est directement saisissable par l’expérience a orienté l’expression littéraire poétique (et notamment la production de haïkus) ainsi que l’esthétique et l’architecture comme cela sera présenté plus loin. Or, cette réalité est autant sociale que naturelle et ce principe offre une grille d’intelligibilité dont il sera à nouveau question dans la troisième partie quant à l’appréhension et à la communication des et sur les catastrophes environnementales.
Cette conception première du lieu explique l’importance qui sera réservée ici à l’analyse de la spatialité qui suivra. De cette logique de préséance du lieu sur le sujet découle une distinction fondamentale entre le principe d’allonomie (taritsusei) du sujet japonais et d’autonomie (jiritsusei) du sujet occidental. Berque résume fort à propos la distinction opérée par Araki Hiroyuki [40] dans la « résignation de l’individu qui abandonne tout jugement personnel pour assumer la norme du milieu » (ibid. : 52).
Cette première lecture d’un sentiment de nature indissociable de l’expérience du réel et de l’acceptation du milieu est en lien direct avec la problématique centrale de cet ouvrage : à savoir le dépassement de l’explication essentialiste de certains comportements et processus de communication rapportés par les médias internationaux en tant qu’attitudes résignées et stoïques de la population japonaise face aux catastrophes environnementales et capacité « phénoménale » (et cela tombe sous le sens ici de « phénoménologique ») de reconstruction et de résilience à un trait culturel. Or ce simple étiquetage, comme le comprendra aisément le lecteur, pourrait être entaché de culturalisme en absence d’explications fondées sur l’appréhension du réel et sur l’acceptation du milieu.
Croyances et respect de la nature, entre animisme et analogisme
Les rapports entre la cosmogonie japonaise et la nature apparaissent majoritairement corrélés à l’apport de vagues migratoires anciennes. Le géographe Philippe Pelletier [41]attribue l’emprunt d’un ensemble de croyances à deux aires de civilisation laurisylvaine [42] – forêt persistantes – issues du continent asiatique : les coutumes et croyances liées à la montagne et à la forêt du Yunnan chinois ; les rites agricoles, et notamment l’élevage, de Chine septentrionale et de la péninsule coréenne ; les croyances et techniques halieutiques de la civilisation méridionale du kuro-shio [43] ; les mythes impériaux des cultures ouralo-altaïques sibériennes.
Le Shintō et la nature
Dans son acception la plus ancienne, le terme shintō fut mentionné la première fois dans les Annales du Japon (Nihon Shoki) en 645, sous le règne de l’empereur Kōtoku. Selon sa définition la plus générale, le shintō – littéralement voie des dieux – désigne une religion indigène japonaise qui est née du peuple et entretenue par lui mais qui ne comporte ni dogme, ni révélation. Elle repose sur une conception panthéiste du monde dont participent rites et pratiques. Il est fréquemment admis de se référer au shintō en tant que système de valeurs, mode de pensée et de comportements qui pénètrent profondément tous les aspects de la vie japonaise. L’anthropologue Anne-Marie Bouchy [44] cite la permanence avec l’Histoire de ses éléments fondamentaux :
la conception des dieux et rapports avec la nature ; le culte des dieux ancestraux liant les familles, les lignées et les communautés locales ; les pratique de possession et d’oracles qui entretiennent le sens de la continuité entre les dieux et les hommes dans l’au-delà (…) et en ce monde (…) ; la morale sociale, fondée sur le sens de la pureté et de la souillure, et sur celui de la piété familiale, qui découle d’une telle vision du monde (Bouchy, 1994 : 460).
Une autre caractéristique du shintō provient de son association originale avec d’autres formes religieuses – les doctrines taoïstes, bouddhistes, confucianistes – et au fait qu’il n’a jamais longtemps atteint la maturité de religion d’État si ce n’est lors de la période de l’empire moderne (1868-1945) (ibid. : 460).
L’objet n’est pas ici de détailler les différentes périodes qui ont marqué l’avènement puis les alliances du shintō avec d’autres formes de pensée religieuse, ni la force sociale qu’il incarnera en 1868 à partir du gouvernement de Meiji qui ordonnera sa séparation du bouddhisme et proclamera l’instauration du shintō d’État, unifiant ainsi le shintō de la Maison impériale et des grands sanctuaires de l’archipel ; ni la suppression du shintō d’État en 1945 à la fin de la guerre [45].
Toutefois, sans prêter une attention particulière audit shintō des sanctuaires (sa face traditionnelle), c’est au sein du shintō populaire que sera analysée l’essence de la cosmologie japonaise et de ses rapports avec la nature, qui participe d’une forme spécifique de pensée animiste. Cette forme de shintō s’exprime dans les communautés locales, agraires ou citadines en tant que « corps de croyances envers les dieux et de pratiques cultuelles traditionnelles, indépendamment de toute gestion exercée par les autorités religieuses centrales » (ibid. : 462). Il découle de cette organisation des sanctuaires de dieux protecteurs des communautés locales ou parfois même de dieux ancestraux (ujigami) d’une même famille ou parenté, situés sur les terres de la maison mère.
Ces lieux propitiatoires sont également des centres d’activité de la vie cultuelle locale auxquels se rendent les habitants de ces territoires pour célébrer les fêtes calendaires : « fêtes de printemps et d’automne (demande d’abondance et remerciement pour les moissons), pour le Nouvel An, ou encore lors d’événements extraordinaires pour invoquer protections et faveurs particulières (en cas de guerre, sècheresse, épidémie, etc.) » (ibid. : 464).
Berque qualifie la relation au sacré à travers le bois qui entoure le sanctuaire en tant que relation métaphorique culture/nature, expression d’une liminalité :
les frondaisons sacrées du bois sacré indiquent métonymiquement la présence du sanctuaire qu’elles dissimulent matériellement ; mais le sacré, dimension où se déploie véritablement l’être du sanctuaire et du bois qui l’entoure, relève de la métaphore et non de la métonymie. Progresser à travers le bois pour parvenir au sanctuaire, c’est progresser dans le sacré ; c’est transférer métaphoriquement le bois comme végétalisation dans le bois comme initiation ; transfert que lui-même symbolise un autre parcours : la transition culture (la ville)/ nature (le bois)/ surnature (le domaine des kami matérialisé par le [sanctuaire]) (Berque, 1986 : 269).
Il existe une organisation du culte communautaire, un tour de rôle assumé par les chefs de famille (tōya) (maison-chef ou « maison dont c’est le tour d’honorer les dieux ») et des confréries variées (kō), chargées de l’organisation de célébrations votives.
La Seconde Guerre mondiale et l’industrialisation, précise l’anthropologue Laurence Caillet, ont radicalement bouleversé la société japonaise et « provoqué la disparition d’un très grand nombre de rites. Les mouvements de population ont rendu impossible l’accomplissement des rites collectifs et amputé les rites familiaux de leur assise communautaire (…). Les individus conservaient des habitudes alimentaires issues de pratiques rituelles mais dépouillées de tout sens [46] » (Caillet, 1980 : 7).
Or, la chercheuse souligne le rôle récent majeur du tourisme, des groupes de jeunes et des associations sportives dans le processus de revitalisation de ces traditions cultuelles locales et régionales. La variété de ces rites permet de les classer selon plusieurs points de vue – « calendrier, communauté de fête, nature des divinités fêtées, rites proprement dits » (ibid., p. 8). Il est également envisageable de s’y référer à travers les étapes du travail agraire et principalement celui de la riziculture [47] (printemps-été, les semailles et le repiquage ; automne, les récoltes tout en apportant une attention spéciale aux festivités du Nouvel An et à la saison rituelle des morts en été).
Le sanctuaire, en tant que tel, comprend généralement une enceinte, abritant arbres et « forêt sacrée », dont la position haute est considérée dans le fond (oku) ou le haut par rapport aux habitations. Les cultes puisent leurs origines tant dans la religion primitive que dans l’histoire locale des communautés. Une des grandes originalités du shintō a trait à sa multiplicité de lieux de culte et à son animisme. Une roche, un arbre, un étang, une cascade, une pierre, un simple oratoire en bois…, tout est prône à se transformer en lieu de culte.
Dans les communautés locales rurales sont vénérés les dieux de la montagne (yama no kami) ou « aspects archaïques des dieux ancestraux et forces de procréation » ; dans les communautés agraires en plaine, les dieux des rizières (ta no kami) ; le long des côtes, les dieux de la mer (kaijin), etc. » (Bouchy, 1994 : 464).
On remarquera, toutefois, que les divinités (kami) peuvent être invoquées de manières distinctes suivant le temps, le lieu et la fonction de leurs apparitions :
le dieu de la rivière, saku-gami, descend au printemps dans les rizières et les champs pour protéger les cultures en tant que divinité de l’agriculture et il remonte en automne dans les montagnes en tant que divinité de la montagne. (…) [Ainsi, dans certaines régions], la fête du jour du sanglier, (…) qui marque la fin des récoltes, saku-gami [le dieu de la rizière] se voit également baptisé « divinité marcassin », inoko-sama (Caillet, 1980 : 361).
Certaines traditions, comme les anniversaires rituels des racines, célèbrent les récoltes de plantes sauvages ou cultivées (châtaignes, ignames, colocases, radis, navets…). Caillet rend compte du fait que « ces fêtes [des ignames] suggèrent que les tubercules (…) peuvent transmettre l’énergie vitale d’un esprit ancestral érigé en divinité tutélaire » (ibid. : 391).
S’ils résident la plupart du temps dans des arbres ou sous des pierres, les dieux sont polymorphes et se révèlent via une diversité de formes animales, végétales ou d’éléments naturels. Ainsi singes, sangliers, biches, serpents peuvent-ils être considérées comme des émanations du dieu de la montagne et serpents et dragons comme celui du dieu de la mer.
Les communautés urbaines possèdent aussi leurs cultes qu’elles vouent aux dieux de la prospérité (fukujin) en vue d’attirer leur bienveillance. Enfin figurent également au sein de cette cosmologie les dieux du foyer (expression nipponne des dieux lares) et chaque demeure, commerce, entreprise, etc., conserve son autel particulier pour les dieux du foyer, du fourneau, d’outils et de bâtiments spécifiques, du sol, du jardin, de l’eau…autel qui associe ontologies animistes et analogistes. Comme cela vient d’être précisé la particularité du régime ontologique animiste du shintō populaire (qui allie intériorité des humains et des non-humains bien qu’il dissocie leurs physicalités) est qu’il revêt tant de variétés distinctes d’associations et de pratiques cultuelles singulières qu’il s’apparente aussi à une ontologie analogiste via les rites dédiés aux divinités.
Que ces rites suscitent parades, libations ou retours et prosternations sur les tombes ancestrales, leurs aspects saisonniers sont innombrables. Caillet (1994 : 205-208) associe les « célébrations annuelles des tokiori « pliures du temps » [à] des moments particuliers du calendrier, où le monde profane se revivifie au contact du sacré (…) ». L’anthropologue rappelle également que ce sont généralement les hommes qui effectuent ces rites devant les divinités tutélaires des communautés locales et que cela nécessite des stades de purification (réclusions, ablutions diverses) suivant le degré de solennité des événements et cérémonies. Le déroulement schématique d’un rite inclut plusieurs phases comme celles de la préparation de la communauté, des purifications préliminaires, de l’accueil du dieu, du don d’offrandes et de prières, de rites de clôture. Les dieux ne résident pas dans les localités et sont accueillis la plupart du temps sous la forme de processions et de transports d’autels portatifs à dos d’homme ou sur des palanquins. L’expression de la divinité est à nouveau polymorphe, éléments naturels (branches d’arbre, bois, pierre) ou artificiels (papier, calligraphie, miroir, etc.). Les offrandes qui sont présentées à la divinité sont de trois essences vivrières : mer (poissons, algues), montagne (racines, fruits sauvages), champ (riz, alcool de riz) puis sont consommées par l’ensemble des assistants et des officiants (naorai).
On remarquera que les dieux reviennent à la nature dont ils étaient partis dès lors que les célébrations s’achèvent : « selon les procédures les plus courantes, le “corps” du dieu est jeté à l’eau ; les décorations de fête sont brûlées sur un bûcher et la divinité s’éloigne dans la fumée avant qu’on raccompagne son palanquin, en cortège, jusqu’au sanctuaire » (ibid. : 208).
C’est à Berque que revient d’apporter une précision quant à la nature indissociable du culte des divinités locales avec l’ancrage dans la naturalité [48]. Les dieux locaux et leur vénération correspondent à une version laraire du culte fondée sur une vision de l’autorité qui allie « maternalité » et « naturalité », une caractéristique cultuelle qui s’exerce sur les divinités de la terre génitrice (ubusuna kami) et qui conduit Berque à résumer les propos sus-mentionnés : « l’autorité du milieu procède à double titre de la nature : par son lien topique avec l’environnement physique, et de par son lien générique avec l’idée de naissance. À la parenté sémantique instaurée par le latin entre natura, natio et nasci [49] s’ajoute ici, et s’inscrit une dimension écologique ancrée dans un milieu défini » (Berque, 1986 : 267).
Nature et esthétique
Pierres brutes dressées
Cours d’eau méandreux
Joie infinie
Pierres dressées et sentiment exalté de nature au temple zen de Kōmyōzen-ji à Dazaifu, Département de Fukuoka. Cliché : Jean Lagane, juillet 2010.
Une deuxième entrée thématique ayant trait à l’analyse des représentations de la nature au Japon concerne la notion d’esthétique au sein de laquelle la nature est souvent magnifiée.
Dans un premier temps, la peinture japonaise et ses associations biocentriques seront présentées puis la notion spécifique d’esthétique sera abordée de manière complémentaire.
L’art pictural japonais, au sein duquel peinture et écriture vont de pair, représente selon les orientalistes Danièle et Vadime Elisseeff « une juxtaposition extrêmement touffue d’écoles, de tendances, de procédés venus des quatre coins du monde » (Elisseeff & Elisseeff, 1974 : 345) [50]. Cependant, il est possible de faire remonter l’émergence de l’art pictural au Japon à l’apport des traditions du continent asiatique et de la civilisation chinoise ainsi qu’à l’introduction du papier, de la calligraphie [51] déjà en vogue à l’époque des T’ang en Chine, et de la pensée bouddhique (datée officiellement de l’an 552), qui eut tôt fait de témoigner d’une combinatoire de conventions picturales. La peinture bouddhique domina une large période (des VIIe au XIVe siècles) avec une thématique axée sur l’introduction de cette nouvelle religion (ou mode de pensée), sur les scènes de vie du Bouddha, de rois et ministres de la foi (boddhisattva), très souvent représentés devant un paysage idyllique, une nature fantasmée ou menaçante. Néanmoins, dès le Xe siècle et jusqu’au XIVe siècle, naquit un style pictural autochtone, le yamato-e issu d’un monde profane (paysages, romans, légendes). Le sentiment de nature qui transparaissait de ces œuvres, voire celui d’une nature intimiste, relevait d’un phénomène de japonisation. De nombreux paravents de cette époque témoignaient d’un style national dont il émanait « sérénité et harmonie entre l’homme et la nature environnante » (Bayou, 1994 : 382). Puis la période du XIVe au XVIe siècle connut un renouveau des influences chinoises avec le style du lavis à l’encre de Chine (suiboku), qui participa de la mutation esthétique de l’époque de Muromachi (1392-fin du XVe siècle), liée à l’introduction du vocabulaire pictural du bouddhisme zen (chan en chinois). Les thèmes trop conventionnels furent délaissés alors que fleurit une attention toute particulière vis-à-vis de « simples relations atmosphériques entre les sujets (figures originales du bouddhisme ou du taoïsme, animaux saisis sur le vif, paysages délavés ou simples végétaux) et leur environnement naturel » (ibid. : 384-386).
Cet art permit à une ontologie analogiste de s’épanouir. Les environnements naturels dépeints évoquaient maximes et préceptes zen, étant donné qu’un grand nombre d’artistes étaient des moines-peintres qui valorisaient la « rapidité d’exécution, la liberté du trait, l’instantanéité, le dépouillement » (ibid. : 384). Ce fut l’apogée japonaise des peintures monochromes. Le thème majeur du paysage favorisa également le changement de formats – on passa du rouleau vertical (kakemono) à la surface élargie des portes coulissantes (fusuma) puis à celle des paravents (byōbu).
On retrouve à nouveau l’évocation de la proximité de ce rapport à la nature dans le traitement de la peinture chinoise de paysage, dont parle François Jullien dans son ouvrage Éloge de la fadeur, À partir de la pensée et de l’esthétique de la Chine [52]. Le philosophe orientaliste commente l’appropriation esthétique d’une pensée bouddhique dite « médiane » (oscillant entre prise de conscience de la vanité de croire à la permanence des choses sans pour cela prôner un détachement total du monde), venue de l’Inde et mélangée de taoïsme, qui s’épanouit à travers les peintures de paysage : « Des arbres au bord du rivage, une étendue d’eau, de vagues collines, un pavillon désert… (…). Ces paysages monotones, monocordes contiennent en eux tous les paysages où ils se fondent et se résorbent » (Jullien, 1991 : 31). L’auteur poursuit : « à la fadeur éprouvée dans les choses correspond la capacité de détachement intérieur » (ibid. : 37).
Jullien pointe ainsi le fait que la fadeur, qu’il relie à une expérience sensible – « même si elle nous situe à la limite du sensible, là où il est le plus ténu » (ibid. : 27) – ne correspond pas simplement à la peinture de paysage mais rejoint un idéal et devient expression de sagesse.
Hélène Bayou rapproche la période de stabilité intérieure et d’introspection que connut le Japon durant l’ère d’Edo (1603-1868), et qui encourageait l’essor des écoles académiques, à une « alliance entre tradition et modernité » (Bayou, 1994 : 386-388).
Avec l’essor de la xylographie, une peinture dénommée « images du monde flottant » (ukiyo-e) « supplanta la peinture aristocratique de l’école Tosa soutenue par la cour, ainsi que la peinture sinisante de l’école Kanō qui bénéficiait du patronage des militaires » (Elisseff & Elisseef, 1974 : 351). Il s’agissait d’une peinture de genre narrative et didactique, qui représentait fréquemment sous la forme de peintures ou d’estampes (changa) [53] la veine de l’art populaire et citadin. C’est dans la deuxième partie de l’ère d’Edo, entre 1800 et 1867, que l’estampe de paysage prit toute son ampleur. Cette pratique, rappelle Oka Isaburō [54], conservateur au Musée national de Tōkyō, coïncida avec l’aménagement des voies de communications pédestres au départ d’Edo (Tōkyō) en direction des villes provinciales et la fin de l’insécurité qui vit se généraliser les grands pèlerinages dans les sanctuaires et monastères de province. Aussi, à cette période, les habitant d’Edo « prirent-ils goût aux paisibles promenades en ville ou dans les faubourgs afin d’aller admirer les fleurs [hanami], goûter la fraîcheur du soir ou contempler la neige [yukimi] (…), la nature devint un élément familier du quotidien et envahit les estampes (ukiyo-e) qui transcrivaient ce quotidien » (Oka, 1994 : 181).
Hokusai Katsushika (1760-1849) intégra des techniques japonaises, chinoises et occidentales dans sa série d’estampes – « Les Trente-Six Vues du Mont Fuji » (fugaku sanjūrokkei). L’analyse de ce genre d’estampe de paysage, même si elle fait apparaître des êtres humains avec les paysages en arrière plan de manière naturaliste, préserve un rendu animiste (les éléments du paysage semblent dotés d’une intériorité qu’ils communiquent à l’observateur) :
Hokusai ne voulait pas se couper de la vie quotidienne : au sein des paysages s’intégraient toujours des détails représentant des scènes de la vie du peuple. Nombre de paysages furent composés, de manière audacieuse et inattendue, par de violents contrastes entre le statique et le dynamique, entre l’avant-plan et l’arrière-plan. Montagnes, vagues [55] et hommes étaient imprégnés de sa forte personnalité, et l’audace de leur exagération exerçait sur celui qui regardait cette œuvre une profonde fascination (ibid. :182).
D’autres artistes, dont Hiroshige Utagawa (ou Andō) (1797-1858), portèrent aux nues la sérénité et la grande variabilité de l’atmosphère de la nature et des paysages japonais : « Hiroshige excella particulièrement à rendre la beauté, du vent, de la pluie et de la neige ou de la brume, la physionomie subtile et changeante de la nature, et ses paysages emplis de poésie » (ibid. : 183).
Ce talent de l’estampe de paysage fut reconnu et prisé par les Occidentaux alors qu’il disparut au Japon avec l’ouverture de l’archipel aux découvertes et pratiques artistiques et scientifiques occidentales lors du tout début de l’ère Meiji.
Une deuxième appréciation de l’esthétique japonaise et de son rapport à la nature fait remonter celle-ci à l’attribution (antérieure à l’introduction de la civilisation chinoise) d’un triple vocable et d’une axiologie. Selon l’historien de l’art nippon, Takashina Shūji [56], il s’agit de trois termes typiquement japonais (Yamato kotoba) qui définissent l’esthétique. Le premier, utsukushi [57], exprime une « esthétique du cœur », il manifeste davantage de l’affection, une émotion, qu’une forme d’admiration esthétique et le Japon privilégie ce qui est petit, fragile et éphémère. La beauté semble davantage ressortir du domaine de l’émotion que de l’intellect. La perception de la qualité esthétique n’opère pas selon un fondement naturaliste comme en Occident, « [utsukushi] traduit le sentiment d’attachement éprouvé par le sujet envers des êtres chers, faibles et petits, non leurs qualités intrinsèques » (Takashina, 1994 : 183).
Le deuxième terme qui se rapporte à l’esthétique est le mot kiwashi, soit l’expression d’une beauté minutieuse, une « esthétique » du détail et « de la réduction ». Takashina associe le goût immodéré de ses compatriotes pour tout ce qui est « petit, réduit et détaillé (…) [à] l’un des traits caractéristiques de la sensibilité japonaise » (ibid. : 185) [58], comme en attestent l’art du bonsaï, la miniature des jardins zen, l’ouvrage ciselé des gardes de sabre (netsuke), les scènes de mœurs représentées sur les paravents décoratifs du XVIIe siècle, scènes dites en « vue d’oiseau », etc.
Le troisième terme, kiyoshi, évoque la pureté, « l’absence de souillure et de nuisible qui génère le beau » (ibid., p. 185) et également une « esthétique de l’abnégation ». Takashina reprend plusieurs exemples de dépouillement pour connoter cette qualité : la construction en bois blanc du sanctuaire d’Ise dans le département de Mie ; le monde monochrome du lavis à l’encre de Chine, l’austérité de la décoration de la cérémonie du thé, les mouvements restreints du théâtre nō, etc. Il poursuit en précisant que : « cette “esthétique de l’abnégation”, associée à l’amour du détail, donne naissance au goût du découpage, du morcellement et du gros plan. (…) Les (…) peintures dites « des fleurs et des herbes », très appréciées des amateurs japonais, sont caractéristiques de cette tendance » (ibid. : 186).
Takashina clôt sa description de l’esthétique nipponne à travers les termes de la « quintessence de la continuité ». L’absence de composition fixe des rouleaux peints (e-maki) offre une scène en perpétuel mouvement, lesdits paysages des quatre saisons (shiki sansui) qui connurent une grande vogue, agrègent l’ensemble des saisons sur une même suite picturale et s’opposent aux tableaux occidentaux qui représentent les saisons dans des tableaux séparés. Enfin, cette auteur souligne l’absence de limite franche entre l’intérieur et l’extérieur de l’architecture japonaise, la fluidité et l’impression de diffus de l’urbanisation nipponne comme autant de signes tangibles de cette esthétique de la continuité (ibid. : 187).
Cependant Takashina semble passer sous silence deux concepts importants qui participent d’une analyse axiologique de l’esthétique japonaise : l’esthétique dite du wabi-sabi. La notion de wabi [59] correspond, selon Berque (1994 : 512-513), à « une notion esthétique et morale, souvent associée à celle de sabi, concernant (…) la cérémonie du thé et la poésie et exprimant un goût de la solitude tranquille, loin des soucis du monde ».
On doit le raffinement de l’esthétique du wabi au maître de la cérémonie du thé du XVIe siècle, Sen no Rikyū, dont l’influence déterminante a déjà été mentionnée supra, pour qui wabi résumait : « la simplicité, le dépouillement, voire l’austérité des formes et des couleurs et des matières, à travers lesquelles s’exprime un idéal moral qui voit la véritable richesse dans le cœur de l’homme et non dans les choses qu’il possède » (ibid. : 512) [60].
Cette perception des choses dans le Japon des XVe et XVIe siècles n’était pas le seul apanage de Sen no Rikyū, des maîtres de thé (ou « hommes de thé »), mais également du théâtre nō. Ainsi, évoque l’essayiste Katō Shūichi [61] : « Zeami [62] recommandait, aux acteurs du nō, de ne pas trop dire, de ne pas trop jouer en recherchant des effets. La suggestivité du “temps mort”, il l’a soulignée, et il a signalé que le temps muet sans mouvement pouvait être une expression riche » (Katō, 2009 : 193).
La sinologue et spécialiste de la peinture et de l’art en Chine et des jardins, Yolaine Escande [63], évoque les éléments que le jardin de thé japonais valorise comme l’imperfection, l’incomplétude, le commun et le simple à travers l’esthétique du wabi (2013 : 113) et cite la définition du Grand Ricci [64] : « douleur languissante et solitaire mêlée d’une certaine paix » (ibid. : 108), puis celle de François Berthier, « un raffinement masqué de rusticité » [65].
Le terme de sabi [66], sorte d’esthétique de l’écoulement des choses, s’applique davantage à la poétique de Bashō (1644-1694), et,
exprime un goût pour ce qui porte la marque du temps, la simplicité liée au renoncement et à la solitude, mais aussi l’élégance née du raffinement de cette simplicité (…) ; avec Bashō, sabi devient un principe esthétique fortement positif, dans lequel la connotation de dépérissement et de désolation s’estompe devant des valeurs attachées à l’éveil moral et sensible de celui qui sait trouver la sérénité dans le passage du temps et le déclin même de toute chose (Berque, op. cit. : 513).
Ainsi le terme sabi correspond-il également, selon Yolaine Escande, à : « un sentiment de mélancolie d’ordre humain, existentiel, de désolation, de solitude, qui rappelle l’impermanence de la vie humaine, comme dans l’image des pétales de fleurs de cerisier qui s’égrènent sous la brise » (Escande, 2013 : 109).
La sinologue associe pleinement cette notion esthétique du wabi-sabi à la notion d’incomplétude, de simplicité, de dépouillement et de mélancolie, cette dernière caractéristique étant renforcée par la conscience qu’on ne vit jamais deux fois la même scène et qu’il importe de chérir chaque instant :
Le wabi-sabi peut aussi être compris comme le sentiment de l’expression du cours naturel des choses, la perception de la rudesse de la vie qui avance sans artifice, dans sa nécessité. (…) À travers cette esthétique [wabi-sabi], le monde qui nous entoure peut être appréhendé comme une expérience de vie, voire la matière d’une quête spirituelle. (…) Dans une simple pierre, l’amateur peut lire le passage du temps ; dans un détail, il peut imaginer ou se remémorer un monde, qui va susciter une émotion l’ancrant dans sa relation à ce qui l’entoure. Le wabi-sabi s’accorde au caractère imprévisible de la nature et en fait sa source de réflexion, il met l’accent sur la mutabilité des choses, sur l’appréciation de leur développement et de leur disparition (Escande, 2013 : 109-112).
On retrouve également une expression de ce dépouillement dans l’esthétique du courant artistique réductionniste du Mono-ha (l’école des choses) où des artistes japonais [67], utilisent un style nouveau à partir de 1968. Celui-ci consiste à juxtaposer simplement « des matières naturelles ou industrielles [68], quasi à l’état brut, [pour susciter] des arrangements temporaires et contingents, pour observer le mode de relation entre les matériaux ainsi que la nature de leur état respectif à l’intérieur de ces relations » (Ufan, 2002 : 77-78). On pourrait ainsi considérer que la perspective de ces artistes était allonomique [69], centrée sur les choses du monde et non sur leur égo. En effet, les partisans du Mono-ha recherchaient « à présenter des œuvres ouvertes, qui intègrent le monde non agi par l’homme – l’espace environnant et les matériaux bruts » (ibid. : 78). Comme le précise Edward M. Gomez [70], leurs œuvres, marquées par « une absence de geste personnel, de couleur et de symbolisme » recèlent d’une qualité phénoménologique et résultent en des assemblages, voire de simples déplacements de matériaux qui confèrent à ces installations une énergie propre. En 1969, Lee Ufan, le théoricien de ce courant, pose ainsi dans son œuvre maîtresse – Relatum – une lourde pierre sur une glace de vitrage (Gomez, 1994 : 34-35).
De l’intériorisation de la nature : l’esthétique du chanoyu
Enfin, pour parachever cet ensemble de considérations esthétiques et morales, il convient de singulariser ce à quoi la sagesse populaire se réfère en tant qu’esthétique de la cérémonie du thé (chanoyu), qui participe d’un idéal de « dépouillement (une seul fleur, par exemple, suffit pour le décor), d’incomplétude (ce qu’exprime notamment la forme irrégulière des bols), d’intériorisation (la beauté est dans le cœur)… » (Berque, 1994 : 488).
Ces quelques lignes résument le rituel qui préside à la cérémonie du thé. Il vaudrait mieux parler des cérémonies du thé car celles-ci varient selon les écoles, les saisons, les lieux, les événements. Berque rappelle que les étapes suivent une codification minutieuse [71] : accueil des invités et visite du jardin de thé ; procession des invités dans le jardin en direction du pavillon de thé (sukiya) [72] ; arrêt sur la pierre d’accroupissement (tsukubai) pour effectuer des ablutions au petit bassin creusé dans une pierre (chōzubachi) ; entrée à croupetons dans le pavillon de thé via une embrasure dont l’étroitesse signifie la rupture avec le monde profane ; observation par les invités des éléments de décoration (calligraphie, fleurs, vase) de l’alcôve (tokonoma) ; service d’un léger repas ; combustion du bois ; sortie des invités dans le jardin ; nouvelle entrée des invités ; frémissement de l’eau chaude ; service et boisson du thé épais (koicha) à base de poudre de thé vert (macha) [73] ; inspection des ustensiles et consommation de sucreries sèches ; boisson d’un thé léger (ibid. : 489).
L’analyse de ce rituel de la cérémonie du thé permet de conférer à la scène un idéal « esthétique éthique » de dépouillement et d’intériorisation comme mentionné ci-dessus. Toutefois, on remarquera un aspect paradoxal qui allie une capacité de décentration des sujets via un exercice « internaturel » – les invités découvrent le jardin et partagent quelques instants silencieusement leurs intériorités avec la nature. Puis, les impétrants sont contraints à un exercice de discrimination, voire de distanciation entre, d’une part, la nature (le monde extérieur du jardin de thé, incarnant le profane et le sauvage) et la culture (la pratique sociale, l’artifice de la cérémonie du thé avec sa codification détaillée) ; soit un basculement vers une ontologie naturaliste fondée sur la distinction des intériorités entre humains et non-humains et sur une attention accrue pour les physicalités qu’ils partagent (soucis de l’observation du détail). Bien entendu, ce basculement ontologique est également inclus dans un cadre plus large qui confère à l’analogisme – ainsi comme le précise Berque « la procession des invités via le chemin de pierres espacées du jardin de thé, qui pénètrent par la porte médiane (chūmon) dans la partie interne du jardin (…), symbolise l’accession au monde pur de la bouddhéité » (ibid. : 489).
Figure en haut à gauche : allée du jardin (roji) et entrée dans la « chambre de thé » (les invités pénètrent en s’accroupissant par l’embrasure [nijiriguchi] en bas à droite).
Figure en haut à droite : entrée du jardin de thé, porte médiane (chūmon).
Figure en bas à gauche : détail du jardin de thé, bassin à ablution dans un bloc de granit taillé (chōzubachi).
Figure en bas à droite : intérieur de la « chambre de thé » : hôte officiant devant l’alcôve (tokonoma).
Clichés : Jean Lagane, Kyūshū, juillet 2010.
Ce même basculement peut être pressenti dans la lecture d’un extrait du « Livre du thé » de Okakura Kakuzō :
en outre, le roji, cette allée de jardin qui mène du portique à la chambre de thé proprement dite, symbolise le premier stade de la méditation – le passage de l’auto-illumination. Traverser le roji, c’est rompre tout lien avec le monde du dehors et découvrir une vraie sensation de fraîcheur préparant à la jouissance esthétique de la chambre de thé elle-même. Quiconque a foulé le sol de cette allée ne peut manquer de se rappeler combien son esprit s’est élevé alors au-dessus des pensées ordinaires, tandis qu’il avançait dans la pénombre crépusculaire d’un feuillage, entre les lanternes de granit recouvertes de mousse, marchant sur les pierres espacées avec une irrégularité régulière au-dessus d’un tapis d’aiguilles de pin ; celui-là, fût-ce au beau milieu d’une ville, éprouve la sensation d’être au fond d’une forêt, loin de la poussière et du vacarme de la civilisation (Okakura, 2006 : 82).
Croiser les impressions et représentations d’un anthropologue des techniques, André Leroi-Gourhan [74], qui séjourna au Japon entre 1937 et 1939, avec celles de Berque, géographe et philosophe japonisant, permet d’apporter une distinction complémentaire à cette appréhension de la notion d’esthétique et à son principe moral et fonctionnel :
la cérémonie du thé est un rituel en plusieurs heures au cours duquel un petit nombre de pratiquants se livrent dans la maison et le jardin du thé à des actes simples et quotidiens qui sont purifiés par leur cristallisation dans des gestes conventionnels. Elle comporte une promenade, un repos, un repas, des gestes comme balayer les feuilles sèches, renouveler le charbon de bois du foyer, faire bouillir l’eau, et, pour centre, elle a la consommation d’un bol de thé vert dans de l’eau très chaude. Les gestes doivent être si exacts, si fondus, [sans mouvements] qui soient spontanés, et introduisant le calme dans les âmes, tout doit se passer comme si le lieu était un univers harmonieux où rien n’est choc, imprévu, désaccord. Tout se déroule rythmé, lent, sans intervalle et sans précipitation, sans crescendo ni chute, la conversation est en partie réglée par les formules, les demandes d’explication sur les ustensiles et les parties libres doivent servir à remplir l’espace de sentiments de sympathie mutuelle exprimée non directement mais par le ton d’une conversation insignifiante. Il y a dans une cérémonie exécutée par des maîtres, pour peu que l’hôte étranger n’y soit pas directement mêlé, une beauté paisible, l’impression d’un sommet humain (Leroi-Gourhan, 2004 : 248).
Le cadre de la cérémonie de thé se rapporte également aux caractéristiques de l’esthétique du lieu, de l’architecture du pavillon de thé ou « chambre de thé », « structure éphémère construite à la seule fin d’abriter une impulsion esthétique » (Okakura, 2006 : 74).
Okakura rappelle l’homologie dans le bouddhisme zen entre la maison et le corps, ainsi, à l’instar du corps qui abrite temporairement l’âme, la maison offre au corps un abri temporaire, « une simple hutte au milieu d’une étendue solitaire, abri fragile bâti avec les herbes poussant alentour ». Ainsi, poursuit Okakura : « la fugacité du vivant se voit-elle suggérée par le toit de chaume, sa fragilité par les piliers élancés, sa légèreté par les poteaux de bambou et son apparence insouciante par l’usage de matériaux ordinaires » (ibid. : 88).
Un autre aspect de la chambre de thé, qui correspond à celui d’une « maison du vide », provient de la nudité, de la sobriété extrême de son apparence. Seuls sont présents certains objets et ustensiles qui satisfont l’humeur esthétique du moment. Son esthétique de l’asymétrie doit chercher son origine « dans la nature dynamique de la philosophie [du bouddhisme zen] qui met davantage l’accent sur la façon de rechercher la perfection que sur la perfection elle-même « (ibid. : 92). Aussi les détails des différents objets qui ornent la pièce sont-ils rigoureusement sélectionnés selon leur forme, leur texture, leur coloris, leur thème afin d’éviter toute répétition :
si vous y disposez une fleur fraîche, toute peinture à thème floral est par là-même interdite ; si vous usez d’un chaudron rond, le pot à eau doit être angulaire. Un bol d’émail noir ne saurait voisiner avec un pot à thé de laque noire. En plaçant un vase ou un brûle parfum dans le tokonoma [alcôve], il faut veiller à ne pas le disposer au centre, et plus encore à ne pas diviser l’espace en deux parties égales. Le pilier du tokonoma sera d’une essence différente des autres piliers, afin d’éviter toute impression de monotonie dans la pièce (ibid. : 93).
L’appréciation de la musique fait également écho au processus d’intériorisation de la nature décrit plus haut. Tout en opposant les systèmes de musiques occidentale et japonaise, Claude Lévi-Strauss [75] signalait :
[la musique japonaise] ne possède pas de système harmonique et se refuse à mélanger les sons qu’elle module à l’état pur. Des « glissements variés » affectent les hauteurs, les tempi, les timbres. Ceux-ci intègrent subtilement les sons et les bruits [dont relèvent aussi les bruits d’insectes que les Japonais considèrent en tant que sons [76]] (…) De sorte que l’équivalent d’un système harmonique se réalise dans la durée au moyen de sonorités de qualités diverses émises l’une après l’autre, mais dans un temps suffisamment court. Pour qu’elles forment ensemble un tout. Dans la musique occidentale, plusieurs sons concordent au même instant et engendrent une harmonie simultanée. La vôtre [la japonaise] est successive : elle n’en existe pas moins (Lévi-Strauss, 1990 : 17).
L’anthropologue structuraliste exalta les qualités discriminatoires sensibles des Japonais : « ce serait sans doute aller trop loin que de reconnaître, dans ce goût japonais pour la discrimination, une sorte d’équivalent des règles fixées par Descartes et formulées dans sa méthode (…). Plutôt que d’un cartésianisme conceptuel, je créditerais le Japon d’un cartésianisme sensible, ou esthétique » (ibid. : 17).
Si le système ontologique analogiste imprègne la sensibilité esthétique, il en va de même en ce qui concerne l’organisation de l’espace et des volumes. Pour cette raison, les pages qui suivent seront consacrées à l’analyse de la spatialité japonaise.
NOTES
[1] . Voir Berque Augustin, 1982, Vivre l’Espace au Japon, Espace et liberté, Paris, Presses universitaires de France, p. 12.
[2] . Désormais désignées par SHS.
[3] . L’ouvrage proposé ici reprend, dans les grandes lignes, le second volume de mon mémoire d’Habilitation à Diriger des Recherches en sciences de l’information et de la communication, intitulé : « Vers une communication éthico-anthropologique. Analyse des relations homme/nature et de la médiance pour appréhender les catastrophes environnementales au Japon », soutenu à l’Université de Lorraine, à Metz, le 10 janvier 2014, sous la direction scientifique de Jacques Walter.
[4] . Berque, 1986, Le Sauvage et l’artifice, p. 10.
[5] . On doit au travail méthodique et éclairant d’Augustin Berque, premier occidental a être récompensé du Prix de la culture asiatique de Fukuoka en 2009 (cette distinction honore des contributions individuelles et collectives visant à préserver et à enrichir les cultures d’Asie dans leur unité et leur diversité), l’essentiel des ouvrages francophones sur la mésologie (science du milieu) japonaise et l’exposé des pensées de l’École de Kyōto (Berque, 1982,1986, 1993, 2000, 2011, 2012). L’examen attentif, hérité de l’herméneutique du milieu, parfois baptisée de « mésologie watsujienne », qui renvoie aux travaux du philosophe Watsuji Tetsurō (1889-1960), permet d’appréhender la nature des rapports contrastés entre l’homme et le milieu naturel via des grilles d’intelligibilité distinctes suivant les pays et, notamment, en ce qui concerne l’Europe et le Japon.
[6] . On notera, à ce titre, que la tendance polarisante des discours sur l’environnement, voire quelque peu manichéenne, tend à amplifier l’effet de halo de l’expression de « crise environnementale ».
[7] . La notion de « métabolisme urbain » renvoie ici à la prise en compte des intrants et extrants urbains consécutifs, d’une part, aux déplacements quotidiens de résidents entre des espaces périurbains et urbains et, d’autre part, aux diverses pratiques de consommation et de pollution que ces mobilités et activités occasionnent, voir Lagane Jean, 2013b, « La ville méditerranéenne à l’épreuve de la durabilité, une dialectique Sud/Nord en quête d’équilibre », in Lagane Jean (dir.), Les défis de la durabilité urbaine en Méditerranée, Aix-en-Provence, Presses Universitaires d’Aix-Marseille, p. 13.
[8] . Cet aspect est approfondi par Michael Bess dans son ouvrage salué outre-Atlantique – il a reçu le prix George Perkin Marsh de l’American Society for Environmental History et a fait l’objet de nombreuses recensions, voir Bess Michael, 2011, La France vert clair. Ecologie et modernité technologique, 1960-2000 (traduit de l’anglais par Christophe Jacquet), Seyssel, Champ Vallon.
[9] . Les chercheurs nord-américains et leurs traducteurs français se réfèrent également à ce champ émergent sous l’appellation d’Éthique de l’environnement (Environmental ethics). Pour une question de simplification du propos et afin de ne pas ouvrir le débat aux disputes épistémologiques entre morale et éthique, les termes utilisés pour désigner ce domaine d’études seront ici ceux de Philosophie de la nature. Ainsi les éthiciens de l’environnement seront qualifiés dans cet ouvrage de « philosophes de la nature ».
[10] . Le lecteur pourra se référer en ce qui concerne les liens entre littérature militante écologiste et philosophie de la nature (éthique environnementale) à l’ouvrage de Cheryll Glotfelty et Harold Fromm ; voir Glotfelty Cheryll, Fromm Harold (eds.), 1996, The Ecocriticism Reader. Landmarks in Literary Ecology, Athens, University of Georgia Press.
[11] . Voir Carlson Rachel, 1962, Silent Spring, Boston, Houghton Miflin. Pour la traduction française, voir Carlson Rachel, 1963, Le printemps silencieux, Paris, Plon.
[12] . Voir Descola, 1986, 1994, 2005 ; Viveiros de Castro, 1992.
[13] . Voir Berque Augustin, 1993b, « L’écoumène, mesure terrestre de l’Homme, mesure humaine de la Terre : pour une problématique du monde ambiant », Espace géographique, 22,4, p. 299-305.
[14] . Concernant le dépassement de cette opposition, le lecteur pourra consulter deux parution récentes : Choné Aurélie, Hajek Isabelle, Hamman Philippe (dir.), 2016, Guide des Humanités environnementales, Villeneuve d’Ascq, Presses universitaire du Septentrion, (et plus précisément la « Partie I : Comment penser la Nature ? ») ; Charbonnier Pierre, 2015, La fin d’un grand partage, Nature et société de Durkheim à Descola, Paris, CNRS Éditions (qui éclaire les ambigüités du rapport à la nature des modernes). Voir, pour un complément d’information, Durkheim Émile, 1960 [1912], Les formes élémentaires de la vie religieuse : le système totémique en Australie, 4e éd., Paris, Presses universitaires de France.
[15] . Le propos, s’il peut parfois paraître déroutant pour le lecteur non japonisant, sera émaillé de termes japonais selon la logique foucaldienne de l’épistémè qui est intimement corrélée à l’usage des termes qui véhiculent les façons de penser, de parler et de se représenter le monde (mais aussi qui relèvent de discours scientifiques qui situent une épistémè dans une période précise), cf. Foucault Michel, 1966, Les mots et les choses, Paris, Gallimard.
[16] . Voir, notamment, Berque Augustin, 1986, Le sauvage et l’artifice, Les Japonais devant la nature, Paris, Gallimard.
[17] . La forme abrégée sera utilisée dans cet ouvrage. En réalité, il s’agit de l’usine électrochimique Nihon Chisso Hiryō qui fabriquait de l’acétaldéhyde.
[18] . À propos de cette question, voir Jobin Paul, 2005, Les maladies industrielles et le renouveau syndical au Japon, Paris, Éditions EHESS et l’article de presse : Jobin Paul, 2012a, « Masazumi Harada, défenseur des victimes de Minamata est mort », Le Monde, 20-06-2012.
[19] . Voir Hecht Gabriel, 2004, Le rayonnement de la France. Énergie nucléaire et identité nationale après la Seconde Guerre mondiale, Paris, La Découverte.
[20] . Voir Pessis Céline, Topçu Sezin, Bonneuil Christophe (dir.), 2013, Une autre histoire des « trente glorieuses », Paris, La Découverte, collection « Cahiers libres », cité par Audier Serge, « Les “Trente Glorieuses” pas si radieuses », Le Monde des Livres, 12 septembre 2013, 12 h 09. Voir http://www.lemonde.fr/livres/articl...
[21] . Pour une synthèse détaillée de l’évolution du terme « culture », voir Cuche Denys, 2004, La notion de culture dans les sciences sociales, Paris, La Découverte.
[22] . Les biais de représentation culturelle que cette acception induit répondent souvent à une méconnaissance et à une vision tronquée de la réalité. Elle s’appuie sur une dite « personnalité de base », qui renvoie à une configuration psychologique particulière propre aux membres d’une société donnée, et, qui se manifeste par un certain style de vie sur lequel les individus brodent leurs variantes singulières. Il est fréquent de se référer au courant anthropologique culturaliste à travers l’appellation « Culture et Personnalité » dont Franz Boas (préfigurateur avant l’heure), Ruth Benedict et Margaret Mead furent les chefs de file. Les contributions d’Edward T. Hall (1979, 1994) s’inscrivaient également dans ce courant. Néanmoins, c’est aux anthropologues Ralph Linton et Abraham Kardiner, qui se servirent des concepts élaborés par les anthropologues diffusionnistes avant eux, que l’on doit la définition de « personnalité de base ». Linton et Kardiner centrèrent leurs analyses sur les composantes de la culture à la suite de séjours prolongés dans des sociétés éloignées. C’est ainsi qu’ils définirent les notions d’aire culturelle, d’élément culturel, de complexe culturel – ensemble des traits culturels que l’on considère comme étant suffisamment liés pour que l’on puisse déterminer les représentations de chaque individu et qui se traduisent par la personnalité de base.
[23] . L’ouvrage d’Eliseo Veron montre, à ce titre, comment les médias ont participé de l’élaboration de la catastrophe de Three Mile Island, voir Veron Eliseo, 1981, Construire l’événement, les médias et l’accident de Three Mile Island, Paris, Éditions de Minuit.
[24] . Voir Araki Hiroyuki, 1973, Nihonjin-no kōdō yōshiki (Le comportement des Japonais), Tōkyō, Kodansha.
[25] . Voir Berque Augustin, 1982, Vivre l’Espace au Japon, Espace et liberté, Paris, Presses universitaires de France.
[26] . Berque (1986) énonce ce questionnement auquel il propose un ensemble de réponses.
[27] . Cette remarque vaut principalement pour l’ouvrage Le sauvage et l’artifice ; voir Berque Augustin, 1986, Le sauvage et l’artifice, les Japonais devant la nature, Paris, Gallimard.
[28] . Pour la définition du terme écoumène, voir Augustin Berque 2010, paragraphes 3-6 : il s’agit d’un mot en grec ancien signifiant « l’habitée » (oikoumêné) ; du participe passé oikeô (« j’habite »), la terre habitée (oikoumenê gê), la « terre habitée ». On notera toutefois que Berque l’utilise au féminin pour se différencier de l’usage masculin et scientifique de la géographie qui parle d’écoumène de façon objective sans problématiser l’autre aspect de l’écoumène – la subjectivité des humains dans leur présence sur la Terre, demeure de leur être – qui, elle seule autorise un questionnement ontologique.
[29] . Le lecteur pourra se référer au cinquième chapitre « Les failles d’où monte la nature » de l’ouvrage de Berque, 1986, Le sauvage et l’artifice, les Japonais devant la nature, Paris, Gallimard, p. 169-213, au sein duquel l’auteur exprime les subtilités et contradictions inhérentes à l’acception de nature dans la société japonaise.
[30] . Voir les entrées « Kojiki. Norito » et « Nihon Shoki », Nihon koten bungaku teiken (Collection de littérature classique japonaise), volumes 67-68, Tōkyō, 1958 Iwanami shoten.
[31] . Pour une description plus approfondie du mythe fondateur, voir Yoshie Akio, Macé François, 1995, « Éviter la souillure. Le processus de civilisation dans le Japon ancien », Annales. Histoire, Sciences sociales, N° 2, p. 283-306.
[32] . Voir Aristote, Physique, II, 8, I99b.
[33] . Le terme shizen peut se lire également jinen.
[34] . Laozi est l’autre lecture de Lao-tseu.
[35] . Mencius.
[36] . On retrouve cette relation de l’homme à l’univers dans « les théories du Yin-Yang ; les Cinq Parcours (wu xing), le Souffle cosmique (qi), etc. [qui] systématisent les relations mutuelles de la nature (tian) et de l’homme (ren) » (Berque, ibid., p. 173).
[37] . Pour le lecteur non japonisant, je précise que la plupart des termes japonais ont une double lecture, kun-yomi (autochtone et antérieure à la sinisation) et on-yomi (ou phonétique) qui correspond à la prononciation des lectures chinoises légèrement déformées.
[38] . Le Haïkaï correspond à la forme antérieure du haïku.
[39] . Tanaka Seidai, 1967, Nihon no teien, (Les jardins du Japon), Tōkyō, Kajima Shuppankai.
[40] . Voir Araki Hiroyuki, 1973, Nihonjin-no kōdō yōshiki (Le comportement des Japonais), Tōkyō, Kodansha.
[41] . Pelletier Philippe, 2003, Japon, crise d’une autre modernité, Paris, Belin, La documentation française, p. 31.
[42] . La « laurisylve », qui comprend une forêt persistante à feuilles brillantes et poilues, est caractérisée par une abondance d’espèces tropicales (lauriers, camphriers, camélias, châtaigniers, variétés de chênes…) (ibid., p. 74).
[43] . Courant marin chaud analogue à celui du Gulf Stream.
[44] . Bouchy Anne-Marie, 1994, « Shintō », in Berque Augustin (dir.), La civilisation japonaise, Paris, Hazan, p. 459-463.
[45] . Il s’agira surtout de la séparation de la religion et de l’État.
[46] . Pour des informations détaillées sur le cycle des rites annuels au Japon, le lecteur pourra consulter l’ouvrage de synthèse de Laurence Caillet (Caillet Laurence, 1980, Fêtes et rites des quatre saisons au Japon, Paris, Publications orientalistes de France) fondé sur le recueil de vocabulaire régional concernant les rites saisonniers effectué par l’anthropologue Yanagita Kunio ; voir également Totermund Hartmut O. (dir.), 1988, Religions, croyances et traditions populaires du Japon. I « Aux temps où arbres et plantes disaient les choses », Paris, Maisonneuve et Larose et Caillet Laurence, 1994, « Fêtes et rites saisonniers », in Berque Augustin (dir.), La civilisation japonaise, Paris, Hazan, p.205-208. Laurence Caillet rappelle également que, dans la lignée des travaux de Yanagita Kunio, « l’ethnographie japonaise se définit avant tout comme folkloriste et délaisse souvent l’aspect sociologique des fêtes » (Caillet, 1980, p. 8).
[47] . « La majorité des rites populaires liées aux saisons au Japon appartient à la « population agraire dont les préoccupations économiques et rituelles sont axées sur la riziculture » (Caillet, ibid., p. 8).
[48] Pour une explication précise de la vision « situationnelle » de la morale japonaise, liée à l’absence de référent transcendantal, voir Berque, 1986, p. 169-213.
[49] . Nature, nation, naître.
[50] . Cette succincte synthèse a en partie été rendue possible grâce aux éclairages fournis sur l’essor de l’art pictural nippon par ces deux auteurs, voir Elisseeff Danièle, Elisseeff Vadime, 1974, La civilisation japonaise, Paris, Arthaud, p. 345-368 ainsi que par Hélène Bayou, conservatrice au musée des Arts asiatiques-Guimet ; voir Bayou Hélène, 1994, « La peinture avant Meiji », Berque Augustin (dir.), Dictionnaire de la civilisation japonaise, Paris, Hazan, p. 377-388.
[51] . Wang Hi-Tche (307-365) était déjà extrêmement populaire à l’époque des T’ang puis des calligraphes japonais tels que Ono no Tōfu (896-966), Fujiwara no Sari (944-998), Fujiwara no Kōzei (912-1027) s’inspirèrent du maître chinois pour parfaire certaines techniques avec notamment l’invention des syllabaires, les kana (Elisseeff & Elisseeff, 1974, p. 348).
[52] . Jullien François, 1991, Éloge de la fadeur, À partir de la pensée et de l’esthétique de la Chine, Paris, Philippe Picquier.
[53] . Si les premières estampes de l’époque d’Edo étaient monochromes, elles s’enrichirent rapidement de deux ou trois couleurs, et, l’apogée de l’estampe polychrome coïncida avec la fin du xviiie siècle et le début du xixe siècle.
[54] . Oka Isaburō, « Estampes », 1994, in Berque Augustin (dir.), Dictionnaire de la civilisation japonaise, Paris, Hazan, p. 173-183.
[55] . Comme en témoigne la célébre représentation de la Grande Vague de Kanagawa : (Kanagawa-oki nami-ura) : « Sous la vague au large de Kanagawa », de Hokusai Katsushika, 1830.
[56] . Takashina Shūji, 1994, « Esthétique », in Berque Augustin (dir.), Le dictionnaire de la civilisation japonaise, Paris, Hazan, p. 183-188.
[57] . Qui a donné l’adjectif utsukushii : magnifique.
[58] . On notera que ces diverses remarques appartiennent à son auteur et peuvent prêter le flanc à la critique du culturalisme.
[59] . Toutefois, rappelle Berque (ibid., p. 512), le terme wabi qui signifie « les tourments et la langueur d’un être qui n’est plus à sa place » conserve une acception négative – wabi : excuses ; wabishii : solitaire, misérable…
[60] . Cette esthétique éthique influencera durablement le bouddhisme zen ainsi que la poésie et l’art du haïku. Le poète Bashō (1644-1694) en fera son précepte et calquera son mode de vie sur cette notion de wabi-sabi.
[61] . Katō Shūichi, 2009, Le temps et l’espace dans la culture japonaise, (Traduction Christophe Sabouret), Paris, CNRS Éditions, p. 193 ; voir édition originale : Katō Shuichi, 2007, Nihon bunka ni okeru jikan to kūkan, Tōkyō, Iwanami Shoten.
[62] . Zeami (1364-1443), grand acteur, auteur et théoricien du théâtre nō.
[63] . Voir Escande Yolaine, 2013, Jardins de sagesse en Chine et au Japon, Paris, Éditions du Seuil.
[64] . Grand Dictionnaire Ricci de la langue chinoise (dictionnaire chinois-français).
[65] . Voir Berthier François, 1989, Le Jardin du Ryōanji. Lire le zen dans les pierres, Paris, Adam Biro, p. 84.
[66] . Ce terme peut tantôt s’apparenter à son homonyme, la rouille, à de la froidure (hie), à la solitude hivernale et désolée, à quelque chose de triste, solitaire, reculé (sabishii) (Berque, 1994, p. 512).
[67] . Parmi les artistes du Mono-ha figurent au côté de Lee Ufan, Suga Kishio, Sekine Nobuo, Koshimizu Susumu, Yoshida Katsurō, Narita Katsuhiko, Enokura Kōji, Takayama Noboru, Haraguchi Noriyuki, Honda Shingo, Takamatsu Jirō.
[68] . Lee Ufan parle de matière quasi à l’état brut – pierre, terre, bois, papier, coton, fer, verre, caoutchouc, huile, plastique, plexiglas, éponges, ampoules électriques, tubes néons, etc. ; voir Ufan Lee, 2002, Un art de la rencontre, Arles, Actes Sud, p. 77-78.
[69] . Et reflétait ainsi une vision du monde, de la nature et des matériaux comme « un allant de soi-même », soit une nouvelle manifestation nipponne de la notion endémique de nature.
[70] . Voir Gomez Edward M., 1994, « Art moderne (depuis 1945) », in Berque Augustin (dir.), Le dictionnaire de la civilisation japonaise, Paris, Hazan, p. 26-35.
[71] . Cette description est directement empruntée à l’analyse des faits et gestes de la cérémonie du thé telle qu’elle apparaît dans Berque Augustin, 1994, « Thé (cérémonie du) », in Berque Augustin (dir.), Le dictionnaire de la civilisation japonaise, Paris, Hazan, p. 487-489 ; il s’agit d’une réunion de thé (chakai) de mi-journée et de style Ura Senke.
[72] . On parle aussi de « chambre de thé » (chashitsu), mais le terme sukiya désigne quant à lui une « maison de la fantaisie » mais aussi une « maison de la vacuité », voire une « maison de l’asymétrie » ; cf. Okakura Kakuzō, 2006, Le livre du thé, Arles, Picquier Poche, p. 76.
[73] . Il s’agit du temps fort de la cérémonie, selon les explications de Berque : « s’incliner, remercier l’hôte officiant en prononçant itadakimasu [littéralement « il m’est donné de recevoir »] ; prendre le bol de sa main droite, le poser sur sa paume gauche, le fait tourner de la main droite trois fois dans le sens des aiguilles d’une montre ; boire le thé en quelques gorgées ; essuyer entre le pouce et l’index droits l’endroit où on a posé les lèvres ; s’essuyer les doigts avec le papier (kaishi) ; faire tourner le bol dans l’autre sens, le reposer sur le tatami » (op. cit, p. 489).
[74] . Leroi-Gourhan André, 2004, Pages oubliées sur le Japon, (Recueil posthume établi par François Lesbre), Grenoble, Jérôme Millon.
[75] . Lévi-Strauss Claude, 1990, « La place de la culture japonaise dans le monde », Revue d’esthétique, 18, p. 9-21.
[76] . Cette remarque assigne à nouveau un caractère ontologique de nature animique – ce qui reviendrait à concevoir que les animaux produisent des sons dotés de musicalité… il y a donc partage des intériorités entre non-humains et humains dans la représentation de la culture musicale japonaise.
 Fil des publications
Fil des publications
 liste des ouvrages
liste des ouvrages